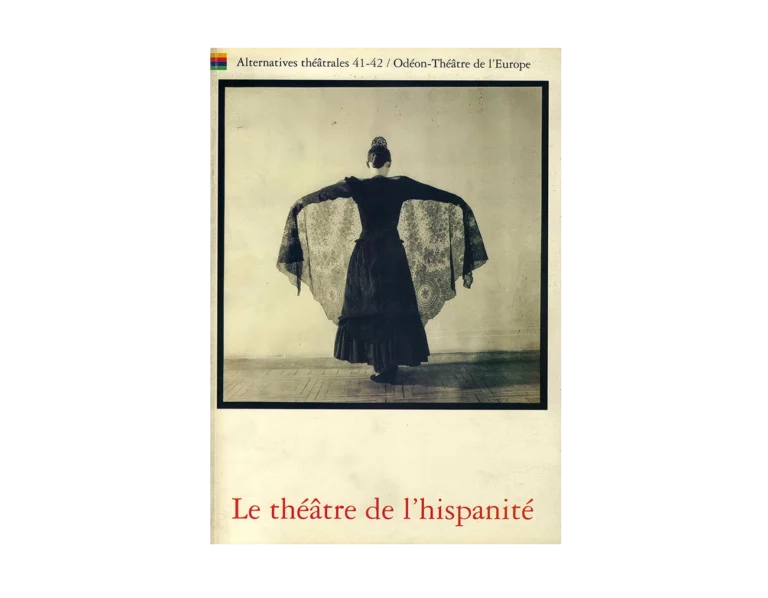A route de Compostelle, depuis le Moyen-Âge, a toujours tenu une brèche ouverte dans la muraille des Pyrénées. Et puis, sur les champs de bataille accoutumés de l’Europe, troupes espagnoles et françaises, avec des fortunes diverses, se sont souvent, pendant des siècles, frottées l’une à l’autre. On ne sort jamais indemne de tels voyages et de tels affrontements. En littérature et au théâtre aussi.
Depuis les chansons de geste, AMADIS, les œuvres de Guilhem de Castro, toujours quelque chevaleresque Cid a ainsi caracolé dans notre imaginaire. Avec lui, cultivant le même pudonor, se profila sur nos lettres l’ombre démesurée de Don Quichotte, et celle de Sancho, picaro entraînant dans son sillage toute une meute de mendiants loqueteux et de brigands pillards, quelques capitans bravaches, Escobombardons à la vaine superbe, aussi démesurée que leurs rapières. Ont suivi des duègnes empesées de noir, aussi intransigeantes Sur l’étiquette que besogneuses dans l’intrigue, des ecclésiastiques frottés d’Inquisition, à l’œil torve et à l’haleine chargée, bien d’autres encore.
Ainsi, à la raideur orgueilleuse de héros épiques, auxquels le romancero hispano-mauresque avait toutefois fini par donner un poli plus précieux, à leur idéalisme absolu, se mêlait la pittoresque verdeur de types populaires rudoyés par la vie, comme on en rencontrait par exemple dans le LAZARILLO DE TORMES ou le GUZMAN D’ALFARACHE.
Au seuil de la Révolution, c’est de ce côté plutôt qu’avait penché l’inspiration venant d’Espagne, car le Siècle des lumières avait, dans l’ensemble, sévèrement jugé une société tenue pour superstitieuse qui, pour exalter sa foi, allumait des bûchers. C’est peut-être pour cela que Lesage, en suivant les aventures déjà rocambolesques des personnages du DIABLE BOITEUX et de GIL BLAS DE SANTILLANE, mène une manière d’enquête morale et que le Figaro du BARBIER DE SÉVILLE évolue dans une Espagne de pure convention où quelques détails du décor, guitares et jalousies grillagées, suffisent à créer pour des héros de partout et de nulle part, l’exotisme d’une atmosphère à l’espagnole.
Au sortir de la Révolution, le prestige espagnol reste toutefois intact et va, dans une certaine mesure, servir au théâtre à l’élaboration de l’esthétique mélodramatique. Celle-ci en effet, réclamée par un public aux assises plus largement populaires, naquit à ce moment-là sous l’impulsion de Pixcrécourt et des épigones. Elle délimitait un univers fictif présentant au spectateur toutes les apparences d’un réalisme pseudohistorique où se conjuguent l’idéalisme des sentiments, la violence des actions et la soudaineté des coups de théâtre. Les modes de fonctionnement des codes mélodramatiques recouvraient ainsi presqu’exactement les stéréotypes que l’imaginaire collectif attribuait alors à l’Espagne.
Ce phénomène explique qu’à côté des œuvres de tradition reprenant les clichés de l’inspiration espagnole (LE ROI ET LE LABOUREUR, OU DON PHÈDRE, tragédie en 5 actes d’A.V. Arnault, Comédie Française, 1802) voient le jour des mélodrames qui apportent leur tonalité propre à l’univers picaresque en l’intégrant à leur structure intime : ainsi par exemple LES BANDOLÉROS OU LE VIEUX MOULIN (Pitt et Bié, Gaîté, 1805), DAGO OÙ LES MENDIANTS D’ESPAGNE (Cuvelier, AmbiguComique, 1806), LA PETITE BOHÉMIENNE (Caigniez, AmbiguComique, 1816).
En outre, dans ces mélodrames qui faisaient appel à des personnages extrêmement typifiés, l’emploi du niais, qui apportait la seule note de comique dans un univers violemment pathétique, prit une importance déterminante. Ainsi, dans un des grands succès du mélo de l’Empire, LA CITERNE (Gaîté, 1809) où Pixcrécourt donna sans ambages à son héros comique le nom de Picaros, procédé déjà popularisé quelques années auparavant par Dupaty dans son PICAROS ET DIÉGO (1803), mouture espagnole d’une première pièce censurée (L’ANTICHAMBRE OÙ LES VALETS ENTR’EUX, 1802).
On rencontre aussi dans les mélodrames de l’époque des personnages comiques espagnols plus conventionnels, souvent affublés d’une forte charge parodique comme le Don Niaiso Sottinez y Godichos de Nigaudinos du célèbre PIED DE MOUTON (mélo-féerie, Gaîté, 1806) de Ribié et Martainville. Au moment où la guerre d’Espagne commence, la seule consonance espagnole du nom confère au niais une estampille supplémentaire de bêtise crasse, ainsi pour le Tartuffos de LA BELLE ESPAGNOLE OÙ L’ENTRÉE TRIOMPHALE DES FRANÇAIS À MADRID (Cuvelier, Cirque Olympique, 1809) ainsi pour le Don Mesquinos de LA CITERNE, vieux héron amoureux qui laisse heureusement présager ce que sera le Don Guritan de RUY BLAS.
De concert avec l’utilisation comique de l’inspiration espagnole, les mélodramaturges mettent aussi en scène la cruauté et les raffinements du monde hispano-mauresque, et de l’époque des conquistadors. Surgissent alors sur les scènes des boulevards les ors et les clinquants d’une Espagne de théâtre déguisée d’oripeaux historiques. Ainsi dans DON PÈDRE ET ZULICA OÙ LA PRINCESSE DE GRENADE (Thuring, Gaîté, 1802) PIZARRE OU LA CONQUÊTE DU PÉROU (Pixcrécourt, Porte Saint Martin, 1802), LES MAURES D’ESPAGNE (Pixcrécourt, Ambigu-Comique, 1804), ALPHONSE, ROI DE CASTILLE (Milcent d’Herbouville et Dulimont, 1805), L’AMAZONE DE GRENADE (Mme Barthélémy, Hadot, 1812)
Quant au Quichotte et à son compère Pança, ils apparaîtront pendant toute cette époque avec une belle constance mais dans des œuvrettes comiques ou des spectacles équestres. On pourrait dans cette veine citer : BAZILE ET QUITTERIE, OÙ LE TRIOMPHE DE DON QUICHOTTE (pantomime de Suby, Gaîté, 1801); DoON QUICHOTTE ET SON ÉCUYER SANCHO PANÇA (folie, scènes équestres, Cuvelier et Franconi, Jeux Gymniques, 1810), SANCHO DANS L’ILE DE BARATARIA (pantomime de Cuvelier et Franconi, Cirque Olympique, 1816).
La guerre d’Espagne (1808- 1813) ainsi ne semble pas avoir affecté outre mesure les représentations des personnages espagnols sur les scènes populaires encore qu’en vertu des pratiques morales, civiques et patriotiques de ces théâtres, une préférence semble se dessiner pour l’utilisation dans les intrigues de niais ou de comiques espagnols de même que l’utilisation d’arguments qui laissent apparaître l’âpreté de la terre espagnole et la cruauté de ses combattants.
On retrouvera les mêmes préoccupations en 1823. En effet, à cette date, au moment où le mélodrame classique joue aux boulevards sa propre parodie avec le Robert Macaire de L’AUBERGE DES ADRETS, l’expédition d’Espagne, lancée à l’instigation de Chateaubriand, joue à sa manière une parodie de l’épopée napoléonienne.
Les cent mille fils de Saint Louis redorèrent ainsi à bon marché le blason terni des armes de la France dans une promenade militaire que la propagande, par le biais d’une bonne douzaine de pièces de circonstance (parmi lesquelles LES FRANÇAIS EN ESPAGNE, À. Hugo et A. Vulpian, Odéon, août 1823, PLUS DE PYRÉNÉES, M.A. Désaugiers et M.J. Gentil de Chavagnac, à proposvaudeville, Vaudeville, 16 décembre 1823), aurait voulu donner pour héroïque.
En fait, à la lecture de ces pièces, on garde l’impression que c’est moins pour servir les intérêts de la Sainte-Alliance et ceux de Ferdinand VII que les Français étaient allés parader à Madrid, que pour défendre les images romanesques d’une Espagne rêvée, images que les liberalès semblaient menacer.
Ainsi pendant toute la durée de la Restauration et de la Monarchie de Juillet ce sont des centaines d’œuvres qui continuèrent à célébrer l’Espagne et les Espagnols ou du moins l’image conventionnelle que l’on continuait à se faire d’eux. La grandeur et les magies de l’Espagne, surtout mauresque, étaient encore évoquées dans les alexandrins de la tragédie comme dans BOABDIL, OU LES ABENCÉRAGES (1832) de Madame d’Albénas, ou dans les pièces relatant des épisodes héroïques ou cuisants des affrontements franco-espagnols comme dans LES PONTONS DE CADIX (1836, Opéra-Comique) de F. Ancelot et Duport. Le courant picaresque garde aussi toute sa vigueur en s’épanouissant dans le PIQUILLO (1837) d’A. Dumas et G. de Nerval (Opéra-Comique, musique de Monpou) et le PIQUILLO ALLIAGA OÙ TROIS CHÂTEAUX EN ESPAGNE (1849), drame d’A. Bourgeois et M. Massé, tiré du roman de Scribe.
La sève de l’inspiration espagnole semble alors irriguer tous les genres, le théâtre mais aussi le roman et la poésie qui, à l’image de celle de Musset, se laisse séduire par « l’Andalouse au sein bruni ». Se ravivent à nouveau partout, dans le quotidien, la littérature et le théâtre, l’emploi de mots espagnols : guerilla, basquine, alcade, alguazil, brasero, mantille… Même Scribe, pourtant si étranger aux fastes verbeux du romantisme se laissera aller aux sentiments de feu qu’ils laissent présager. Telle réplique du GUITARRERO (1841) montrera jusqu’où va l’engouement et comment les clichés s’imbriquent les uns dans les autres : « Pour nous autres, gentilshommes de Séville ou de Cordoue, qui avons du sang africain dans les veines, triompher d’une maîtresse est moins doux que de s’en venger quand elle nous a outragés dans notre honneur ».
Dans cette première moitié de siècle, si l’on excepte peut-être l’inspiration théâtrale du romantisme qui va lui donner une dimension particulière, l’Espagne de l’imaginaire français, avec quelques variations perpétue ainsi les clichés, les images d’une terre aux passions aussi rudes et lumineuses que ses paysages. Dans des décors d’intérieur surchargés d’accessoires comme des châsses de saints, s’aiment des femmes jalouses et des hommes orgueilleux, portant l’honneur au pinacle et l’amour au sublime, pratiquant l’art de la vengeance avec des raffinements qui confinent à la poésie. Les théâtres populaires conservaient aussi ces mêmes traditions en donnant plus de place peut-être à la verve truculente d’astucieux graciosos comme le valet Pedrille du GUZMAN D’ALFARACHE de Scribe (comédie-vaudeville, Variétés, 1816). On retrouve aussi ces duègnes faméliques, ces hidalgos héronesques, ces fripons ridicules des mélos et des comédies de l’Empire et de la Restauration dans des pièces comme TRINGOLINI, OÙ LE DOUBLE ENLÈVEMENT, mélo-comique de SaintHilaire (Panorama Dramatique, 1823), ou des pièces qui tout au long de ce demi-siècle feront encore perdurer le mythe figaresque comme LE FILS DE FIGARO de Burat de Gurgy et Masselin (Ambigu-Comique, 1835) ou LA FILLE DE FIGARO de Duveyrier (Palais-Royal, 1843).
Dans un autre registre, mais bien en somme dans la manière de Figaro, titres et pièces à l’espagnole servirent de paravent aux violentes attaques menées en France contre les jésuites, surtout après la Révolution de 1830. Ces hardiesses, que pourchassait une censure à nouveau tatillonne après 1835, furent tolérées parce que les intrigues se déroulaient sur le territoire espagnol comme celle par exemple du CURÉ MÉRINO, drame de Mallian, Tournemine et Wolf (Ambigu-Comique, 1834) qui stigmatisa « la vieille Espagne ! oui, l’Espagne avec ses préjugés, l’Espagne inculte et barbare au milieu de la civilisation qui la presse de toutes parts, l’Espagne restée jusqu’ici froide sous le soleil de la liberté qui échauffe l’Europe » ! Par ce biais, les théâtres populaires semblaient peut-être vouloir suggérer à Louis-Philippe la pratique de la méfiance à l’égard de la Compagnie de Jésus ainsi que le montrent encore des pièces comme FARINELLI OU LE BOUFFE DU ROI (Palais-Royal, 1835) de Saint Georges, Pittaud de Forges et Leuven, où CHARLES IIT OU L’INQUISITION (Porte-Saint-Martin, 1835) de d’Epagny et Deyeux.
D’autre part, derrière le paravent espagnol pouvaient semble t‑il se jouer des pièces où des héros emportés poussaient à l’extrême la violence de leurs passions comme dans FARRUCK LE MAURE (Porte SaintMartin, 1831) de V. Escousse dont le héros éponyme pour venger la mort de sa fille viole la fiancée de son ennemi don Alphonse puis se fait prêtre avant de lui révéler la vérité.
Cette manière de voir dans l’Espagne l’alibi, le décor idéal des rêves possibles et des passions sans limites servira beaucoup la manière romantique au théâtre. En effet, si les stéréotypes espagnols s’étaient, tout au début du siècle, parfaitement moulés dans les conventions de l’esthétique mélodramatique, les romantiques, dans un autre registre, celui que Caïgniez et Villiers, dans un mélodrame alors en mutation, avaient indiqué dans ROSALBA D’ARANDÈS (Panorama Dramatique, 1821), vont capter l’héritage espagnol pour adopter une écriture où le lyrisme se taille la meilleure part et définit à lui seul un nouvel espace dramatique.
C’est ainsi que LE CID D’ANDALOUSIE de P.A. Lebrun (Théâtre-Français, 1825) un des premiers, avait donné le ton. Que l’entreprise soit d’abord littéraire avant d’être théâtrale n’étonne pas de même qu’elle se fasse dans un premier temps avec LE THÉÂTRE DE CLARA GAZUL (1825 puis 1830 puis 1842), théâtre écrit et non joué, sous le couvert d’une mystification. Mérimée, en effet, voulut faire croire à l’existence d’une comédienne espagnole qui aurait été l’auteur de l’ouvrage. Il construisit même une biographie imaginaire avec les poncifs espagnols à la mode : « arrière petite fille du tendre maure Gazul (…) née d’une bohémienne sous un oranger, dans le Royaume de Grenade », qui aurait par ailleurs échappé aux persécutions d’un inquisiteur pour trouver enfin son refuge et sa vocation au grand théâtre de Cadix.
À trop vouloir jouer avec les poncifs, on finit par s’y laisser prendre et les brèches s’ouvrent d’elles-mêmes : après un théâtre de lecture, un théâtre littéraire tout empanaché d’alexandrins bravaches investit alors le théâtre français. La bataille d’HERNANI OU L’HONNEUR CASTILLAN (1830) sera d’abord une victoire espagnole sur la scène française, de même que RUY BLAS en 1836 qui, d’une certaine façon, marquera l’état le plus achevé du drame romantique. Tous deux avaient emprunté au drame espagnol le couple toujours mal assorti en France de l’héroïque et du burlesque en montrant des rois agissant comme des brigands et des brigands ayant la superbe des rois. Dans un espace où toutes les transgressions demeuraient possibles, se jouaient alors des jeux violents d’ombres et de lumière entre des héroïnes solaires et des personnages ténébreux. Tous les clichés antérieurs sont encore reconnaissables, mais comme subvertis par la violence d’un achèvement fatal.
Ainsi dans un monde louis philippard, de plus en plus étriqué et voué au conformisme moral de prudhommesques philistins, plus préoccupés de leurs prébendes de regrattiers que des éclats fugitifs du romantisme, romantisme que les académiciens prenaient alors « pour une maladie comme le somnambulisme ou l’épilepsie » (Duvergier de Hauranne), l’Espagne gardera intacts tous les envoñtements promis d’une terra incognita.
C’est en effet bien d’autres trésors que l’or seul que recherchent alors les conquistadors des lettres, comme l’indique le mépris avec lequel don César de Bazan traite le monceau de doublons échoué dans ses mains, comme l’indique telle réplique de la DOLORÈS (1836) de Dennery et Tilleul : « Et il t’a donné de l’or ? C’est donc un Français. Un Espagnol t’eût frappé de son poignard ».
Ainsi dans une France inhibitrice, conservatrice et corsetée d’interdits, les romantiques pour dire le courage, la dignité, l’élégance utilisent des images idéalisées de l’Espagne qui en somme métaphorisent les contradictions les plus vives de leur être intérieur. Chaque valeur fondamentale de la nouvelle éthique trouve dans cet espace privilégié à la fois son accomplissement et sa perversion : on y rencontre le mystère grandiose de Dieu et de l’infini, mais aussi les cruelles turpitudes de l’Inquisition ; la passion et ses clartés aveuglantes, mais aussi ses fatales ténèbres ; la fantaisie picaresque et sa verve jubilatoire, mais aussi ses gueuseries ; l’honneur et sa fortitude enfin, mais tenus inébranlables, jusqu’à l’absurde.
Au bout du compte et en point d’orgue, par un itinéraire textuel et scénique presque habituel au XIXè siècle, c’est la CARMEN (1845) de Mérimée, nouvelle qui servira de canevas à l’opéra de Bizet (1875), qui fixe et emblématise semble-t-il définitivement ces images fortes de l’imaginaire espagnol du romantisme. C’est ainsi au cœur d’une Espagne rêvée, dans un lieu au-delà des frontières et des contraintes, mais qui au dernier acte se ferme comme une arène, que le héros romantique continue d’affronter, sans « querencia », son orgueilleuse solitude.
À AUCUN moment les contacts entre la littérature française et la littérature espagnole ne semblent avoir été aussi favorisés qu'au…