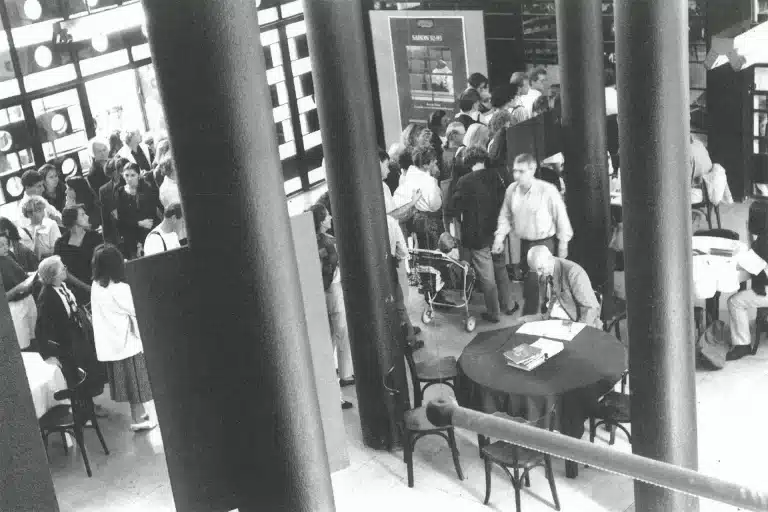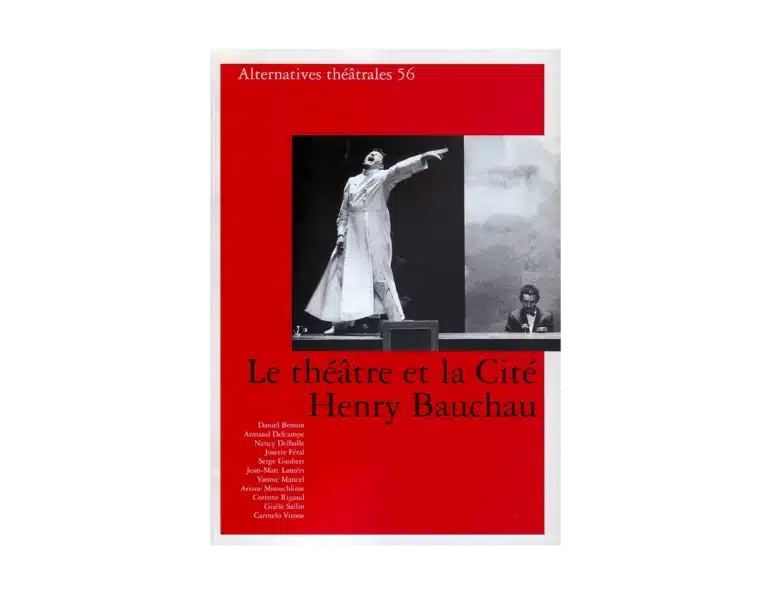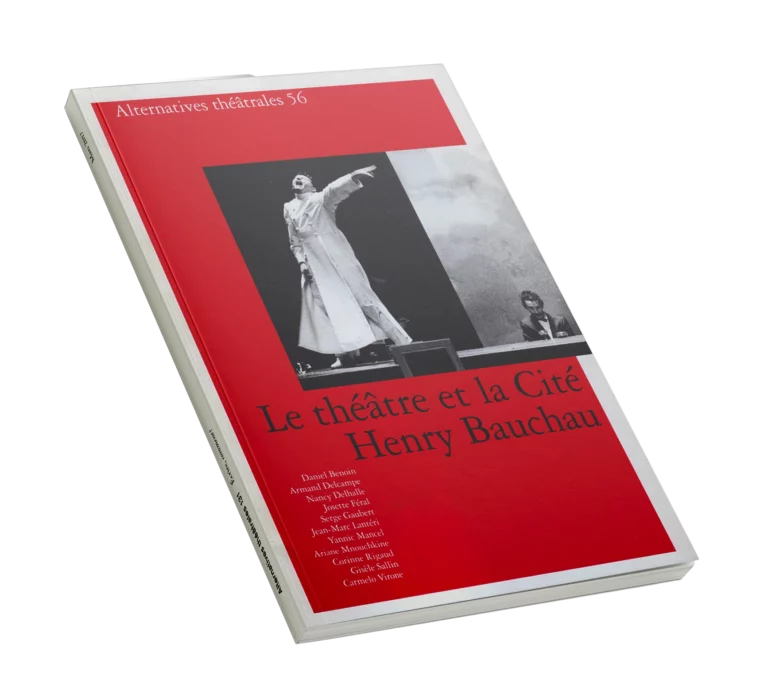D’après la structure narrative de LE BANQUET de Platon.
Centre Dramatique National sous la Direction de Daniel Benoin.
— Tu veux me jeter un sort, Socrate, dit Agathon ; tu veux que je me trouble à la pensée que l’assemblée est dans une grande attente des belles choses que j’ai à dire.
— J’aurais bien peu de mémoire, Agathon, répliqua Socrate, si, après t’avoir vu monter si bravement et si hardiment sur l’estrade avec les acteurs et regarder en face sans la moindre émotion une si imposante assemblée, au moment de faire représenter ta pièce, Je pensais maintenant que tu vas te laisser troubler par le petit auditoire que nous sommes.
— Eh quoi ! Socrate, dit Agathon, tu ne me crois pas pourtant si entêté de théâtre que j’aille jusqu’à ignorer que pour un homme sensé un petit nombre d’hommes sages est plus à craindre qu’une multitude d’ignorants.
— J’aurais grand tort, Agathon, dit Socrate, de te croire si peu de goût ; je sais bien, au contraire, que, si tu te trouvais avec un nombre restreint de gens qui te paraîtraient sages, tu aurais plus d’égard à leur jugement qu’à celui de la foule. Mais peut-être ne sommes-nous pas de ces sages ; car enfin nous étions, nous aussi, au théâtre et faisions partie de la foule. »1
INTERLOCUTEURS :
D’abord :
Apollodore, l’ami d’Apollodore
(Alternatives théâtrales);
Ensuite :
Arlette Allain, Bruno Andrieux, Daniel Benoin, Pol Charieras, Serge Gaubert, Zizou Grangy, Jean-Pierre Laporte, Jean-Pierre Laurent, Ouria Khouli, Lucien Marchal, Christiane Raïa… (La Comédie)
APOLODORE2
I. — Je crois que je suis prêt à vous faire le récit auquel vous vous attendez et que votre attention mérite. Il n’y a pas si longtemps, comme je rentrais du pays d’où je viens pour rejoindre, à quelque mille kilomètres, la ville du pays où j’habite, un homme de ma connaissante, qui venait derrière moi, m’aperçut3 et m’interpella, assez satisfait de voir que le hasard avait anticipé sa volonté de me rencontrer au plus tôt : « Hé ! Apollodore, s’écria-t-il, attends-moi donc ! ». Ses jambes étaient extraordinairement courtes et se donnaient beaucoup de peine à combler la distance qui nous séparait. J’eus pitié, je m’arrêtai et l’attendis. Essoufflé et largement souriant, il s’approcha de moi avec l’excitation fébrile de ceux qui sont sur le point d’émettre un désir et qui ont le sentiment intuitif que ce désir va être pleinement comblé. Par esprit de contradiction, j’eus presque envie de le décevoir avant même qu’il ne fasse sa demande pressante mais je me ravisai et l’écoutai : « Apollodore, me dit-il, je te cherchais justement pour te questionner sur les différents entretiens que l’on t’a accordés à la Comédie de Saint-Étienne et te demander, peut-être déjà ou peut-êtr un peu, d’écrire quelques lignes sur le Centre Dramatique ou si tu préfères, de me raconter et de me décrire en quelques mots ce que tu as pu voir et entendre, car je suis très curieux de connaître les discours que l’on a tenus sur le théâtre public. Quelqu’un m’en a déjà parlé, qui les tenait de je ne sais qui, fils d’un certain Philippe ; mais lui n’a rien pu dire de précis. Rapporte-les moi donc : c’est à toi qu’il appartient avant tous de rapporter les discours ! — On voit bien, répondis-je, que ton homme ne t’a rien raconté de précis, si tu penses que je vais te faire le compte rendu « énumératif » des arguments que l’on m’a avancés et des propos que l’on m’a tenus, tu te trompes. Tu te trompes, essentiellement pour les deux raisons que je vais te donner, toutes les deux, même s’il me semble que la première à elle seule est un prétexte assez simple et assez fort pour faire tourner court notre conversation : je suis debout et immobile dans une raideur physique et intellectuelle d’autant plus sévère que tu t’agites autour de moi avec une frénésie aussi inutile que puérile ; la deuxième raison, moins personnelle, c’est que là-bas, je n’ai entendu de ce que l’on m’a dit que ce que j’ai pu voir ; et j’ai vu beaucoup de choses mais pas de discours. J’ai vu l’activité de ceux qui travaillent dans un théâtre et qui assument de façon autonome ou conjuguée les différentes tâches que se doit d’avoir une telle entreprise. Si de cette activité tu veux que je t’en fasse le récit, il suffit de me le demander. Et si par discours, tu entends réflexions, sois patient et tu verras ta requête honorée.
— Eh bien ! reprit-il, raconte vite. La route qui mène à la ville est faite à souhait pour parler et pour écouter tout en cheminant. »
Dès lors nous nous entretînmes de ces choses tout le long de la route ; c’est ce qui fait, comme je le disais en commençant, que je ne suis bas mal préparé. Si donc vous voulez que je vous les rapporte à vous aussi, il faut que je m’exécute.
Eh bien donc ! les voici à peu près ; mais il vaut mieux essayer de reprendre les choses au commencement, dans l’ordre où je les ai vues et entendues. Vous allez peut-être m’interrompre et me dire que cette procédure méthodique relève d’un esprit simple ou maniaque ou pourquoi pas pire, les deux, et que cette cérémonie d’introduction ne présage rien d’extravagant ni rien d’une fantaisie originale qui vous emmènerait sans effort jusqu’au terme de cette pseudo-conversation, en vous titillant parfois la fibre polémique. Mais je n’ai pas la verve assez débridée pour vous donner une autre excuse que celle que j’utilise toujours dans ce cas-là et qui consiste à répéter qu il s’agit d’une technique de mémorisation à laquelle je suis encore assujetti : si je n’ai pas le début de la chanson, je ne retrouve pas l’air, si je n’ai plus l’air, je n’ai pas le refrain, et si je n’ai pas le refrain, je perds le fil de la fin.
L’ AMI D APOLLODORE
Ce n’est pas la peine de discuter là-dessus maintenant, Apollodore ; fais ce qu’on te demande, rapporte-nous les choses en question.
APOLLODORE
Eh bien les voici à peu près. et dans l’ordre ! Dans l’ordre de celui qui me les a racontées et qui dirige la maison dont on parle. D’ailleurs depuis que je me suis attaché au sujet et que je me fais chaque jour un souci et un plaisir d’y réfléchir, je peux avec une relative précision vous rendre l’histoire telle que je l’ai entendue, il n’y a pas encore très longtemps.
II. — « Avant que je n’arrive à la Comédie de SaintÉtienne, j’étais un jeune metteur en scène qui avait une compagnie. La province, c’était d’abord pour moi, la ville où je suis né et ensuite les villes dans lesquelles ma compagnie tournait. Le théâtre, c’était Paris. Un jour, le Ministère est venu me dire que ce serait bien que je prenne la direction d’un Centre Dramatique. Pourquoi ? Parce que je venais de faire deux pièces en l’espace de 4/5 mois, deux pièces différentes qui avaient fait toutes les deux la première page du Monde.
— Le Ministère n’a jamais changé sa tactique depuis trente ans : dès qu’il voit un jeune metteur en scène (j’avais 25 ans) qui a l’air de sortir il le pique avant qu’il ne soit trop tard — Je suis donc allé au Ministère où l’on m’a répété : Ce serait bien que vous preniez la direction d’un Centre Dramatique ; je leur ai dit : c’est quoi ?, ils m’ont répondu : c’est bien ; ils m’ont proposé Toulouse, Nice et Saint-Étienne et j’ai pris Saint-Étienne en pensant que là-bas, il n’y aurait rien d’autre à faire que travailler et que finalement ça tombait bien, parce que c’était exactement ce que je voulais. Je vous le dis un peu comme ça », me dit-il, croyant peut-être que j’étais surpris par la forme lapidaire de ses propos, « mais c’est comme ça que ça s’est passé. J’avais entendu parler de la Comédie de Saint-Étienne, j’avais vaguement idée de ce qu’était un Centre Dramatique mais à vrai dire pas plus que ça. Moi, tout ce que je savais, c’est que je faisais à ce moment-là des spectacles qui étaient appréciés par la critique la plus pointue. »
L’AMI D’APOLLODORE
Il a donc été nommé à la Direction d’un Centre Dramatique National, sans vraiment connaître le fonctionnement de ce genre d’entreprise ?
APOLLODORE
C’est ce qu’il m’a dit, en effet, et je le crois et tu le croiras aussi quand j’aurai fini de te raconter ce qu’il m’a dit. Je vais te donner le premier et le meilleur exemple pour illustrer l’inquiétude de ta question et y répondre, au moins partiellement. Avant de venir remplacer, à la Comédie de Saint-Étienne, Pierre Vial et Jean Dasté, il avait travaillé sur un spectacle qui avait été commandé par le Festival d’Avignon. Il a fait ce spectacle au nom de sa compagnie mais l’a poursuivi en tant que Directeur du Centre Dramatique puisqu’il avait été désigné entretemps. Le spectacle a donc été joué au Cloître des Carmes, à Avignon, où il a fait un tabac, puis à Paris où il a eu aussi un énorme succès et dans la logique d’une tournée, il est arrivé à Saint-Étienne. Et à Saint-Étienne : « c’était une catastrophe ! Les spectateurs sortaient — par vagues — et moi, j étais là — je ne comprenais rien — je me disais : « Mais c’est quoi ? C’est quoi ça ?Ça veut dire quoi ? ». Et eux étaient en face — et ils ne comprenaient pas non plus — et si quelques-uns ont applaudi, la plupart se sont dit : « Mais c’est quoi ? C’est quoi ça ?Ça veut dire quoi ? ». Après le spectacle, ils ont fait un débat. Et alors que le spectacle durait une heure et demie, le débat les a mobilisés pendant plus de deux heures. Le metteur en scène nouvellement directeur a été conduit à s’expliquer et à faire comprendre ce qu’il voulait faire et tenir : « Un propos totalement éthique et esthétique ». Le public, puisqu’il s’agit de lui, était prêt à écouter, il était prêt à recevoir et à entendre, à condition qu’il comprenne ou qu’il pressente l’enjeu et les desseins de l’objet théâtral qui se jouait devant lui — pour lui. Daniel Benoin, puisqu’il s’agit de lui, a réagi :« J’ai été pris, presqu à rebrousse-poils et je me suis dit : « Attendez ! Vous allez voir. » et ce « allez voir » est devenu « je vais vous voir et je suis allé à la rencontre des gens pour discuter avec eux et cet exercice de communication que l’on appelle « animation » m’a occupé pendant trois mois (j’en ai fait 140). J’essayais de leur parler de ma sensibilité et à l’époque, c’était en quelques mots, un théâtre de signes, un théâtre de l’émotion pure en opposition à un théâtre rationnel. J’avais l’habitude de dire que dans un spectacle, il y a 3 000 signes, qu’un spectateur moyen en perçoit 300 mais qu’aucun spectateur ne capte les mêmes signes et que chaque spectateur fait son propre chemin critique dans ce qu’il voit. C’était un discours qui n’avait rien à voir avec le post-brechtisme. Je voulais faire mon théâtre mais je voulais que mon théâtre soit accepté. Progressivement, j’ai vu mon public diminuer : quand je suis arrivé, il y avait 5 000 abonnés, deux ans plus tard, il y en avait 3 000, aujourd’hui, il y en a 13000.
Je me suis battu. Mais j’ai trouvé ce que je ne trouvais pas à Paris, qui est, finalement la raison pour laquelle je suis venu à La Comédie : un public. Mais pas n’importe quel public, pas un public de circonstances avec lequel on n’entretient aucune sorte de lien réel, de fidélité profonde. Je ne savais pas ce qui m’attendait mais j’ai très vite compris qu’il fallait que je me mette au travail ! »
APOLLODORE
Dans ce début d’histoire que je t’ai relatée soit directement, soit indirectement selon mon gré et que d’autres ont entendue puisque c’était prévu, je peux déjà pointer, si cela t’intéresse, les deux causes essentielles pour lesquelles, il est important, à la Comédie, que les gens travaillent : la médiatisation du théâtre (la relation au public) et le répertoire (les choix esthétiques et politiques). Et voir ainsi, si cela t’intéresse toujours puisque tu ne m’a toujours pas répondu, le double aspect de l’art et de la pratique sociale.
L’AMI D APOLLODORE
Si, Apollodore, je ne t’ai pas répondu, ne me juge pas dans la hâte et n’apprécie pas mon silence comme un manque d’intérêt ou d’éducation. À te fréquenter aussi régulièrement que cela est possible, j’ai appris à ne jamais t’interrompre parce que j’ai compris au terme de plusieurs expériences que c’était une tentative inutile. Ton endurance verbale t’entraîne toujours au-delà de ce qu’on croit être un point final et les réponses que tu suscites à travers tes questions ne sont là que pour aiguillonner ta course qui ne souffre aucun obstacle et je crois même pouvoir dire, surtout si ces obstacles sont posés par moi. Je profite donc de la pause que tu t’es accordée pour te poser, à mon tour une question : quel est le titre du premier spectacle de Daniel Benoin présenté à la Comédie de Saint-Étienne et qui a provoqué un si long débat ?
APOLLODORE
Woyzeck !
L’AMI D’APOLLODORE
Merci !
APOLLODORE