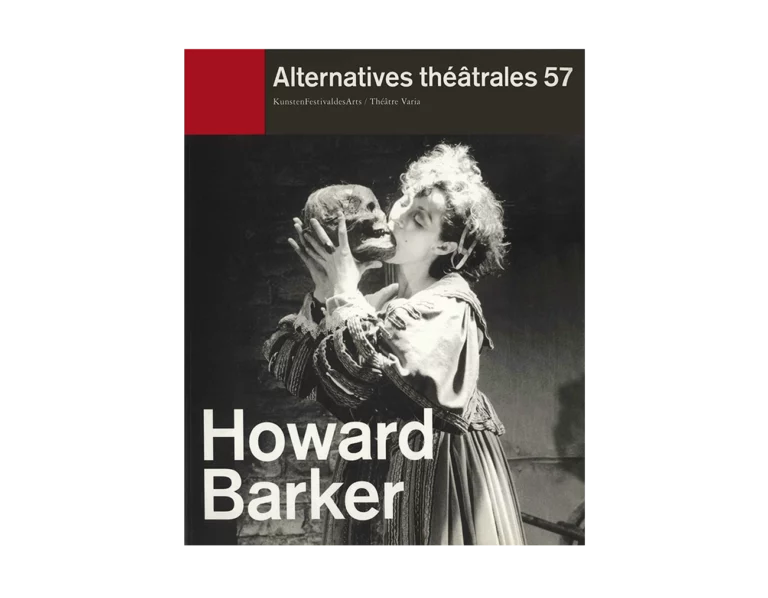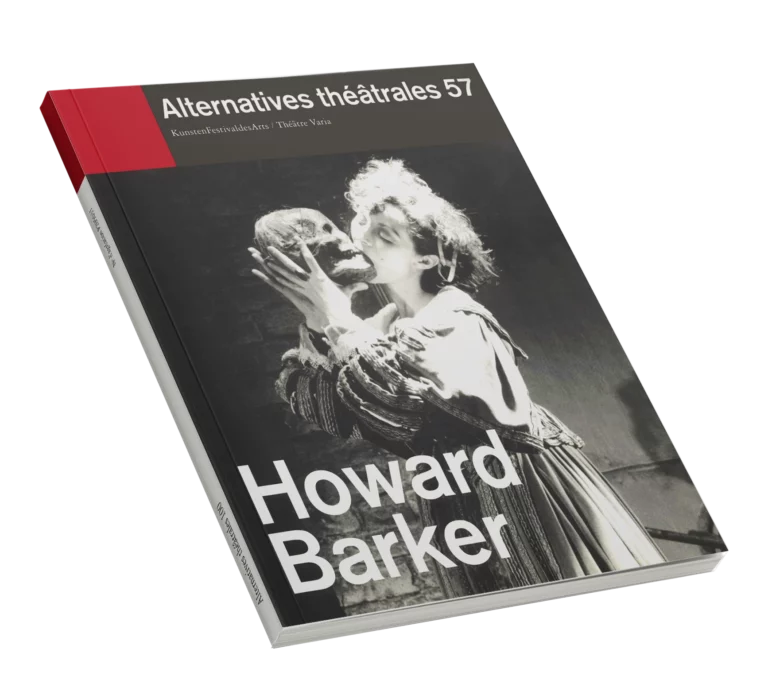J’AI DES RACINES. Elles emjambent la Meuse, s’accrochent à ses flancs. Et là où un pont joint les deux rives, des fumées noires flottent sur les cheminées des aciéries comme autant de drapeaux crasseux. Je suis de ce pays-là. Je suis du pays de l’usine. Je le dis sans fierté. On n’est pas fier d’une poussière noire qui tombe en permanence sur les cahiers. On n’est pas fier d’un paysage de grisaille. On n’est pas fier de la dureté qu’on perçoit parfois dans les yeux des grands sans comprendre encore — car on est petit — le pourquoi de celle-ci. L’usine faisait peur à mon père.
Il y a passé presque cioquantante années. Manœuvre à quatorze ans, (nous sommes avant la guerre 14) chef de l’atelier de construction mécanique à soixante ( nous sommes au début des années soixante). Son fils à J’usine ? Non. Jamais. Même comme ingénieur (on ne disait pas cadre à l’époque). Pas l’usine. Jamais l’usine. Une de ses profondes satisfaction : n’avoir pas laissé sa femme y travailler, à l’usine, avoir tenu ma mère à l’écart de ce monde là.
Je suis du pays de l’usine. Je le dis sans fierté mais je le dis aussi sans aigreur. Car une fois sorti de ce pays, il n’est pas indifférent d’en avoir été l’habitant. Il y a comme un savoir qui vous vient de cette vie-là, un savoir que personne ne vous apprend. Un savoir, un filtre, un point de vue. Pas besoin de passer par de longues interrogations pour comprendre ce qu’est un rapport de classe. On le saie intuitivement, on l’a dans le sang.
Un exemple ? Quand on encre à l’athénée et que pour la première fois on se trouve en présence d’enfants de la bourgeoisie, on comprend toue suite, immédiatement, sans détour, sans délai, ce qu’est un rapport de classe.
On comprend, on sait. On voit des doigts qui se lèvent pour répondre à la question qui est Molière, qui peut donner le titre d’une de ses œuvres, et vous, vos mains sont de plomb parce que, ce nom-là, jamais vous ne l’avez entendu prononcer, jamais. Molière ? Quoi Molière ?
Qu’est-ce que c’est Molière ? Hé, celui-là, ce qu’il est bête, il ne connaît même pas Molière ! Je ne connaissais pas Molière et voyez comme la vie est ironique : c’est au milieu de cette ignorance qu’elle vous enseigne quelques vérités bien sonnées. Car enfin, des situations comme ça, c’est un sacré signal, ça vous alerte, ça vous jette de la clarté au visage. On appréhende la géométrie sociale, on appréhende en cous cas la position qu’on occupe dans le rapport de classes ! Mal placé. Très mal placé. Heureusement, on ne saie pas encore qu’on le sait, sinon quel découragement ! Mais on le sait, on le ressent.
On le vit. Pas même besoin de souffrir une quelconque humiliation, être là suffit. :Être là. Se tenir dans la gaucherie et le mutisme. Dans l’inculture des pas grand chose. Dans leur silence. Dans leur vocabulaire basique. S’apercevoir que l’on parle de sujets donc on ne dit jamais un mot à la maison, que pour certains le monde n’a pas la même configuration que pour vous. Oui, on sait, ça brule, ça s’inscrit dans la chair avant de passer dans le cerveau. Quand on voit une manifestation dans la rue, on sait exactement de quel côté on est, même si on ne comprend rien aux banderoles et aux cris, même si on est en peine de dire pourquoi le rouge du drapeau est la couleur de la dignité, même si le père, pris encre sa position dans la hiérarchie et son appartenance viscérale au monde ouvrier est évasif sur les explications. On sait. Ce savoir-là, ce sont mes racines. J’ai su ce qu’était un gréviste avant de savoir ce qu’était un Belge ou un Wallon.
Pourtant, j’usais du wallon dans la vie quotidienne. Mais ce n’était pas pour moi la langue de la Wallonie, c’était la langue de l’usine d’en face, celle qu’on parlait et que pourtant je ne pouvais pas utiliser parce que justement c’était ce.Ile de l’usine d’en face. Je suppose qu’un jeune français ou un jeune anglais qui apprend sa langue maternelle la ressent comme naturelle. Ce n’est pas le cas d’un jeune garçon né dans le bassin serésien.
Je ne pouvais pas utiliser le wallon, je devais utiliser le français, comment aurais-je pu résister longtemps à cette évidence : l’usage d’une langue n’est pas naturel, jamais naturel, l’usage d’une langue s’inscrit dans un champ de forces, vous inscrit dans un champ de forces. Il y a des langues dominées et des langues dominantes, je l’ai su très vite, « parle correctement ! / Le wallon, ce n’est pas correct ? / Le wallon, ça ne mène nulle parc ! » A partir de là toute prise de parole donne lieu à un repérage social. Impossible d’entendre quelqu’un pour ce qu’il dit sans entendre également ce qu’il trahit en parlant. Parle, et j’identifierais vite ta place approximative dans la division du travail, ton ancrage social, « le lieu d’où tu parles » comme on le dira avec jubilation en 68. Donc, enfant, ce que je savais sans savoir que je le savais est très exactement ceci : la simple existence d’un être et la pratique d’une langue engagent le pouvoir et la soumission. Nous ne grandissons pas dans l’innocence d’une langue maternelle, nous apprenons dès le jeune âge à tenir notre position dans les rapports de pouvoirs.
Mon père avait décidé pour moi : non au wallon, oui au français, oui à la langue de l’ascension. Étrange sicuacion d’un enfam donc les membres de la famille (père et mère notamment) parlent le wallon entre eux, mais le français avec lui, répétant en français, pour lui, ce qu’ils viennent de se dire en wallon et qu’il a parfai tement compris. Quand j’y repense, il y a là comme une bouffonerie de la vie, une redondance à la Dupont et Dupond qui a fait de moi un étranger dans sa propre terre. Somme coute, ai-je été dans une situation tellement différence de celle des enfants italiens qui venaient d’arriver en Belgique et qui habitaient à côté de chez moi ? Eux aussi devaient se déprendre d’une langue pour en adopter une autre. Du moins, avais-je l’avantage sur eux de n’avoir pas à changer de culture.