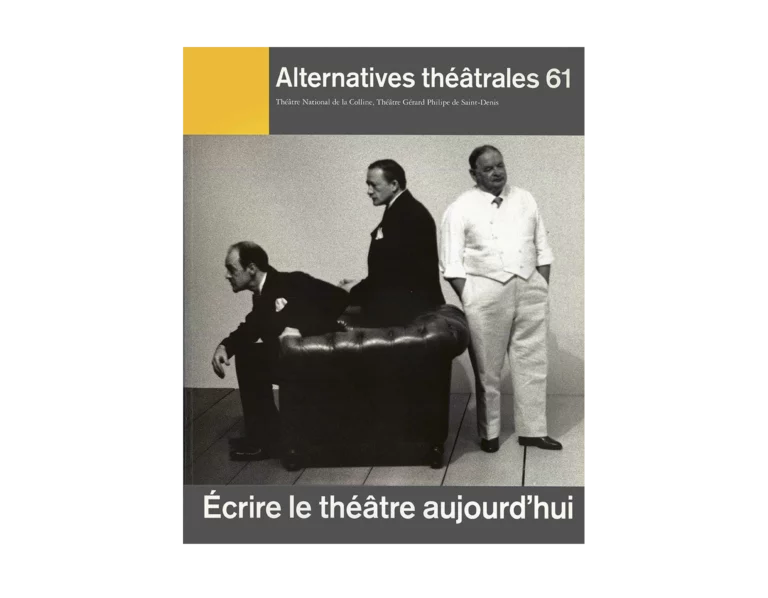J’ÉCRIS À LA MAIN et au bic sur des copies doubles (que je me suis achetées par paquets de mille dans ce qui s’appelait encore la R.D.A.; dans mon couloir s’entassent environ vingt de ces paquets). Les pages manuscrites, dans leur première, deuxième … version, sont tapées à la machine électrique ; les corrections que je ne fais pas immédiatement avec le ruban correcteur (par exemple celles dont je n’ai vu la nécessité que plus tard), sont ajoutées à la main et au stylo à encre (c’est le dernier contact — libérateur — avec le texte et il ne saurait se comparer aux corrections qui suivront encore, collées sur des morceaux de papier bien découpés : celles-ci appartiennent déjà pour la plupart à une phase de travail d’une autre sorte, à un processus laborieux et presque douloureux qui ressemble plutôt à un commencement).
Je ne peux écrire pour le théâtre que si je sépare d’une façon permanente (et de plus en plus profondément) le théâtre (la scène) de ses besoins. Écrire pour le théâtre, c’est jouir du privilège d’installer un dialogue (je propose des mondes) en tant qu’auteur (libre petit producteur de biens dans mon royaume de liberté relative) avec moi-même (avec la société), dont les contenus, les structures etc., ne sont pas limités par les besoins de l’institution théâtrale. (Mais où le théâtre prendrait-il son impulsion décisive sinon dans le royaume de la liberté ? Rien n’est plus mortifère pour le théâtre qu’une pièce qui comble pleinement tous les besoins du théâtre, car alors tous les besoins satisfaits, il n’en existe plus d’autres.)