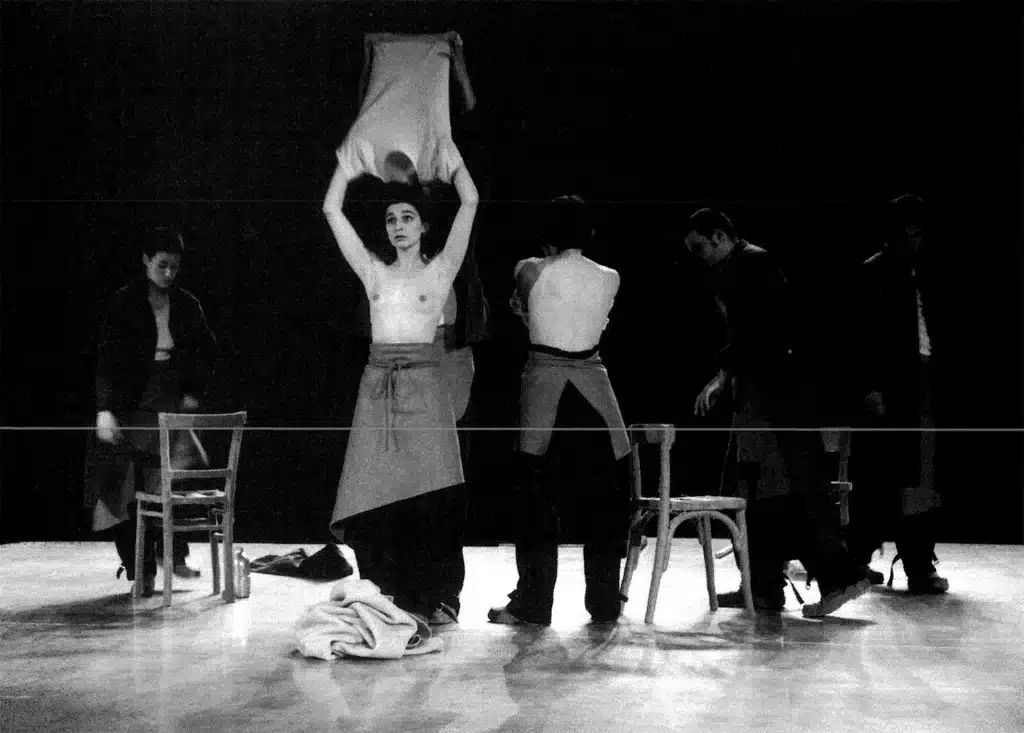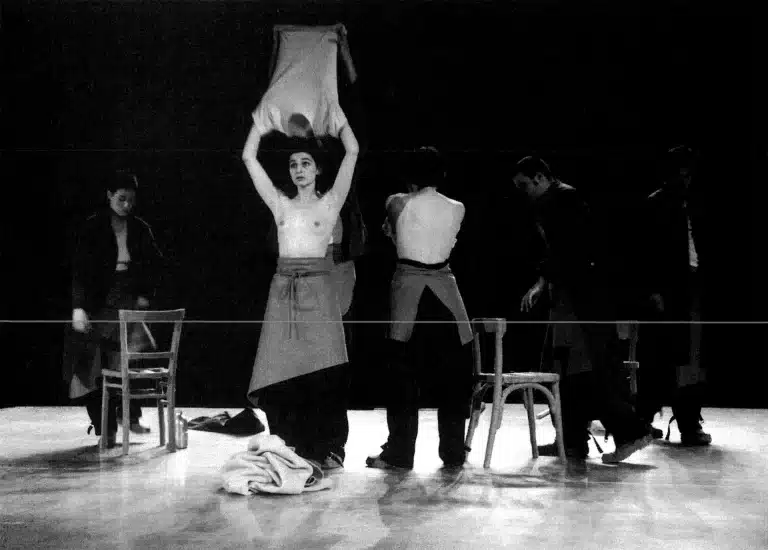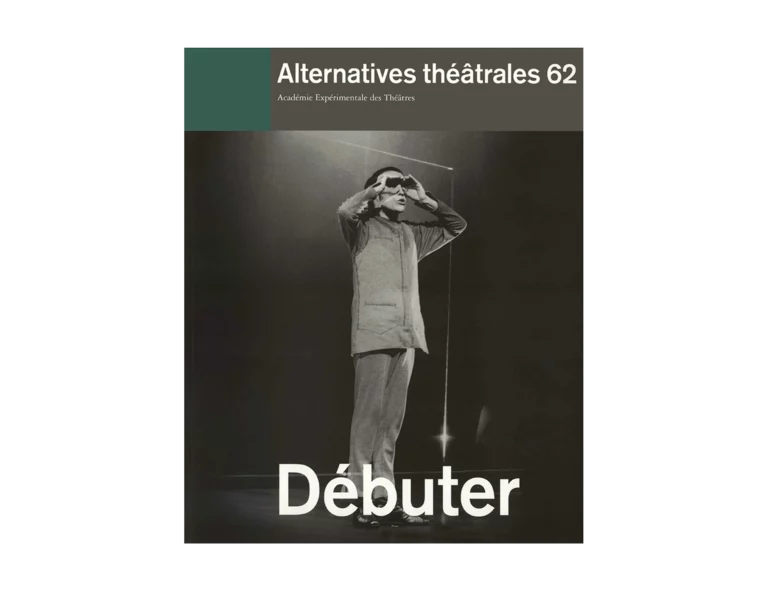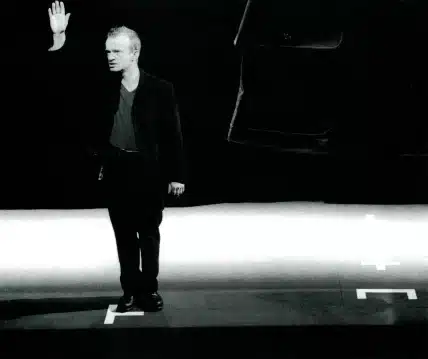GEORGES BANU : Le début est cet extraordinaire événement, décisif dans la biographie de tout artiste, le moment de l’émergence hors de l’obscurité. Le début est un événement fondateur ; le raconter participe à la constitution de l’identité de l’artiste. C’est ce que nous voudrions d’abord proposer de faire cet après-midi aux différents participants de notre table ronde. Et une fois les repères biographiques établis, nous pourrons alors orienter le débat sur la thématique annoncée : le début, émergence et stagnation. Une thématique à nos yeux cruciale, car nous pensons que le destin de tout artiste se joue entre ces deux pôles entre lesquels il ne cesse d’osciller : l’évolution et La stagnation.
N’était-ce pas Peter Brook qui disait : « Ce lui qui reste au même niveau décline » ?
En guise de préambule à notre discussion, je voudrais rappeler la première scène de LA MOUETTE de Tchékhov, la scène fondatrice du début raté de Kostia. Dans cette scène, Kostia
ne demande qu’une seule chose : qu’on veuille bien lui laisser acquérir une identité, celle d’artiste dramatique. Or cette entrée dans le monde du théâtre lui est interdite par ses aînés : sa mère, la grande comédienne Arkadina, et son amant, le célèbre écrivain Trigorine, ne lui accordent pas la moindre chance. Tchékhov nous confronte à cette rupture qui sépare
les gens qui ont déjà acquis une identité artistique, forte et légitime, de ceux qui tentent d’émerger. Les aînés se montrent ici réfractaires à la nouveauté. Il est d’ailleurs remarquable que la seule personne sensible au jeune débutant qu’est Kostia, n’est autre qu’un dilettante, le médecin Treplev, un spectateur ouvert, dénué d’aucun a priori esthétique.
À la fin de la pièce, Kostia émet un jugement sur le nouveau récit qu’il a écrit et que Trigorine n’a pas ouvert : « Voilà, les stéréotypes sont installés, jenefaisqu’utiliserlesmêmes figures que Trigorine. »
On pourrait donc lire Le trajet de Kostia dans LA MOUETTE comme une parabole de ce dont nous voudrions parler aujourd’hui : il raconte le passage de l’émergence à la stagnation et nous permet de prendre la mesure du danger d’immobilisme qui menace un artiste dès lors qu’il s’est imposé.
Mais avant de parler de stagnation, j’aimerais demandera chacun de nos invités ce qui l’a poussé à faire du théâtre. Était-ce le désir de travailler en équipe, de constituer une famille, ou plutôt celui de défendre certains textes, de textes, de donner à entendre la voix de certains poètes ?
Laurent Fréchuret : Le déclenchement s’est produit pour moi un jour de vacances en Irlande, sous la toile d’une tente.Je lisais MOLLOY de Beckett. C’est un roman, il m’a pourtant semblé receler tout ce que j’avais envie de dire au théâtre. Le désir de l’incarner sur un plateau a aussitôt été plus fort que tout.
J’ai réussi à obtenir le droit de l’adapter auprès de Jérôme Lindon, le directeur des éditions de Minuit, à la seule condition de ne pas le montrer en dehors de Saint-Étienne, la ville d’où je viens. J’ai alors fondé ma compagnie, le Théâtre de l’Incendie en 1994, et créé trois spectacles à partir des romans de Beckett : MOLLOY, MALONE MEURT, L’INNOMMABLE. Cette trilogie de quatre heures, que nous ne pouvions pas jouer en dehors de Saint-Étienne a bien sûr été une catastrophe financière. Cela nous a permis de travailler ensuite sur les œuvres de Bernard Noël, Lewis Caroll, Jean Genet, Cioran et actuellement Artaud. Mon geste initial vient dont du désir de faire entendre la voix d’auteurs qui n’écrivent pas spécifiquement du théâtre. L’essentiel n’est pas, je crois, de se demander « est-ce du théâtre ? », mais de se laisser guider par le plaisir, sans jamais chercher à garder le meilleur pour la fin. Connaissez-vous l’histoire du père requin qui veut donner un bon conseil à son fils requin tandis qu’ils regardent le Titanic couler ? C’est : les femmes et les enfants d’abord… Quand on fait du théâtre, ce devrait être la même chose.
Jean Lambert-Wild : Je voulais être marin. C’est raté ! Le théâtre ne m’intéressait absolument pas. Je suis né à l’île de la Réunion, ma terre est loin et tous les lieux où Je vis actuellement ne me connaissent pas. Le théâtre ne m’intéressait pas, mais l’écrivais. Il se trouve qu’un jour, une jeune femme m’a demandé de jouer un de mes textes et de l’aider à le monter. Comme elle
était très belle, j’ai accepté, cout en Comme elle sachant que je ne continuerais pas.
Renaud Lagier qui est éclairagiste et à qui j’avais fait part de ma décision m’a demandé de voir un spectacle de Matthias Langhoff TROIS SŒURS.
Après la représentation, j’ai téléphoné à mon père et je lui ai annoncé que j’arrêtais mes études pour me consacrer au théâtre. Il ne m’a pas excommunié, ce qui est déjà bien. Ce spectacle de Matthias Langhoff a orienté mes choix. J’ai décidé d’apprendre avec des Maîtres.
J’ai été l’assistant de Michel Dubois, Jean-Yves Lazennec, Matthias Langhoff et Phillipe Goyard. Tous ont participé à mon enseignement. J’ai fondé « 326 » avec des gens qui comme moi ont fait ou continuent leur apprentissage avec des Maîtres. Nous allons prochainement travailler une pièce que j’ai écrite SPLENDEUR ET LASSITUDE DU CAPITAINE MARION DEPERRIER — ÉPOPÉE EN DEUX ÉPOQUES ET UNE RUPTURE1 au théâtre Granit à Belfort.
Vincent Goethals : J’ai commencé par faire une maîtrise d’économie à l’Université de Lille, mais j’avais un désir de théâtre que j’ai concrétisé en passant le concours de l’École supérieure de Lille qui n’existe plus aujourd’hui. Après ces trois années d’école, j’ai eu envieide m’implanter dans la région ; car je pense que le théâtre a à voir avec la cité. J’ai alors fondé une compagnie indépendante à Roubaix, la Compagnie « Théâtre en scène ». C’était en 1986, au moment où le Ministère de la Culture avait pris la décision de soutenir les jeunes compagnies. Nous avons donc eu un peu de chance.
Cela fait maintenant treize ans que nous existons ; je ne suis donc plus tout à fait un débutant. Nos efforts d’action culturelle commencent aujourd’hui à porter leurs fruits ; nous avons investi, il y a trois ans, un nouveau lieu plus vaste, toujours à Roubaix, « Le Gymnase ».
En tant que metteur en scène, je me suis intéressé ces trois dernières années à faire entendre les textes d’auteurs vivants, notamment LE CHEMIN DE PASSES DANGEREUSES du québécois Michel-Marc Bouchard. Je conçois le théâtre avant tout comme un lieu d’échanges avec la cité et les poètes, avec les habitants d’une ville et les auteurs vivants.
Marcel Bozonnet : Je suis comédien et directeur du Conservatoire Supérieur d’Art Dramatique de Paris. Je débute aujourd’hui dans le rôle de l’aîné, à la foi Arkadina, la mère qui pousse son fils au suicide et Treplev le spectateur-amateur.
Comme je suis d’une autre génération, j’ai commencé le théâtre en faisant de la récitation : j’ai obtenu le premier prix dans mon canton.Creuser dans cette direction était peut-être un moyen de gagner ma vie. En cela je m’opposais à mon père qui était artisan, mais j’étais soutenu par mes professeurs de français. Je me suis donc accroché à cette idée et j’ai cultivé mon goût pour un langage qui n’était pas celui de tous les jours. J’ai aimé LES PRÉCIEUSES RIDICULES, LE CID, Baudelaire et Verlaine, puis Brecht. J’ai fait du théâtre au lycée et à l’université. C’était l’époque où l’on faisait faire des improvisations héritées de Copeau complètement
dévoyées, du genre:«vous êtes un haricot vert qui pousse ». Mais même en voulant faire le haricot, j’étais plongé dans cet état d’angoisse fascinant qui est devenu l’objet de mon travail. Ce même état d’angoisse qu’il me faut chaque fois vaincre quand j’entre en scène.
Si j’ai consacré ma vie au théâtre, je le dois à mes instituteurs et professeurs, aux associations de la jeunesse et des sports, mais aussi à Victor Garcia, ce grand metteur en scène argentin qui m’a arraché à tout ce que je pouvais désirer qui m’aurait éloigné du théâtre.
Sandrine Charlemagne : Moi, je serais plutôt la cadette : je viens de réaliser mon
premier spectacle autour de trois auteurs et de coupures de presse qui s’appelait SOUS LE SOLEIL D’ALGER.
J’ai fait du théâtre un peu par hasard. L’année de mes vingt ans, mes errances, mes « bourlingues » de nuit m’ont un jour menée au cours de théâtre de Véronique Nordey que j’ai fréquenté plusieurs années. J’ai ensuite suivi six ateliers à la Plaine Saint-Denis auprès de Jean-Claude Fall. La rencontre avec les jeunes de Saint-Denis, mon propre rapport au métissage — je suis à moitié algérienne — m’ont donné l’envie de créer une association, de monter une petite compagnie, la compagnie « Espace Temps », et de travailler autour de l’Algérie, donc de renouer avec mes racines, mais aussi de témoigner de ce qui se passait là-bas.
Si je fais du théâtre, c’est peut-être pour sortir du marasme dont le livre2 que j’ai publié témoigne, mais aussi pour libérer les oppressions qui naissent des choses que l’on voit au quotidien. Ce qui m’attire, c’est Le paradoxe qui sous-tend le théâtre où le concret se mêle à la poésie.
Armel Veilhan : Mon désir de théâtre est lié à celui de sortir de la solitude que mes études de pianiste m’imposaient : j’ai fait du théâtre parallèlement à mes études de piano dès le lycée avec mes camarades de l’atelier théâtre. Nous nous sommes peu à peu constitués en un groupe et avons continué à faire du théâtre en dehors du cadre scolaire. Ce groupe est devenu en quelque sorte une famille de substitution, la mienne partant en décomposition.
Et puis, à un moment donné, j’ai décidé de fermer le couvercle de mon piano et de ne faire que du théâtre. J’avais alors la certitude que l’on pouvait vivre une utopie collective, il suffisait de le vouloir. Nous avons alors fondé une compagnie dirigée par Françoise Merle. C’était en 1984. Je suis resté dans une relation de compagnonnage avec cette femme pendant dix ans. C’est là que j’ai tout appris. À la fin de notre aventure commune, en 1994, Françoise Merle a écrit un texte qu’elle m’a dédié, ESTELLE.
Je l’ai mis en scène avec le désir de prolonger autrement ce que m avait offert le chéâtre dans l’adolescence : une échappée hors de la solitude, une ouverture sur un possible. J’ai travaillé sur ce spectacle à Marseille avec deux comédiennes et j’ai découvert ce que procurait la mise en scène : le pouvoir d’écrire avec le corps des autres. Pendant les deux années suivantes, j’ai travaillé comme comédie ne écrit une pièce ON A TOUS ENVIE DE PLEUREr ROULE TRAIN NE S’ARRÊTE PAS À AVIGNON.
J’en ai fait une lecture à des comédiens, puis nous l’avons travaillé dans un petit lieu rue de la Roquette pour en faire un spectacle que j’ai présenté à Choisy-le-Roi grâce à Patrice Bigel.
Je prépare aujourd’hui un troisième projet TANGUY d’après Michel del Castillo que nous présenterons également à Choisy-le-Roi en janvier prochain.
Sophie Perez : J’ai commencé le chéâtre dans l’enfance en faisant des spectacles pour mes parents le dimanche. Par la suite, les différentes formes artistiques se sont enchainées : dessin, peinture, musique, théâtre et claquettes…
Le théâtre est pour moi un espace décalé où j’essaye de raconter une vision intime d’un monde. Dans cette écriture plusieurs disciplines visuelles qui sont liées à mon parcours se mêlent.
Pour mon premier projet de mise en scène, je Suis partie d’un texte qui n’est pas un texte de théâtre, puisqu’il s’agit d’une méthode pour apprendre à nager sans eau, écrite en 19323. J’ai travaillé avec un mélange de comédiens professionnels et d’autres qui ne l’étaient pas : le professeur de natation du spectacle, par exemple, est un ancien comique de l’Alcazar, qui n’avait plus joué depuis longtemps. Il devait être sur un plongeoir d’un mètre soixante-cinq, mais il avait le vertige, il fallait donc l’entourer de praticables pour qu’il puisse dire son texte. Tout ça pour dire que cout projet de théâtre est une aventure quotidienne, aussi pitoyable soit-elle… elle doit finalement se raconter de façon spectaculaire !
Pascale Siméon : J’ai une formation de comédienne, j’ai fait le Conservatoire, puis travaillé quelques temps avant d’avoir envie de porter un regard extérieur sur le jeu. Alors que je suis venue à Paris pour Jouer, Je suis repartie en Province pour monter des spectacles.
C’est à Clermont-Ferrand que j’ai créé en 1996 L’HOMME CLOS de Jean-
Pierre Siméon et récemment UN SAPIN DE NOËL CHEZ LES IVANOV d’Alexandre Védenski.
Mes projets naissent de rencontres avec des textes. Après les avoir lus, les donner à entendre est pour moi une nécessité.
Clyde Chabot : Je me sens dans un rapport d’étrangeté avec le théâtre. Car j’ai fait de longs détours avant d’y arriver. Cela me conduit à imaginer des projets singuliers qui interrogent cet art.
Après des études à Science-Po, je me demandai comment agir dans le monde au présent. C’est ce que j’essaye de faire aujourd’hui avec le Théâtre comme outil. J’ai exercé divers métiers à la périphérie du théâtre. C’est la rencontre avec François-Michel Pesenti dont je suis devenue l’assistance à la mise en scène qui m’a permis d’entrer dans l’espace de répétition, dans le temps de la création. Au cours d’un stage de mise en scène encadré par Robert Cantarella, j’ai pris conscience que ce qui m intéressait, c’était moins d’affirmer mon point de vue sur une pièce que de mettre en forme théâtrale et ludique mes doutes de metteur en scène. Je voudrais emmener le spectateur au cœur de la fabrique théâtrale, lui faire découvrir les fulgurances de la création comme ses errances.
Ce qui me passionne aussi, c’est d’écrire un spectacle à partir de la personne réelle des acteurs, être au plus près d’une vérité que je perçois d’eux. Et de plus en plus, élargir l’écoute du côté des spectateurs, de ces paroles anonymes, inventer des principes de rencontre. Préparer des machines humaines dont je choisis Les lois mais qui ne peuvent exister sans la participation effective des gens.
Dans ma dernière création intitulée UN PEU DE POUSSIÈRE DE CHAIR, LA NUIT, après la visite d’un petit musée du spectacle, le public assiste à ma mise en scène d’un texte de Yann Allégret. Il est ensuite invité à proposer des directions de jeu sur quelques extraits de la pièce. L’acteur, un violoncelliste, l’auteur et un vidéaste répondent aux propositions des spectateurs. La soirée se termine par une discussion avec le public autour de l’expérience vécue.
Olivier Besson : J’ai fait mon premier spectacle en 1994, c’était L’INTRUSE de Maeterlinck au Théâtre des Amandiers de Nanterre et je viens de réaliser cette année mon quatrième À QUOI RÉVONS-NOUS (LA NUIT)? un spectacle réalisé à partir de récits de rêves qu’on avait collectés pendant plus d’un an.