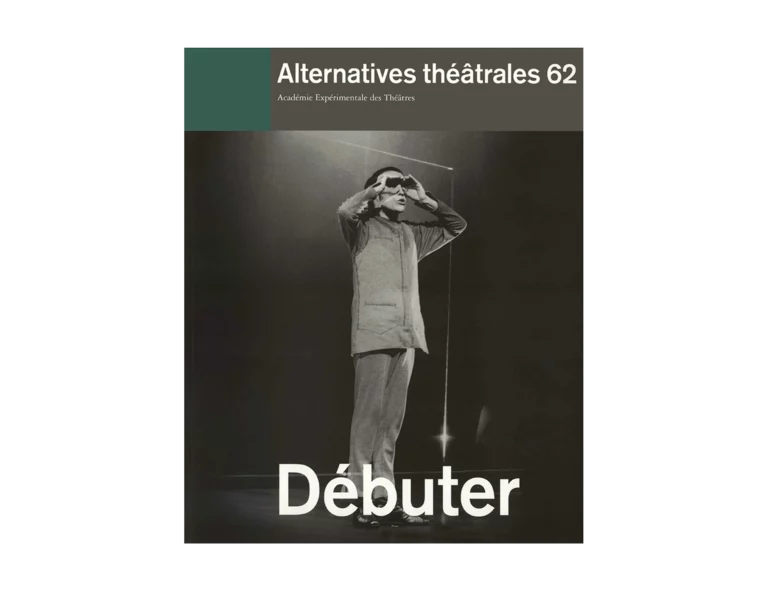GEORGES BANU : Le début de votre travail en tandem coïncide avec la constitution d’une compagnie, la Compagnie Deschamps et Deschamps en 1979. Vous formez donc une troupe.
Jérôme Deschamps : Il n’y a rien de pire que les troupes telles qu’elles se constituent dans les Centres Dramatiques : une structure administrative engage des acteurs sous contrat pour deux ou trois ans ; dès qu’on parle avec eux, on sent qu’ils s’ennuient profondément. Cette organisation administrative va à l’encontre du plaisir et du désir. Aussi, avec Macha, nous avons toujours fait en sorte de ne pas nous organiser de cette façon : les acteurs peuvent partir quand ils le veulent. Ec s’ils sont là depuis quinze ans, c’est peut-être parce qu’ils y trouvent du plaisir.
G. B.: On dit souvent que « la vérité est dans le début ». Or à l’époque où tous faisaient un théâtre très sérieux, très engagé, tu fais le spectacle BLANCHE ALICATA, qui est une parodie de mélodrame.
J. B.: Je trouvais ce spectacle assez sérieux aussi.
G. B.: Mais c’était un travail sur des formes inhabituelles à cette époque.
J. B.: Blanche Alicata était la femme qui s’occupait de Dominique Valadié quand elle était petite, et qui faisait aussi le ménage chez elle. Je ne l’ai jamais connue. Et j’aimais l’idée d’inventer un spectacle qui soit un hommage rêvé rendu à cette femme, et de le raconter avec presque rien : une bassine jaune, une table à repasser, des chaises, un bout de ficelle et un vieux gant de toilette. En fait, c’était assez grave comme idée :on avait mis en scène tous ses rêves, celui de partir en Espagne, de se marier un jour, de repasser les Pyrénées … Ils se mêlaient au quotidien et contrastaient avec lui : elle parlait de l’Espagne et puis il y avait le lait qui débordait. C’écait un geste que j’ai tout à fait pris au sérieux, comme quelque chose de grave et d’important.
G. B.: Avant BLANCHE ALICATA, il y a eu un autre spectacle BABOULIFICHE ET PAPAVOINE. Peut-être pourrions-nous l’évoquer ?
J. B.: Au moment où Vitez s’installait à Chaillor, il lui a été demandé de faire un spectacle pour enfants, un spectacle gratuit qui puisse tourner dans les écoles. Ce spectacle, je l’ai fait avec Jean-Claude Durand. Nous l’avions tiré d’un livre, une espèce de bande-dessinée de 1905 qui racontait que deux pauvres types, Baboulifiche et Papavoine, avaient fait un voyage sur la lune mais que personne n’en avait jamais rien su. J’étais très énervé par les spectacles pour enfants abominablement bêtifiants de l’époque et je voulais faire le contraire : qu’il y ait, par exemple, plein de mots que les enfants ne comprennent pas, parce que, quand on est petit, on est intéressé par tout ce qui, justement, n’est pas fait pour soi. C’était en plus un spectacle très violent, j’avais quelques comptes à régler avec les écoles. Les enfants ont parfois réagi avec force, voulant à leur tour desserrer le carcan que l’école leur imposait. Ce qui n’était pas pour me déplaire !
G. B.: Macha, tu mets en scène des objets déclassés. Cette expression renvoie à Tadeusz Kantor mais aussi à Marcel Duchamp. Vous inscrivez-vous dans cette famille ?
Macha Makeieff : Certainement, mais en tout cas pas consciemment. Jérôme et moi, nous ne faisons pas de dramaturgie a priori. Les objets qui n’ont pas d’autonomie artistique ne m intéressent pas. Si nous parlons de certaines choses, c’est parce qu’elles nous semblent brûlantes, de l’ordre de l’émotion, pas de la référence culturelle. Il est vrai que j’ai des cousins : j’ai beaucoup fréquenté les œuvres de l’Arte Povera, par exemple. Au moment du premier spectacle de Jérôme, moi je projetais de monter un spectacle sans acteurs, avec seulement des objets, des bruits, de la lumière. Je pensais déjà, maladroitement, qu’il y avait une force poétique, une violence contenue dans ces objets réprouvés. Nous avons cherché ensemble, Jérôme et moi, à trouver un équilibre entre les objets et les acteurs, à raconter le destin des uns et des autres, ce compagnonnage-là.
G. B.: C’est grâce à Antoine Vitez que je vous ai découverts. Il appréciait énormément votre travail. Quel rôle a‑t-il joué dans vos débuts ?
J. D.: Je ne voudrais pas avoir l’air de raconter la belle histoire du type élevé à Neuilly qui rencontre une jeune femme éprise d’Arte Povera, et qui décident ensemble de faire des spectacles pour aussitôt connaître le succès. Nos débuts ont été difficiles. Le projet de LA FAMILLE DESCHIENS1, les responsables du Jeune Théâtre National n’y croyaient pas. J’avais un parcours de théâtre qui s’appuyait beaucoup sur le verbe et sur les pièces aux côtés de Patrice Chéreau, Jean-Pierre Vincent, ou d’Antoine Vitez à la Comédie Française, et tout d’un coup, j ai eu envie de rendre compte de ce que je voyais dans le regard des gens assis sur une chaise devant leur maison, dans le Morvan, qui ne parlent plus et disent pourtant des choses. J’avais envie de montrer ces gens-là, d’en découdre avec le public et avec un théâtre que je trouvais étouffant. Mais pour le faire, j’ai eu besoin d’alliés, et c’est vrai qu’Antoine Vitez a été peut-être notre premier allié, le premier à nous faire confiance. Aussi étrange qu’il puisse paraître une étroite complicité me liait à Antoine Vitez. C’était dans la vie, un type très drôle, avec qui j’ai passé des heures à imiter Pierre Touchard2 ? ou des hauts responsables du Parti Communiste. Il a été pour nous un soutien essentiel, plus moral que financier d’ailleurs, mais c’est celui-là qui importe le plus.
M. M.: Antoine a senti notre détermination insolente à l’égard de certaines pratiques théâtrales et nous a encouragés à nous en tenir toujours à ce regard-là, singulier. Antoine Vitez m’a permis de monter mon premier spectacle, pour enfants, à Ivry avec Jeanne Vitez. Puis j’ai suivi les répétitions de PARTAGE DE MIDI. Avec quelle intelligence il organisait la règle du jeu de chaque répétition ! J’ai appris de lui à suivre cette règle avec humilité et entêtement, à considérer aussi notre travail comme un objet artistique autonome, à prendre la distance nécessaire qui évite d’être paralysé par le doute ou la confusion des émotions.
Il m a appris aussi à ne mettre sur le plateau que l’indispensable. Je me rappelle surtout sa ferveur ! Monter sur le plateau était un geste sacré !
J. D.: Quand j’ai monté BLANCHE ALICATA avec Dominique Valadié, je faisais du théâtre depuis déjà dix ans dans de bonnes conditions professionnelles. Or ce spectacle, on l’a joué au Théâtre Daniel Sorano à Vincennes devant quelquefois deux personnes ; et pas les vendredis, parce qu’il fallait laisser la place à l’auto-école. Mais s’il y avait peu de monde, je me souviens de la qualité de l’émotion que j’ai ressentie : c’était exactement ce dont j’avais rêvé quand j’étais petit et que je disais que je voulais faire du théâtre. C’est à ce moment que tout s’est décidé pour moi, porté par l’élan que créait le petit nombre de gens qui nous ont soutenus. On avait l’impression de livrer une vraie bataille pour le théâtre. Je me souviens qu’à Orléans, ils avaient oublié d’annoncer notre spectacle, on devait jouer LES OUBLIETTES, on est arrivés le dimanche matin pour jouer le jour-même : dans la salle de onze cents places, il y avait huit spectateurs, des passionnés de théâtre qui avaient poussé la porte du théâtre ce dimanche-là. Eux ec nous ne nous sommes pour ainsi dire jamais quittés ; la relation qui s’est créée était tellement forte. Ces expériences nous ont aussi donné l’envie de sortir des réseaux du théâtre, de partir à la découverte d’autres publics, à l’étranger notamment. On a tourné dans toute une série de petits festivals en Italie et en Autriche. Gratz, on a Joué sur une scène de 800 personnes entre deux concerts de rock. Cette confrontation, nous l’avons voulue. Elle nous a définitivement vaccinés contre le chemin habituel, le « cursus institutionnel ». Il ne s’agissait pas pour nous de nous battre contre les institutions, mais d’inventer d’autres façons d’en être les partenaires.
G. B.: C’est pourquoi vous n’avez jamais voulu avoir de lieu fixe mais rester nomades ?