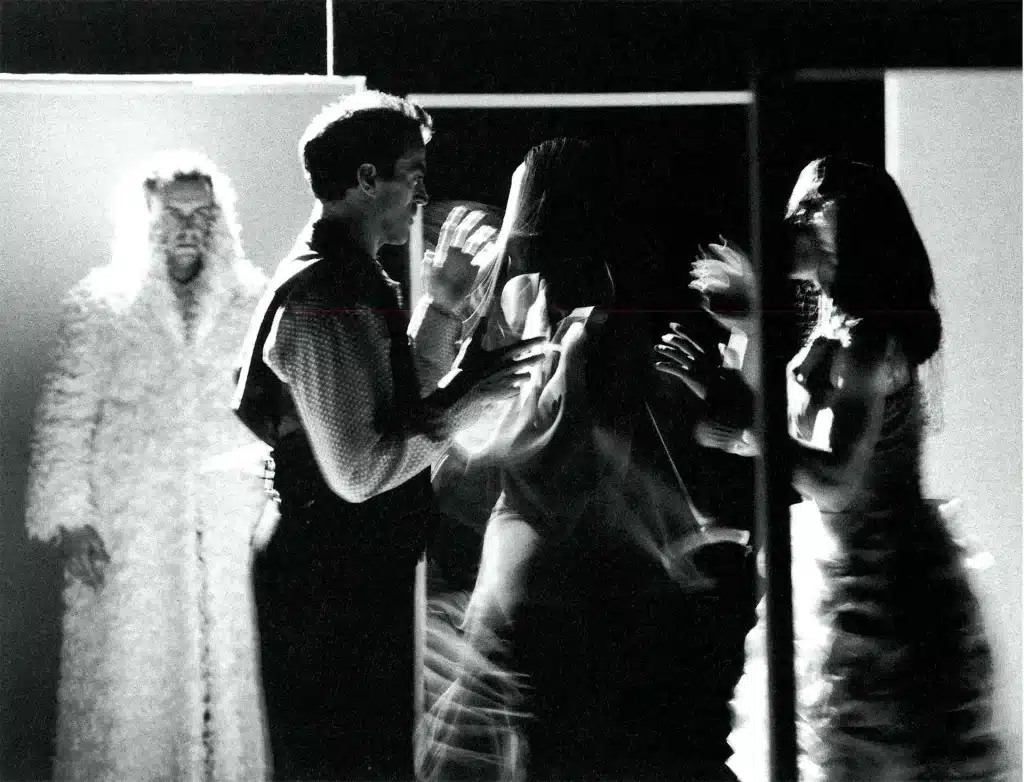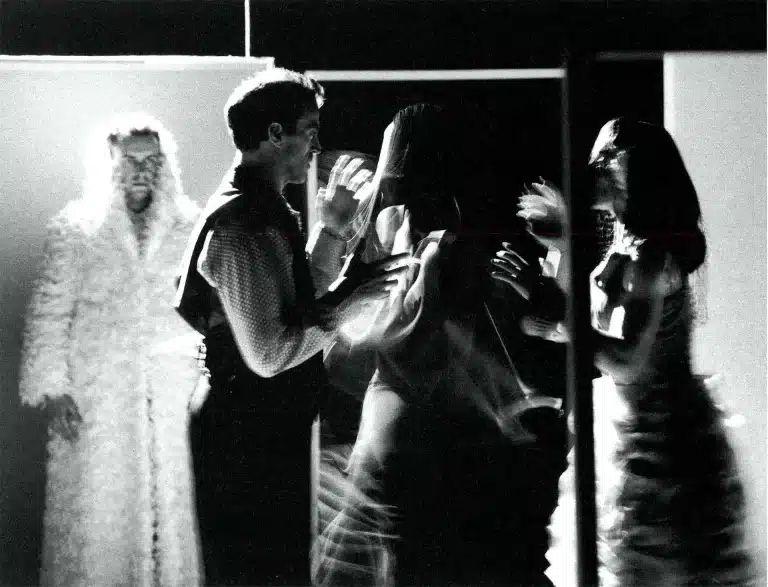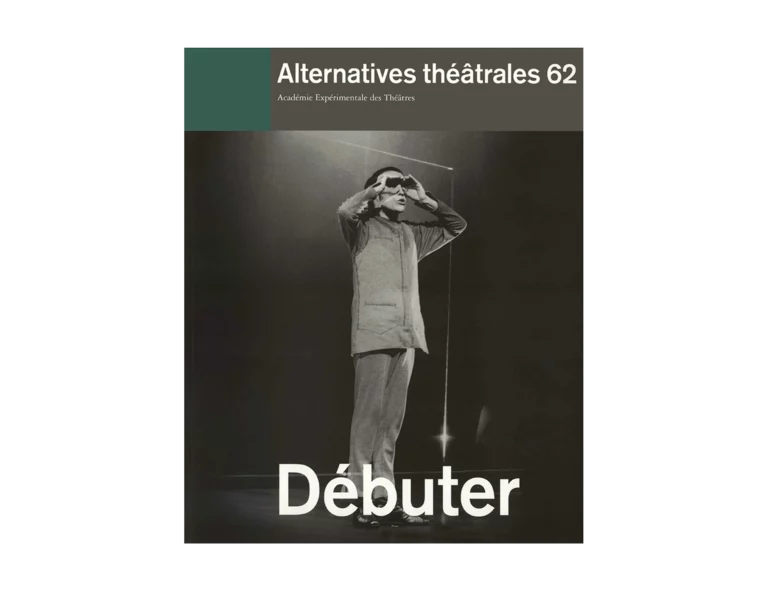BRUNO TACKELS : Quand tu vois le premier ou le deuxième spectacle d’une compagnie qui débute, quels sont les critères qui dictent ton choix ? Qu’est-ce qui te fait dire : « je veux les aider à continuer leur travail » ?
Nicole Gautier : Le critère qui me guide, c’est d’abord un style, une idée originale, une personnalité singulière. Cette personnalité, elle se remarque de façon plutôt intuitive, soit par le choix d’un texte, soit par le travail d’une forme, ou un mélange de formes, soit par une interrogation précise sur notre siècle. Quand je vois Benoît Bradel revisiter l’œuvre de John Cage ou Michel Jacquelin questionner l’histoire de l’art sur un plateau de théâtre, je sens qu’il y a un vrai souci de recherche et d’invention. À l’inverse, je ne supporte pas les « photocopies », comme dit Claude Régy, ou les travaux qui revisitent un classique dans le but, avoué ou non, de s’inscrire dans les programmations. C’est assez rare que les jeunes metteurs en scène réussissent à relire avec bonheur les textes. classiques. J’ai l’impression qu’il faut de la bouteille pour y arriver, une vraie expérience durable avec des acteurs et une réflexion profonde sur le théâtre. Bien sûr il y a une tradition théâtrale qui provient de l’Université ou de l’École. Normale Supérieure, essentiellement attentive aux textes classiques. Je suis bien plus attirée par les metteurs en scène qui questionnent directement le plateau, pour le transformer et l’altérer, un peu comme in peintre fait vivre sa toile. J’attends du théâtre qu’il en appelle à notre imaginaire, comme Bruno Meyssat ou Hubert Colas. C’est ce que j’ai aimé chez Gabily. Même s’il travaillait sur les mythes, il savait les bouleverser par son écriture et les ranimer par son esthétique, par la force du jeu de ses comédiens. Quand je l’ai rencontré, avec VIOLENCES, pour ma première saison à la Cité Internationale, il n’était pas un débutant quant au travail, mais c’était comme un deuxième début qui lui permettait d’accéder à un nouveau cercle de reconnaissance.
B.T.: Est-ce que tu pourrais définir plus précisément le schéma de ces différents cercles d’appartenance. Comment s’articulent-ils entre eux ? Et comment s’y insèrent les metteurs en scène qui débutent ?
N.G.: En fonction du lieu où l’on travaille, il existe plusieurs cercles concentriques liés aux moyens financiers qui se rencontrent difficilement. On le voit bien au festival d’Avignon, avec le double régime du « in » et du « off ». On le voit sur le plan national, où l’on trouve le réseau des Centres dramatiques, celui des Scènes nationales fortement dotées, celui des Scènes nationales moins bien dotées, celui des théâtres conventionnés et bien d’autres. Ces différents réseaux sont différenciés par leur emplacement géographique, à Paris s’il ou en province. En fonction du lieu où travaille la compagnie, elle n’obtiendra pas le même degré de reconnaissance. Le passage d’un cercle à un autre se fera d’autant plus vite que la compagnie sera bien accompagnée administrativement et médiatiquement. Le parcours du metteur en scène joue aussi un rôle important dans cette évolution. Par les rencontres qu’il aura pu faire, il sera guidé plus ou moins vite vers des lieux qui reconnaîtront son travail. Et puis il y a des contextes de fabrication nouveaux, comme le travail de rassemblement d’artistes qu’a pu faire l’Académie Expérimentale des Théâtres de Michèle Kokosowski, ou bien ces jeunes metteurs en scène issus du Conservatoire et qui travaillent autour de Josyane Horville, grâce à la structure du Jeune Théâtre National. Dans les deux cas, ce sont des espaces de transmission et de rencontre avec des maîtres du théâtre, des lieux. d’apprentissage et de reconnaissance.
B.T.: Est-ce que tu tiens compte de cette dimension biographique du metteur en scène quand tu choisis de travailler avec une compagnie ?
N.G.: Absolument. Quand j’étudie un dossier, je suis très attentive à la formation du metteur en scène, et aux partenariats qu’il a suscités. Je me pose toujours cette question : Qui a fait quoi avec qui ? Il n’y a pas de génération spontanée, il faut être attentif aux processus de filiation, même s’il existe des exceptions. Certains metteurs en scène n’ont pas eu de formation très repérable et proposent malgré tout un travail singulier qui donne envie de les aider.
B.T.: Parmi les jeunes compagnies qui débutent aujourd’hui, est-ce que tu.-perçois des nouvelles questions, ou de nouvelles manières de poser les questions qui les rassembleraient, et par lesquelles ils se ressembleraient ?
N.G.: J’ai l’impression que les compagnies qui démarrent aujourd’hui se rassemblent peu et se ressemblent peu. Peut-être au nom de la concurrence, ils vivent sur un mode plutôt éclaté. C’est d’ailleurs ce que je recherche comme programmatrice : la singularité et l’originalité d’un metteur en scène. Cet individualisme est positif et constructif s’il est corrigé par la capacité de cet individu à gérer un groupe, à s’entourer d’une équipe qui devienne une véritable cellule de fabrication et de réflexion. Dans mon esprit, la programmation du Théâtre de la Cité Internationale n’a pas pour but de révéler le meilleur metteur en scène de la décennie. Sa mission, plus modeste mais non moins essentielle. est de proposer un lieu de vie pour les artistes, qui soit vraiment ouvert à un public. J’attache beaucoup d’importance a ces moments de rencontres, où s’exerce vraiment l’«art d’être spectateur », où se fourbissent les outils qui vont lui permettre de lire, de recevoir le travail et de comprendre l’écriture scénique des spectacles.
B.T.: Pour que le théâtre devienne un vrai « lieu public », pas plus que le directeur, le public n’a à dicter à l’artiste ce qu’il souhaiterait voir.
N.G.: À partir du moment où j’ai donné mon accord à un metteur en scène, puisque je ne suis pas au quotidien la mise en scène, je n’ai pas à dire mon mot. Je suis juste une sorte d’« inspecteur des travaux finis ». Je peux lui renvoyer des impressions, des éléments d’analyse, mais je n’ai en aucun cas le droit ou la possibilité d’agir sur ce qui se fait. Agir, cela voudrait dire être assistante ou dramaturge. Par contre, outre le coup de cœur pour un metteur en scène et son travail, j’observe préalablement comment il travaille, avec qui et de quelle façon il réunit son équipe. Sinon, on peut se faire piéger par la séduction d’un projet bien présenté sur le papier, mais que le metteur en scène ne saura pas traduire sur le plateau, en harmonie avec son équipe.
B.T.: Pour aller chercher ces nouveaux projets qui sont dans l’ombre, il est important de travailler en commun avec les autres programmateurs. Comment a lieu ce travail collectif
de mise en réseau ?
N.G.: Il est très important pour moi d’interroger mes collègues, en particulier les directeurs des Scènes nationales, pour connaître les projets qu’ils défendent. Par mon travail à la Cité Internationale, je suis dans une sorte d’entre-deux, entre la découverte et la reconnaissance, entre les premiers débuts et la « consécration » nationale. Mon objectif, un peu comme l’âne qui porte le prophète, est de choisir des projets pertinents et de leur trouver à la fois un public et une reconnaissance. Cette tâche est facilitée par la position géographique de mon théâtre, à Paris intra-muros. Mais en même temps mon travail est compliqué par le fait qu’à Paris, il est toujours très difficile de conquérir un public sur une durée d’un mois. Et puis la grande diffculté, qui est assez nouvelle, c’est la croissance exponentielle du nombre de jeunes compagnies. Du coup, j’ai l’impression que chaque lieu résout la question en s’attachant les services de « sa » jeune compagnie, L’espace d’aventure des lieux est souvent limité par le contexte local et l’expérience des directeurs. Cela dit, je ne crois pas qu’il y ait de talents méconnus en France. Le réseau de visibilité est cel qu’on ne peut rester totalement méconnu, même s’il y a le risque d’être usé avant d’être reconnu. Ensuite, la vraie question est de savoir comment on réussit à montrer son travail à Paris, dans de bonnes conditions, sur une durée assez longue et malgré une situation financière souvent précaire. C’est là que le projet du Théâtre Gérard Philipe apporte réellement un vent d’air frais, parce qu’il y a un vrai partage de l’argent. Dans mon théâtre, je ne peux malheureusement pas proposer ce type d’apport financier massif aux compagnies. On est tous confrontés à cette nouvelle démocratisation de l’accès au théâtre pour de plus en plus de débutants, avec les effets pervers de cette politique qui nous oblige à accueillir de plus en plus de projets, sans en avoir vraiment les moyens.
B.T.: Est-ce que tu crois que l’absence de moyens empêche systématiquement le travail des compagnies ? Est-ce que la force d’un metteur en scène ne vient pas aussi de sa capacité à faire avec les moyens ou les non-moyens qu’il a ? Ce n’est pas forcément l’accumulation des moyens qui rend possible un meilleur travail.
N.G.: Bien sûr, même s’il ya malgré tout un niveau en dessous duquel il ne faut pas tomber. La vraie difficulté est de pouvoir assurer la présence d’une grosse équipe, avec beaucoup d’acteurs sur le plateau.
B.T.: Si je regarde l’ensemble des metteurs en scène que tu as invités (la liste est impressionnante), on remarque un champ très ouvert, avec des esthétiques très différentes, voire antinomiques. Ce n’est plus seulement une constellation, c’est plutôt une vraie voûte étoilée. Le point commun, au fond, c’est qu’ils sont venus au Théâtre de la Cité Internationale au moment où ils démarraient — après leur premiers débuts et avant une reconnaissance plus large.
N.G.: Oui, c’est vrai, même si je n’ai jamais posé les choses en ces termes : « je choisis cette compagnie parce qu’elle débute ». Le vrai critère de mes choix tient dans cette attention aux formes singulières et innovantes. Cette politique de choix s’explique aussi par la position du théâtre de la Cité. Même si c’est un peu ma pente naturelle, je m’interdis de couvrir le champ, de la façon la plus large et la plus éclectique possible — ce serait intenable dans le paysage parisien. Du coup, je ne privilégie pas le rapport au texte, qu’il soit du répertoire ou contemporain. Au fond, ce que j’aime, c’est le théâtre qui s’ouvre, se mélange aux autres formes artistiques et qui se trouve transformé par ces rencontres inattendues avec la musique, la danse, la vidéo ou les arts plastiques. Par ailleurs je m’intéresse beaucoup à la danse
qui s’ose aux mots… aux spectacles inclassables,
B.T.: Quand on parle des débuts d’une compagnie, vient nécessairement la question de la fidélité…

N.G.: Oui, il faut savoir être fidèle, mais pas pour toujours, sinon le directeur vieillit avec sa programmation — c’est un vrai danger qui guette bon nombre d’entre nous…