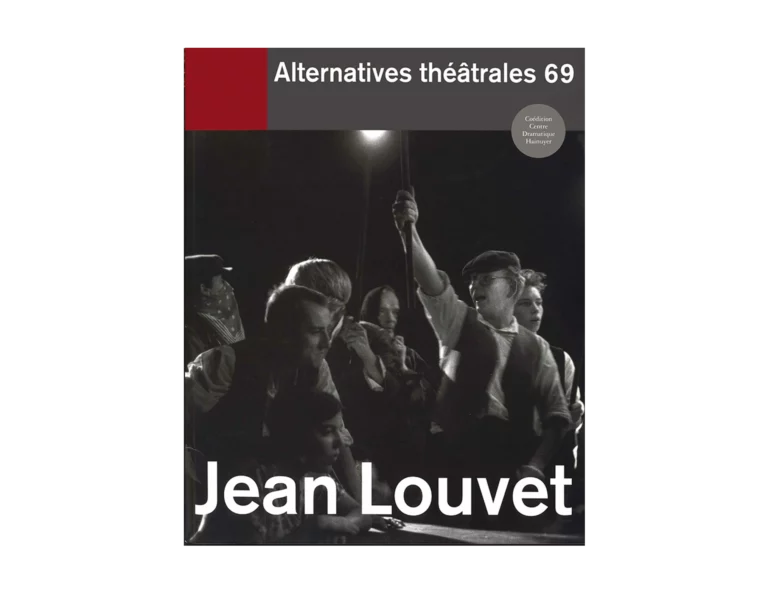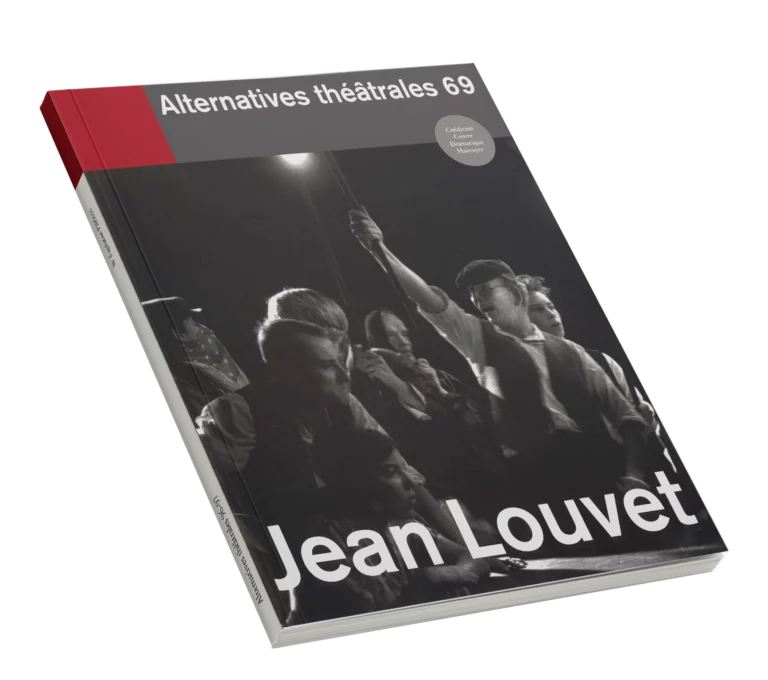DE JEAN LOUVET, il y a ce qu’on dit, ce qu’on écrit. Il y a ce qu’il dit. Louvet parle, Louvet est parlé. Mais ces voix sonnent, à les entendre de près, comme un écho déformé. Proche de l’archétype de l’écrivain engagé, Louvet est porteur d’un discours, d’une vision de la société dans laquelle il vit. Auteur d’une œuvre, le voici au Conseil national d’art dramatique, titulaire d’une Chaire de poétique à l’Université Catholique de Louvain, président de la Société des Auteurs Dramatiques, interlocuteur du Prix Nobel de Littérature, Gao Xingjian, révélateur de la conscience ouvrière à l’usage des jeunes générations … Guère de débat croisant art et politique où il ne soit sollicité, pas de réflexion sur l’identité wallonne sans sa participation. Louvet ressemble à un porte-parole, l’écrivain incontournable d’une communauté qui le contourne cependant quelque peu.
Louvet parle et est parlé. Loin des protagonistes brechtiens, un personnage se crée, un type plutôt naturaliste, le produit d’une classe, d’un milieu social. Étrangement, au fil du temps, une sorte de métadiscours s’est élaboré qui, peu ou prou, ne dit que l’importance de Louvet. Célébrer Louvet, comme le signifiant protéiforme d’un signe qui ne renverrait à rien d’autre. Une attitude qui génère une plus-value symbolique ou qui fait l’économie du sens, l’économie de la confrontation.
Mais, de Louvet, il y a ce qu’on ne dit guère : pourquoi, mis à part L’AN I en 1963, jamais de pièce au Théâtre National de Belgique, pourquoi seulement deux pièces au Varia, pourquoi, forte d’une telle célébration, cette œuvre n’est-elle pas davantage présente sur les « grandes » scènes ? Célébré, Louvet reste malgré tout décentré. Très tôt, il est édité en France (aux éditions du Seuil), il rencontre des figures du théâtre international comme Hélène Weigel ou Bernard Dort, travaille avec les personnalités du Jeune Théâtre en Belgique (Marc Liebens, Philippe Sireuil, Michèle Fabien, Jean-Marie Piemme)… Dans le même temps, il ancre sa compagnie de théâtre-action à La Louvière, s’engage sur le Manifeste pour une culture wallonne, écrit sur commande (notamment de la Région Wallonne et de l’Institut Jules Destrée pour LE COUP DE SEMONCE). Louvet adhéra au Parti Socialiste Belge, s’en fit exclure, s’engagea dans le Parti Wallon des Travailleurs, fut candidat aux élections législatives, resta délégué syndical tout en critiquant les structures, s’approcha du trotskisme, s’en écarta… Il prend la parole dans Toudi (revue dirigée par son ami José Fontaine), dans Les Cahiers Marxistes, dans le Bulletin de la Fondation André Renard… Pour affirmer et revendiquer une identité wallonne, pour forcer sa reconnaissance puis, sa connaissance.
Avec la fédéralisation de la Belgique, le discours évolue. Si une des revendications se trouve satisfaite par l’instauration des régions, l’entité représentée par la Communauté française constitue, aux yeux de Louvet, un nouveau frein à l’émancipation wallonne : « Ce qu’il faut aujourd’hui, c’est un acte fondateur entre la Région wallonne et la Région bruxelloise, qu’elles se mettent d’accord pour revoir la Communauté française. Après cet acte politique, chaque région verra ce qui lui revient, de quoi elle a besoin, et elles pourront décider quelles sont leurs ressemblances, qu’il faut affirmer, et quelles différences il faut marquer. Revoir la Communauté, ce n’est pas s’affaiblir vis-à-vis du mouvement flamand comme disent certains. C’est, au contraire, devenir beaucoup plus forts vis-à-vis de nous-mêmes, en commençant par se connaître soi-même. Jusqu’à présent, le saisissement de ce que nous sommes n’a pas eu lieu. Les Wallons n’ont pas opéré cette mutation nécessaire au niveau de l’enseignement, de l’histoire, de la culture, des médias. »1
Une prise de parole directe et directement politique qui rencontre une veine régionaliste très circonspecte quant à la Flandre. La résonance symbolique de l’œuvre a‑t-elle souffert, dans certains lieux, des prises de parole de son auteur ? Ce n’est pas impensable tant il est vrai que revoir le partage du « gâteau culturel » entre la Wallonie et Bruxelles redistribuerait forcément des cartes …
L’œuvre, toutefois, ne devient pas tribune politique. Art du collectif, art de l’immédiateté, de la simultanéité de la prise de parole et de sa réception, le théâtre, paradoxalement, intéresse Louvet par le biais du regard. Voir et être vu s’apparentent, dans l’univers louvetien, à une attestation d’existence.
Conquérir le droit au regard devient un enjeu social voire historique. Car ce combat est aussi une tentative pour s’inscrire dans le temps.2
Ainsi, LE SABRE DE TOLÈDE met en scène un acte du regard toujours un peu voisin du voyeurisme. Inspirée d’un livre de photographies sur les logements sociaux, la pièce décline, en une série de tableaux, différentes postures du regard. De la séance de diapositives en famille aux photographies d’intérieurs en passant par le récit de faits divers, une forme d’imaginaire social prend sa source dans un jeu de points de vue. Photos de voyages, de communion, traces du passé, clichés inévitables, le texte souligne le statut très codifié de l’image dans certaines couches sociales. Le façonnement du regard aussi. Un regard qui veut capter, figer dans Le temps et l’espace, y fixer ce qui, toujours, s’en échappe ou ne semble pas y avoir de place. Comme si le corps prolétarisé n’avait pas de rapport immédiat à lui-même, l’image (du photographe ou de l’auteur) le fait advenir. En différé. De ce décalage résulte toujours une perte, une désillusion, la mélancolie du théâtre de Jean Louvet. Car l’effet naturaliste de la photographie est un leurre, il tend à faire croire que ce que nous voyons là — ces visages, ces intérieurs — est de toute éternité, immuable, universel.
En réponse, intervient alors le discours. Les mots de Louvet créent une distance qui vient perturber l’illusion mimétique. Loin du commentaire, le texte sans cesse souligne, accentue les clichés du monde ouvrier. Il crée ainsi un imaginaire critique où se trouve mis en question le caractère caricatural des usages de cette classe sociale et Le travail de réification qui s’opère à son égard. Non, vous ne me dérangez pas : vide, latence, béance, disponibilité à ce qui vient, absence à soi-même, attestation de l’infinie supériorité de l’autre, celui qui est ailleurs et qui existe. Norme et contrôle intériorisés, aucune révolte n’est possible : On a fait son devoir. Par son caractère heurté, syncopé, le discours brise net l’évidence pour laisser surgir la violence. Violence faite, subie : tout qui s’amenuise, s’efface et ne sait pas qu’il l’accepte. Là où le regard échoue à révéler l’existence des zones d’ombre du social sinon sous la forme de clichés, l’écriture insuffle le mouvement, découvre les processus. L’homme éludé, gommé, prend alors corps en plusieurs dimensions. Car, au delà de la déconstruction d’innombrables formes d’aliénations — dont la tentation de la bourgeoisie qui hante le prolétariat ou le terrorisme de la science — il reste inéluctablement une part d’utopie dans le théâtre de Louvet.