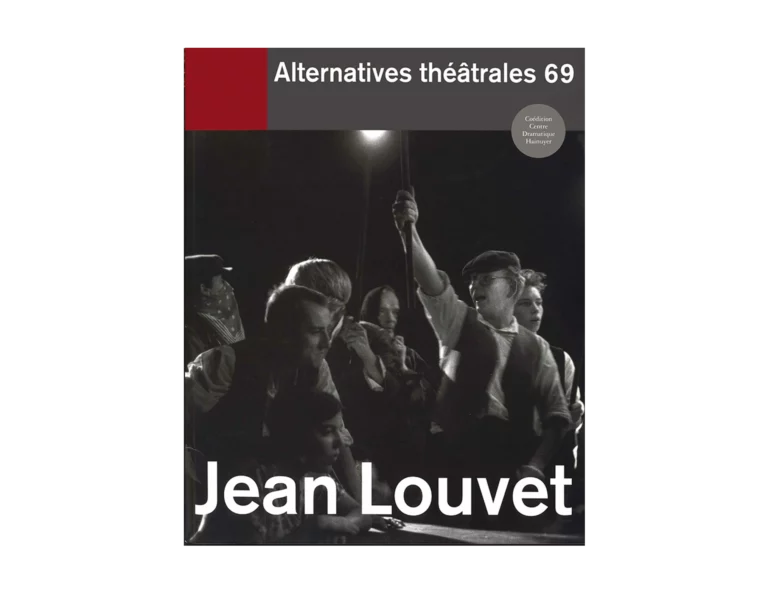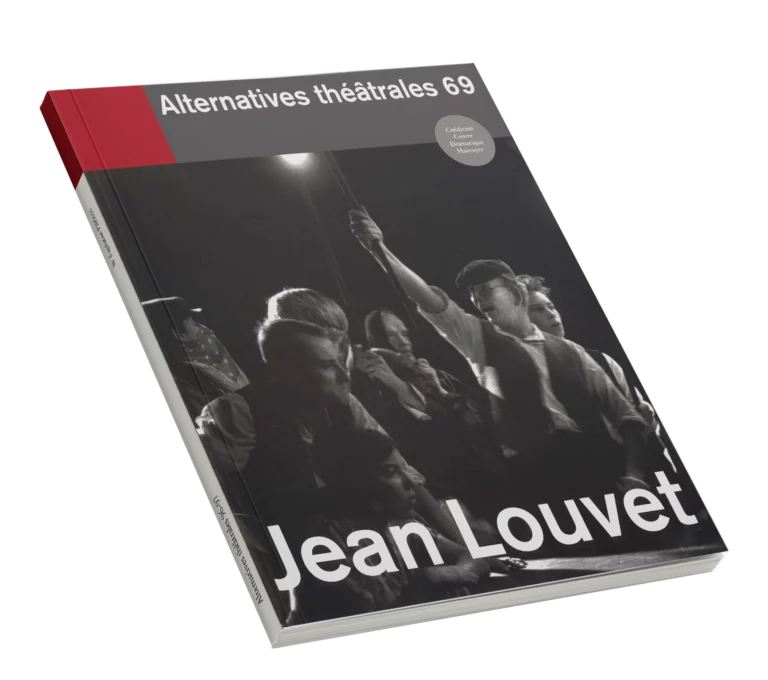NANCY DELHALLE : Comment êtes-vous entré en contact avec l’œuvre de Louvet et comment avez-vous été amené à monter deux de ses pièces, UN HOMME DE COMPAGNIE et SIMENON ?
Armand Delcampe : Dès 1975, dans les Cahiers Théâtre Louvain, j’ai publié LE TRAIN DU BON DIEU, la première pièce de Louvet. Je le connaissais donc par les écrits, mais comme nous sommes de la même région, j’allais aussi voir son travail au Théâtre Prolétarien. Il travaillait à la façon des Lehrstuck brechtiens. Avec Beno Besson, j’assiste à la mise en scène de Marc Liebens de CONVERSATION EN WALLONIE. Je choisis quelques acteurs de la pièce dont Janine Patrick et Christian Léonard pour jouer dans LE CERCLE DE CRAIE CAUCASIEN. En 1994, UN HOMME DE COMPAGNIE est annoncé au Théâtre National de Belgique mais ne sera pas créée, je la monte à L’Atelier Théâtre Jean Vilar. Je créerai également SIMENON, une commande faite à Louvet mais qui n’avait pas été mise en scène. Ensemble, les deux spectacles ont accueilli 22 000 spectateurs en six mois ! Or, ces deux pièces ont été refusées partout, sabotées partout. Les idées de Louvet ne sont pas susceptibles de plaire aux Catholiques ni à la droite libérale et surtout pas au Parti Socialiste dont il pointe la trahison. En outre, Louvet n’est pas un poète institutionnel. C’est un prolétaire et chez le prolétaire, quelque chose ne plaît ni à la bourgeoisie ni à la petite bourgeoisie.
N. D.: Cet été, vous mettez en scène CONVERSATION EN WALLONIE. L’ancrage historique de la pièce est important. Elle se situe aux lendemains de la seconde guerre mondiale, il y a cinquante ans. La manière de parler des classes sociales, leur représentation est donc marquée historiquement. Comment le metteur en scène travaille-t-il ces signes qui renvoient à un moment historique précis des classes sociales ouvrière mais aussi petite bourgeoise et aristocratique ?
A. D.: CONVERSATION EN WALLONIE est un projet sur les origines et sur l’historicité : quelle est cette classe sociale qui a rampé et qui a la volonté de propulser ses enfants « de la cave au grenier », ces mineurs de fonds qui faisaient un travail d’esclave aujourd’hui heureusement disparu. La pièce est un témoignage sur l’aristocratie ouvrière, sur ces gens qui n’avaient aucun espoir pour eux mais qui envisageaient un bout de tunnel pour ceux qui les suivaient, pour leur descendance. Ils ont tout fait pour instruire : l’apprentissage, le savoir sont des grandes idées du XVIIIᵉ siècle qu’ils concrétisaient. Ainsi, après la libération, des gens emmenaient des gosses de la classe ouvrière voir de grandes œuvres. Cela peut passer aujourd’hui pour du boyscoutisme, du vilarisme. Mais cette action de générosité a été remplacée par du vent. D’ailleurs, le recteur de l’Université Catholique de Louvain confirme que le nombre d’enfants de prolétaires à l’université a baissé. La notion de progrès permanent, idée laïque héritée du XVIIIᵉ siècle, est aujourd’hui un leurre : on manipule des statistiques, on remplace les vrais emplois par des faux. À tout moment, le progrès jouxte la barbarie.
CONVERSATION EN WALLONIE est un témoignage qui se prolonge dans notre époque. La question de la sécurité de l’emploi est omniprésente dans la deuxième partie de la pièce. La problématique du savoir, de l’apprentissage comme facteur d’émancipation est aussi très actuelle. Aujourd’hui, le défaitisme se répand : les diplômes ne garantissent plus l’emploi. Or, le savoir, le développement de la conscience est la seule arme dont on puisse disposer contre l’exploitation capitaliste. Sous prétexte que les emplois sont rares et que la qualification ne sert à rien, il ne faut pas que les « petites gens » cessent d’étudier. La pièce est plus actuelle que jamais : l’apprentissage, le courage, l’éducation civique sont des valeurs qu’il faut continuer à maintenir coûte que coûte.
N. D.: CONVERSATION EN WALLONIE met aussi en lumière tout un gestus de la classe ouvrière wallonne. Ce qui est relativement inédit dans notre théâtre. Cela ne donne-t-il pas à la pièce une grande spécificité ?
A. D.: Après 40 ans de métier, avec CONVERSATION EN WALLONIE, j’ai pour la première fois l’impression de travailler dans mon peuple et dans ma langue. C’est notre réalité que la poésie de Louvet revitalise. La pièce me paraît d’une plus grande proximité que certains textes du répertoire qui ramènent à des réalités vécues car, chez Louvet, la proximité est également créée par la langue. Louvet a porté l’usage régional, local au rang d’exemple. Cette proximité vient se combiner avec un témoignage sur le mode de vie d’il y a cinquante ans qui, lui, manifeste une rupture de civilisation.
L’électricité, l’eau courante, n’étaient pas aussi « normales » qu’aujourd’hui. Or, celui qui ne sait pas d’où il vient ne sait pas où il va ni qui il est. Cependant, le témoignage historique va plus loin encore. Mon père, mineur de fond, arraché de l’école en 1918 pour travailler et nourrir sa famille, a permis à ses enfants de faire des études supérieures.
Les pièces de Louvet devraient être toutes montées et remontées : elles sont un témoignage essentiel sur ce qu’est ce pays. Ce théâtre correspond à une définition de Brook : le théâtre c’est la merde et le ciel. Chez Louvet, la condition humaine, l’aliénation voisinent toujours avec la possibilité pour l’homme de se redresser, avec l’espoir. Ce n’est pas parce qu’un homme est humilié, que ses études sont méprisées, qu’il doit rester à quatre pattes. C’est aussi une question de courage. Ainsi, j’assimile CONVERSATION EN WALLONIE à une tragédie : ce déracinement, le fait d’être propulsé de la cave au grenier est assez douloureux.
Jonathan, ce professeur, passé par l’université, ne sait plus d’où il vient ni qui il est. Son écartèlement est très grand. À l’époque, il existait pour les enfants d’ouvriers des bourses appelées « bourses du fonds des mieux doués ». La rupture avec les parents telle qu’elle est montrée dans la pièce se passait réellement : c’est cela aussi le déracinement. Ce sacrifice des parents pour instruire leurs enfants ne signifiait pas que les enfants devenus « clairvoyants » voyaient clairement leur destinée. En ce sens, l’aveuglement de Jonathan est celui d’Œdipe ou d’Hamlet. Il ne sait pas comment s’en tirer, il est écartelé. Il est chargé de culpabilité, des reproches de sa mère sur ses vêtements fripés ou ses enfants délaissés.
CONVERSATION EN WALLONIE est une grande œuvre sensible. Dans la mise en scène, il faut essayer de trouver le son humain et éviter les sons creux. Il faut résister au piège naturaliste, à la tentation de « faire vrai » et travailler sur le réalisme magique. Par exemple, les costumes auront une historicité même si celle-ci est inventée. Mais Louvet est aussi économe de signes que Brecht : il faut choisir plutôt qu’accumuler pour « faire vrai ». Il ne faut pas non plus tirer la pièce vers le mélodrame : les personnages ont une grande force et une grande pudeur.
Un autre piège à éviter est celui du folklore. Cette absence de dimension folklorique nécessite de la part du metteur en scène un choix rigoureux quant à l’instrumentation des accessoires, la transparence des lieux. Bien sûr, le théâtre est tissé de « signes » mais metteur en scène et acteurs se doivent de réinventer et de privilégier « la vie ».
N. D.: La structure de la pièce rompt avec l’évolution chronologique et recèle une grande complexité formelle : mélange des temporalités, simultanéité du réalisme et de la fantasmagorie. Notre tradition théâtrale ne dispose guère de formes auxquelles se référer pour parler de notre identité. À quelles recherches la pièce conduit-elle ?

A. D.: C’est un texte polyphonique et polysémique. Louvet crée du théâtre simultané comme au Moyen Âge ou comme le théâtre épique. On y retrouve la polyvalence des lieux, le glissement d’une réplique sur l’autre. En outre, dans cette pièce, tout le monde entend tout le monde, les murs sont traversés, abolis. Louvet adapte sans cesse la langue, la notairesse ne parle pas comme Jonathan. Cette recherche crée un faux naturalisme et engendre un certain surréalisme. Louvet est un poète, il a la faculté de convoquer le père, vingt ans après, pour avoir avec lui les quelques phrases qu’il n’a pas eues. Le père a vécu comme une bête et n’a pas reproduit avec son fils cette fatalité des coups et des morsures. Là nous sommes dans la catharsis. Louvet descend dans ses propres profondeurs et y cherche la vérité. Pourtant, il n’est guère complaisant, le narcissisme est absent de cette œuvre. Louvet entrelace la psychologie des profondeurs et le biotope capitaliste dans lequel nous vivons.