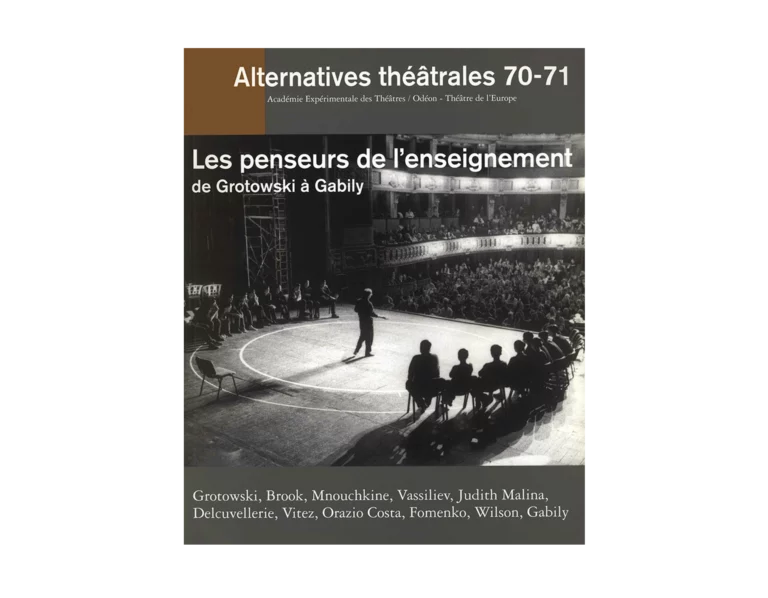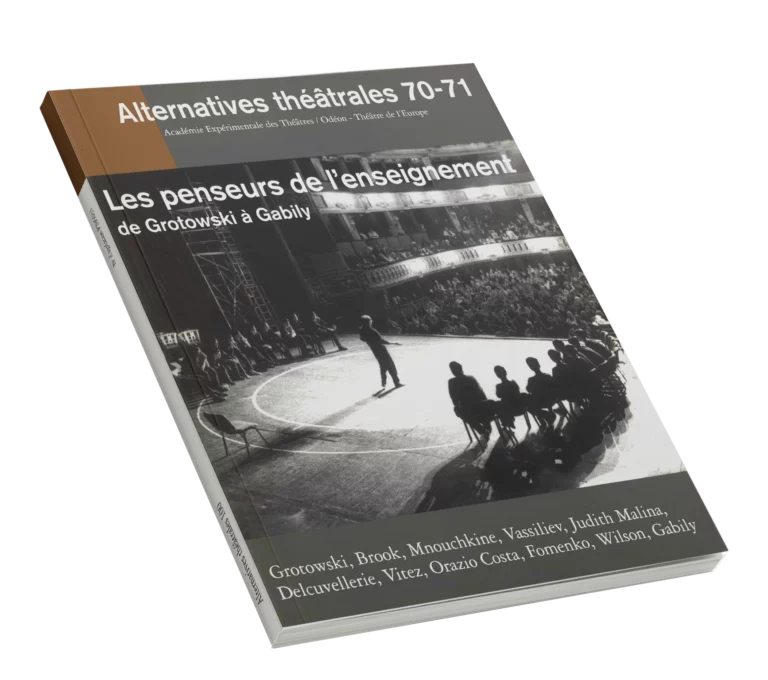GEORGES BANU : Tu dis souvent : à propos du Théâtre du Soleil « Nous nous mettons à l’école … de la Commedia dell’Arte, de l’Orient … Cette volonté de se mettre à l’école d’une forme apparaît comme un motif récurrent qui témoigne du désir d’accéder, grâce à l’expérience de formation, à quelque chose d’autre, enrichissant. Est-ce que cette volonté de se mettre à l’école est liée à ton propre intérêt, à la nécessité du travail du groupe ? Car, au fond, le groupe, dès le début, s’est mis à l’école du théâtre, tout seul. Quelle est la place de cette exigence d’école — non pas d’une école institutionnelle, mais de l’école des grandes formes ?
Ariane Mnoutchkine : Ou des grands maîtres ! On disait cela aussi pour Shakespeare, pour Eschyle, ou Euripide … Je pense que c’est une certaine idée du bonheur, l’école, l’apprentissage. J’ai une hantise : l’idée que l’école serait finie, que l’on devrait attendre de moi que je sache, et qu’il n’y aurait donc plus d’aventure, qu’il n’y aurait plus ce continent mystérieux encore non découvert, ou en tout cas toujours à redécouvrir, qu’est pour moi le théâtre. Au fond, je me suis reposé la question d’une façon un petit peu oppressante, et je crois que lorsqu’on dit « On se met à l’école », ce n’est pas du tout par modestie. C’est très ambitieux ; quand on dit qu’on se met à l’école de Shakespeare, quelle arrogance ! Cela veut dire essayer de comprendre, génie mis à part, comment il travaillait, comment il a fait pour raconter son temps, pour faire du théâtre … C’est la même chose avec tous les grands poètes de la scène. Et c’est la même chose avec les grandes formes, quand on se met à l’école de la Commedia dell’Arte, à l’école d’une forme. Cela veut dire qu’on va essayer de découvrir une forme, de la prendre comme des enfants : comme un outil beaucoup trop lourd pour nous, et tenter de comprendre comment, avec cet outil, on peut faire quelque chose non pas de semblable à ce que permet cet outil dans un pays ou un continent donné, mais dont l’universel de ce qu’il permet de faire va peut-être nous être un peu révélé, découvert. Donc, quand le Théâtre du Soleil dit : « On se met à l’école », je crois que c’est pour s’engager dans une aventure dangereuse — psychologiquement, affectivement, artistiquement, et matériellement parfois. Ce n’est pas du tout de la modestie, c’est peut-être une certaine humilité, quand on y arrive, mais je crois que cela vient d’un esprit d’aventure.
G. B. : D’une certaine manière, se mettre à l’école, c’est aller dans des continents que vous ignorez, que vous allez explorer, toi et l’équipe, et que vous allez ensuite intégrer dans votre propre pratique ?
A. M. : Ces continents inexplorés ne sont pas forcément toujours des continents du globe terrestre ; ils peuvent être aussi, évidemment, des continents intérieurs, que nous aurons à reconnaître.
G. B. : Une chose assez importante, et peut-être peu connue, est qu’à un moment donné, quand le Théâtre du Soleil s’est constitué, vous vous êtes retirés plusieurs mois aux Salines d’Arc-et-Senans pour travailler, pour constituer votre culture de groupe. Est-ce qu’on peut assimiler la formation avec la pédagogie du groupe ?
A. M. : Nous n’en savions rien. En réalité c’est qu’on voulait passer des vacances ensemble. C’était tout de suite après mai 1968, tout explosait de partout et on s’est rendu compte que si on restait inertes dans cette espèce d’effervescence, admirable mais aussi stérilisante d’une certaine façon, on n’avancerait pas. Une chance inouïe a fait qu’on a trouvé cet endroit miraculeux : les Salines d’Arc-et-Senans, qui est une cité du soleil, inachevée, construite par Nicolas Ledoux. À l’époque elle était presque en ruines et, si je me souviens bien, le Conseil général allait la rénover, mais, Dieu merci, ce n’était pas encore fait. On nous a donc permis de passer nos vacances là-dedans, on nous a donné des lits d’hôpitaux, ils ont été très gentils avec nous, et on a passé deux ou trois mois dans cet endroit plus qu’inspirant pour un groupe. Mais on ne savait pas du tout que quelque chose de déterminant allait se passer pour nous, c’est-à-dire qu’on allait avoir l’audace de décider que nous allions faire ce qu’on appelait alors de la création collective. On a décidé qu’on allait créer un spectacle sans auteur, dont nous serions les auteurs, ce qui allait être LES CLOWNS. On s’est plongé complètement dans la Commedia dell’Arte, dans le peu que nous en connaissions, et on a commencé à nager, à perdre le Nord. On avançait sans boussole le plus souvent, et peut-être est-ce indispensable, peut-être que pour nous c’était indispensable. Il fallait — et il faut toujours — des comédiens extrêmement courageux pour accepter de travailler sur un bateau qui parfois n’a pas de boussole, qui navigue en suivant une étoile. Donc, voilà ce qui s’est passé ; quand on est allé aux Salines, on ne savait pas que cela se produirait, on pensait que l’on allait passer des vacances un peu studieuses, à faire beaucoup de gymnastique, et, comme nous le disions pompeusement, à travailler les masques. Mais le problème, c’est que ce sont les masques qui ont commencé à nous travailler. Je me souviens encore, de même que certains de ceux qui étaient aux Salines à ce moment-là, de moments de tremblements : c’étaient des tremblements physiques, vraiment, à la fois de peur et de joie, en voyant de petites choses qui commençaient à apparaître sur le plateau, de petites naissances, donc des reconnaissances. Naissances non seulement des bébés acteurs que les comédiens étaient à l’époque, du bébé metteur en scène que j’étais moi-même, mais aussi moments où tout d’un coup on se disait : « Je ne sais pas pourquoi, mais ça c’est du théâtre », sans pouvoir vraiment définir cela et pourquoi cinq minutes plus tôt cela n’en était pas du tout. Il y avait beau y avoir des mots, des mouvements, un masque, une soi-disant situation, des soi-disant émotions, il n’y avait pas de théâtre, et tout d’un coup, sans qu’on sache pourquoi, à l’apparition de l’un ou de l’une, pas plus calé que celle ou celui qui avait précédé, mais simplement tout d’un coup doué de cette capacité d’apparaître et d’être, il y avait du théâtre, et on avait la chair de poule, et parfois les larmes aux yeux, ou on hurlait de rire à se rouler par terre. Donc on était en plein mystère, on se comportait comme des apprentis sorciers — on est toujours des apprentis sorciers, je crois, au théâtre. Il arrivait quelque chose, il nous arrivait des choses. Et peut-être que ce qu’on apprend, au fond, ce qu’il faut apprendre, c’est ce qu’on appelait, au bout d’un moment, « écraser l’oiseau ». Tout d’un coup il y avait un oiseau qui arrivait, l’oiseau du théâtre, quelque chose de très fragile qui venait et qui se posait sur l’épaule d’un acteur, d’une actrice ou d’un groupe d’acteurs ; le théâtre était là, et il fallait à ce moment-là apprendre et ne pas vouloir trop, peut-être même ne pas vouloir du tout, Ne pas vouloir. C’est probablement une des choses qu’on a apprises. Cela ne veut pas dire qu’on était capables de le faire, parce que je pense que ne pas vouloir est vraiment une des choses les plus difficiles, mais je crois qu’on en a pris conscience, qu’on a pris conscience qu’il fallait être comme … des écuelles magiques ! Des contenants. Je ne sais pas du tout si c’est déjà aux Salines que je me suis rendue compte de cela, mais probablement, quand même, la naissance de cette conscience est venue là, même si ni moi, ni les comédiens qui étaient avec moi n’arrivions à le formuler à ce moment-là.
G. B. : C’est un phénomène du XXe siècle que certains groupes, comme le Théâtre du Soleil ou d’autres, ont assuré leur propre formation sans aucun maître, c’est-à-dire sans quelqu’un de l’extérieur. D’une certaine manière, tu t’es improvisée en metteur en scène, les acteurs t’ont suivie et …
A. M. : Ils se sont improvisés …
G. B. : Ils se sont improvisés acteurs, et cette formation par soi-même est peut-être un des phénomènes les plus originaux du XXe siècle. On retrouve toujours la même situation, à savoir que le metteur en scène, ou le leader, le leader effectif comme on l’appelle, fait appel à des savoirs empruntés ici et là pour « bricoler » en quelque sorte un processus de formation.
A. M. : Je ne suis pas sûre que ce soit tout à fait vrai, même si, effectivement, puisqu’on était très jeunes, on était en réaction contre tout le monde, et rien n’était suffisamment intéressant pour nous servir de maître — pensions-nous, et au fond c’était évidemment faux … Je pense quand même, même si on définira le mot maître après (c’est un mot compliqué), que les quelques mois que j’ai passés chez Jacques Lecocq, ont extraordinairement compté, parce que, lui aussi, il me faisait apparaître des choses que, probablement, j’étais prête à recevoir. Je ne dis pas que je n’étais pas déjà attirée par une certaine forme de théâtre, mais quand, dans les classes de Lecocq, tout d’un coup, avec un jeune étudiant ou une jeune étudiante de théâtre, il y avait des moments où Arlequin était là, ne serait-ce que pendant dix secondes — parfois cela ne dépassait pas dix secondes, mais ces dix secondes vous changent un homme ou une femme, parce que tout d’un coup on se dit : « Voilà, c’est ça que je veux, je ne veux pas d’autre voie que l’intensité que je viens de ressentir à ce moment là, avec ce garçon ou cette fille qui n’a presque encore rien fait, mais, parce que la parole de Lecocq était juste, parce que le masque était juste, parce que tout d’un coup il y avait un moment de vérité, le théâtre et son exigence étaient là ». Après ça, on ne peut plus supporter les diseurs de mots. Lecocq m’a rassurée, il m’a confirmée dans ce que je sentais confusément : que le théâtre, ce n’était pas seulement dire des mots en costumes sur une scène, c’était bien plus que ça. Je pense que par Lecoq, je comprenais Chaplin, par Lecocq je voyais la différence entre ce qu’est vraiment un acteur ou une actrice et ce qu’est un imposteur, ou un diseur de mots, ou un blablateur, quelqu’un dont le corps ne raconte rien, dont la quête intérieure n’est pas profonde.
G. B. : Est-ce que, justement, dans cette découverte que vous avez faite, toi et l’équipe du Soleil, à ce moment-là, l’improvisation, le fait d’agir dans une situation de liberté absolue, a été un outil pédagogique pour vous ? Est-ce que vous vous êtes formés un peu à l’école de l’improvisation ?
A. M. : Pour nous l’improvisation a été un outil essentiel, et ça l’est toujours, même quand on monte des textes. Quand on a décidé, ce fameux jour aux Salines, qu’on allait faire une création collective, et quand on a continué pendant plusieurs années, je pense, au fond, que c’est comme cela qu’on s’est préparé aux grands auteurs. Donc, oui, j’ai l’impression qu’il ne peut pas y avoir de formation sans improvisation.
G. B. : Est-ce que l’improvisation est le premier niveau de la constitution du groupe, est-ce la mise à l’épreuve ?
A. M. : Non, je crois que le premier niveau de la constitution du groupe c’est qu’on rêvait d’être ensemble. Quand un groupe de jeunes gens et de jeunes femmes décide de faire du théâtre, ce qui est en question n’est pas seulement la forme théâtrale, à laquelle ils ne connaissent rien : c’est aussi un choix de vie. Je ne vais pas utiliser des mots pédants ou redondants, mais c’est un choix politique, c’est un choix d’idéal, choix idéaliste — pour ne pas dire idéologique. C’est un choix, et donc la façon de travailler découle aussi de ce choix. C’est très difficile. Une bande d’amis qui s’aiment, même s’ils se séparent après, qui vivent une amitié très profonde, des amours très intenses, une enfance — à 20 ans — commune, une aventure, cela n’est pas séparable de la forme de théâtre qu’ils vont choisir ou qu’ils vont chercher. Je sais que ce n’est pas tout à fait dans le vent en ce moment, ce genre de déclaration, mais je ne peux pas vous faire croire que le spectacle que nous faisons aujourd’hui (ou hier, ou demain), n’est pas complètement irrigué du fait que le choix a été, quand même, le choix d’une troupe. Cela n’a pas été une autre façon de faire du théâtre, cela a été d’abord ce choix-là. Ensuite, et c’est là que je dis que ce n’est pas vraiment modeste, nous nous sommes dit, « on va essayer de comprendre comment raconter notre temps dans le théâtre, c’est-à-dire comprendre Shakespeare, Molière, Brecht » … rien que ça ! Dire que nous pensions que notre devoir, notre mission — encore un mot modeste — c’est de jouer ces gens-là, tout d’abord parce que si on ne les joue pas on ne sait pas ce que c’est que le théâtre, ce sont eux qui nous apprennent tout. Jouer ces gens-là, mais aussi, quitte à se taper la tête contre les murs pendant cinq, six, huit mois, essayer de raconter notre temps par le théâtre, avec un théâtre aussi théâtral que ce dont nous venons de parler. Donc, c’est très mélangé, et il faut que vous sachiez d’où je viens. Je viens de ce rêve-là, j’ai toujours ce rêve-là, et je me dis qu’au fond quand j’arrêterai, que ce soit parce que je serai frappée par la mort ou parce que je me dirai « Ah, Ariane, là, le sac est vide, il faut arrêter », je ne rêverai plus ce rêve-là, avec tout ce qu’un rêve suppose de secousses, de bosses, de plaies, de nez qui saignent, de déceptions. Il y a quelque chose dans le théâtre, qui fait que, selon moi, c’est une des dernières aventures ; une troupe, une vraie troupe, c’est une des dernières aventures humaines à vivre. Je vous dis cela parce que j’espère qu’il y en a parmi vous qui ont l’idée de fonder une troupe : faites-le et n’écoutez pas les esprits désenchantés qui vous disent le contraire.
G. B. : La formation de la troupe, chez toi, passe aussi par le quotidien partagé. Le fait que les comédiens vivent ensemble, qu’ils préparent la nourriture ensemble, c’est une dimension extrêmement importante pour toi. Comment le quotidien t’a-t-il aidé à constituer la troupe ; Quel a été son rôle ? Est-ce que les gens qui font partie de la troupe perçoivent cela comme une sorte d’engagement moral par rapport à celle-ci ?
A. M. : Cela dépend des moments. Il y a des moments où ils le perçoivent comme moi, comme un jeu de vie, un jeu comme une vie, et je pense qu’il y a des moments où ils le perçoivent comme une corvée épouvantable, et se disent : « Ah, si je pouvais être à l’Odéon, arriver une heure avant le lever du rideau, partir tout de suite après, sans avoir à me préoccuper de rien, parce qu’il y a des techniciens parfaitement compétents qui font tout ». Je pense qu’il y en a — presque tous — qui passent par de tels moments, qui disent : « Je n’en peux plus » ; à ce moment-là, pour tenir bon, il faut un entêtement particulier. Mais je crois que je l’ai dit suffisamment : je pense qu’un certain type de théâtre et la façon dont il est produit, cela n’est pas séparable. Dans les années 60 – 70, on disait qu’un spectacle produit dans de telles conditions, se ment à lui-même. Je ne veux pas employer des termes aussi idéologiques, mais il y un petit peu de vrai dans cela. Dans une aventure comme une troupe, il faut aussi apprendre la vie, apprendre le théâtre et apprendre à vivre ensemble, apprendre à regarder, à échanger, à s’indigner ensemble, à ne pas se suffire de s’indigner en mots mais s’indigner en actes aussi, et voir comment à chaque instant se confronter à cette question terrible et délicieuse qui est : « Mais comment ça se met en art, tout ça, comment est-ce que ça se raconterait ce que je viens de lire ou ce que nous venons de découvrir » : des choses que vous lisez dans les journaux … Cette question : « Comment je peux faire ? Comment se raconter au théâtre ; Où elle est, la métaphore qui renvoie à quelque chose d’autre ? ». Je pense que si dans la vie de tous les jours, la vie quotidienne, en faisant la cuisine, il n’y a pas beaucoup de moments où les acteurs et les actrices viennent me voir en me disant : « Tu sais ce que j’ai lu ? », où moi aussi je leur dis cela, alors je ne vois pas comment le théâtre peut être indispensable. Peut-être aussi que, dans un rapport de troupe, il y a une « indispensabilité » du théâtre qui, au fond, surmonte la lassitude devant le fait qu’il faut faire les toilettes tel ou tel jour. Parce que c’est ça aussi ! On se dit : « Mais pourquoi dois-je faire les toilettes ? Je n’ai pas choisi de faire les toilettes, j’ai choisi de faire du théâtre ». Oui, mais à un certain moment, si on veut que le public ait l’impression, comme le disait Meyerhold, de rentrer dans un palais des merveilles, cela passe aussi par quelqu’un qui fait les toilettes.
G. B. : Est-ce que, l’originalité de l’enseignement, de la pensée de l’enseignement, au Soleil, ne vient pas du fait qu’il n’y a pas de distinction entre l’acte de jouer d’un côté, et l’acte de vivre de l’autre. Que le fait de passer de l’un à l’autre est une responsabilité de tous les instants. Quand tu dis qu’il ne faut jamais se résigner, tes mots sont ceux de quelqu’un qui indique à l’acteur autre chose qu’une solution de jeu, qui indique à l’acteur des réponses qui sont les tiennes par rapport à la vie.
A. M. : Il y a deux terrains pour les gens qui travaillent au Soleil : il y a « chez eux » et il y a « au Soleil », ce n’est pas pareil, Dieu merci. Chacun a quand même son monde à soi, son petit terrain privé qui existe. Mais si jamais j’ai dit « Il ne faut jamais se résigner », je pense que c’était en rapport avec une citation de Freud qui dit que « l’homme ne se résigne jamais, il fait un autre choix ». Mais quand je dis cela à un acteur dans une répétition, je me le dis tout autant à moi-même.
Public : Dans une troupe qui est un ensemble d’individus qui vivent ensemble …
A. M. : Qui travaillent ensemble …
Public : Est-ce que, dans une troupe, il n’y a pas un danger d’uniformisation ?
A .M. : Je n’ai jamais remarqué cela. Dans une troupe, il y a beaucoup de dangers, comme dans tout groupe humain, dès qu’il y a plus d’une personne, mais je n’ai jamais craint ni remarqué une uniformisation. Bien au contraire, je trouve que ce qui se produit, c’est que, en progressant, les qualités de chacun (et parfois aussi un peu leurs défauts), forcément, les distinguent les uns des autres. Et puis, peut-être aussi sont-ils au départ très différents les uns des autres. Ils ne sont pas sur le même modèle, c’est le moins qu’on puisse dire. Au départ, rentrent au Soleil des gens très différents les uns des autres. Et je pense qu’ils le restent, et que ce n’est pas parce qu’ils se plient à une rigueur, à une discipline de travail, à un respect mutuel, qu’ils s’uniformisent.
G. B. : Une pianiste suisse raconte qu’après d’énormes efforts elle a été acceptée pour travailler avec le grand pianiste Michel Angelo Benedetti et que lorsqu’elle est arrivée devant le chalet, Benedetti l’a accueillie sur le pas de la porte. Il avait neigé, et le maître lui a donné un balai en lui disant : « Nettoyez la cour, et cela trois jours de suite ». Je reconnais là une pédagogie un peu « orientale ». Il faut se soumettre à l’épreuve du concret avant d’accéder à l’art conçu comme exercice dépourvu de tout engagement dans le quotidien. Bien que j’aie entendu des acteurs du Soleil se plaindre des tâches matérielles infligées à la Cartoucherie il me semble que la grande pédagogie de la troupe, sa pédagogie interne, porte la marque de ce passage du concret, du quotidien vers l’acte artistique.
A. M. : Je veux rester sur cette histoire de Michel Angelo Benedetti. Le problème, c’est que quand Benedetti dit « nettoyez la cour », c’est sa cour ! Quand les comédiens ou les comédiennes du Soleil préparent le lieu, ce n’est pas seulement leur lieu, mais c’est aussi le vôtre, celui du public. C’est presque un petit cliché sur le Soleil, cette histoire, mais en fait il y a peu d’acteurs qui disent vraiment qu’ ils sont partis du théâtre du Soleil parce qu’ils ne voulaient pas faire les toilettes. Ce n’est pas tout à fait vrai, il y a d’autres raisons, d’ailleurs tout à fait estimables, dans la vie il n’y a pas que des raisons drôles ou basses, il y a aussi des raisons que je peux, même moi, comprendre. Mais c’est quand même tout le rapport au public qui se joue là, c’est toute cette fièvre qu’un groupe d’acteurs éprouve à l’attente du public, et cela aussi s’apprend, ce miracle de faire que, y compris à notre époque, on ouvre une porte et il y a des gens qui sont derrière cette porte, qui ont payé, et qui attendent pour entrer, qui attendent pour voir du théâtre. S’il n’y a pas à l’intérieur de ce théâtre, derrière cette porte, beaucoup, beaucoup de … je suis désolée, les mots que j’emploie peuvent vous paraître un peu niais, mais s’il n’y a pas beaucoup d’amour, beaucoup de dévouement, beaucoup d’engagement, beaucoup de don de soi pour provoquer ce moment extraordinaire de jouissance collective — jouissance pour le public, jouissance pour les acteurs‑, s’il n’y a pas cela, alors on rentre dans le théâtre comme à la sécurité sociale, on rentre dans le théâtre comme dans un bâtiment public. C’est plus que cela, quand même, ce qui va se passer quand on rentre dans un théâtre, on ne doit pas rentrer dans le théâtre sans une sorte de terreur sacrée. Dans ce qu’on appelle les meetings, c’est-à-dire les petits moments où on se rencontre avec les comédiens avant le début d’un spectacle, cinq minutes avant qu’on ouvre la porte, nous parlons souvent de cette terreur sacrée : est-ce qu’elle est là ? Parce que, si elle n’est pas là, est-ce que vraiment cela va être possible de faire du théâtre I Cela aussi s’apprend. Ce qui s’apprend, c’est l’exigence de cela, son importance, l’importance de la ritualisation de la vie quotidienne. Il n’y a rien de plus destructeur avant un spectacle qu’une réflexion cynique, goguenarde, ou désenchantée ; après, c’est difficile de remonter la pente … Ce n’est même pas moi qui le leur enseigne, ce sont eux qui en ont l’expérience et qui savent ce qui est dangereux pour leur inspiration. Il y a des choses qui donnent de l’inspiration ; ce n’est pas inspirant, un sac de plastique vert sous la table de la loge, ce n’est pas inspirant, certains propos avant d’entrer en scène, ce n’est pas inspirant de ne pas se donner un moment, non pas pour se concentrer — ce n’est pas cela -, mais pour se préparer à quelque chose d’extraordinaire : apparaître. Convoquer, invoquer, évoquer le personnage, cela ne peut pas être prosa’ique. Plus l’heure du spectacle avance, plus le prosaïsme doit s’éloigner. Le jeu commence. J’appelle cela de l’invocation, quand je vois les comédiennes et les comédiens, dessous dans leurs loges — ceux qui sont venus au Soleil savent que les loges sont sous les gradins. Je sens que les comédiens commencent à ne plus être tout à fait eux-mêmes bien avant qu’ils ne jouent, ils se parlent comme des personnages, ils ont des petits rituels, ils ne se disent plus « Myriam » ou « Nicolas », mais cela devient « Monsieur le Grand Intendant » ou d’autres formules … Ils jouent comme des enfants, à un degré évidemment très différent du degré qui est celui de la scène, avec, cela va de soi, une distance beaucoup plus grande, puisqu’ils sont déjà un petit peu les personnages et en même temps se disent : « Oh, vous êtes drôlement maquillé, aujourd’hui, Monsieur le Grand Intendant, est-ce que vous êtes sûr que vous n’avez pas oublié de mettre ceci ou de mettre cela ? ». Si, à ce moment-là, il y a de la vulgarité, c’est très difficile. S’il y a quelqu’un qui fume — un geste tellement prosaïque -, ce n’est pas possible. Au fond, tout cela va ensemble pour nous : il n’y a pas tout d’un coup un pur esprit qui est une très grande comédienne ou un très grand comédien, pour qui tout ce genre de choses ne compte pas, et qui rentre en scène sans avoir vécu cette préparation. J’ai l’impression qu’il s’agit de véritables marches d’approche : on ne peut pas supprimer les marches d’approche dans les grandes escalades. Et une représentation, c’est une immense escalade.
G. B. : Sotigui Kouyaté parlait de l’éducation globale en Afrique en disant qu’on ne distingue pas l’éducation au premier degré, au second degré, au troisième degré. Dans cet esprit je veux faire un petit aveu, à propos de l’éducation globale. Quand je suis venu au Soleil, avec une petite équipe de télévision roumaine improvisée et qui travaillait dans des conditions épouvantables, tu nous avais accueilli. Mais eux, sans ton accord, ils ont voulu filmer le public. Tu le leur a interdit et ils l’ont très mal pris. Au point qu’il a fallu que je leur explique le soin que tu prends du public, le fait que tu rejetais l’intervention dans ce havre de chaleur qu’est la Cartoucherie du médium froid qu’est la télévision. Tu enseignais la meilleure manière de protéger le public. La pédagogie, globale et interne, c’est cela aussi. Une pédagogie de l’acte. Par ailleurs je tiens à rappeler que tu réclames la fidélité, mais qu’en même temps le premier fidèle au Soleil c’est toi-même. Tu n’as pas fait de mise en scène d’opéra, tu as fait des films mais toujours avec la troupe … Tu ne quittes pas le Soleil, et ainsi tu pratiques une pédagogie du faire, d’abord pédagogie concrète avant qu’elle soit formalisée, rendue systématique.
A. M. : Mais cela ne me coûte pas. Ce n’est pas du tout par sacrifice que je n’ai pas fait d’opéra. C’est parce que je crois qu’on ne doit pas aller sur un terrain où l’on sait qu’on va être écrasé. Avec l’opéra, je sais que je travaillerais dans des structures qui ne me conviennent pas, parce que j’ai besoin de travailler avec des gens qui ne regardent pas leur montre, qui regardent ce que sont en train de faire leurs camarades sur scène avec tellement de ferveur qu’ils en oublient l’heure. J’ai besoin de fous et de folles. Et à l’opéra, il peut y avoir tout d’un coup un grand chanteur fou, mais le reste est une structure qui est tellement institutionnelle que je ne pourrais pas y travailler. Ce n’est pas du tout un sacrifice pour moi, car je crois que j’ai absolument besoin de travailler avec des fous et des folles de théâtre, qui cherchent le théâtre comme des fous et qui savent que nous sommes à l’école, que ce n’est pas la peine de me ramener sa boutique, que ce n’est pas la peine d’essayer de me vendre ce qu’ils savent faire, au contraire.
G. B. : Tu n’aimes pas que les acteurs apportent leurs valises. Est-ce que tu aimes avoir des acteurs qui sont des gens, en quelque sorte, formés, ou aimes-tu les former ? Tu aimes avoir des acteurs qui apportent leurs outils.
A. M : Mais leurs outils, ce ne sont pas leurs valises, c’est très différent. Quand je parle de valises, tu sais très bien ce que je veux dire : c’est arriver avec sa boutique, avec « ce que je sais faire ». Mais ce serait tout à fait faux de prétendre que tous les acteurs sont arrivés sans aucune formation au Soleil. Ils disposaient le plus souvent des formations atypiques. C’est très récemment qu’un acteur issu du Conservatoire est venu jouer au théâtre du Soleil ; avant c’était presque impensable, pas pour moi — contrairement à la légende ! — mais pour eux ! Les acteurs qui sont entrés au Soleil avaient souvent de très bonnes formations, soit de danse, soit de mime, ils n’arrivaient pas tous sans savoir rien faire. Cela dit, il est arrivé des gens qui sont entrés au Soleil et qui non seulement ne savaient rien faire mais ne prétendaient même pas devenir acteurs. Et ce qui est très intéressant, c’est de voir que certains de ces tout jeunes — parce qu’il y a vraiment des tout jeunes, qui au début étaient vraiment, comme nous disons chez nous, à la technique, des petits chiots, vraiment — tout d’un coup, à force de regarder les autres, apprenaient énormément. Parce que c’est cela, aussi, la pédagogie, c’est aussi le travail des acteurs pour les acteurs. Un metteur en scène peut parler tant qu’il veut, s’il n’y a pas un acteur ou une actrice qui montre ce que veut dire ce que le pauvre metteur en scène est en train de demander, rien ne se produit. Il y a donc eu, très souvent, des acteurs qui savaient effectivement et qui ne prétendaient même pas être acteurs, et qui, voyant les autres, demandaient un jour timidement : « Est-ce que je peux participer au stage ? », et tout d’un coup ils se révélaient être des matamores extraordinaires. Mais n’oublions pas qu’ il faut du don, si on est fait pour autre chose il ne faut pas faire cela — je sais que cela ne plaît pas quand je le dis, mais c’est quand même ce que je crois : je crois qu’il y a, pour les acteurs, des qualités qu’il faut qu’ils aient. Donc, quand il y a des dons et qu’il y a une observation possible d’une troupe au travail, d’un groupe d’acteurs audacieux, se lançant dans une quête, je pense que c’est formateur. J’ai vu que c’était formateur. Cela ne suppose pas que je ne suis pas ravie quand les acteurs arrivent en ayant un corps entraîné, athlétique, en ayant le sens de ce qu’est un rythme, de la musique, capables de chanter si possible, de jouer d’un instrument, de prendre un objet, de le poser et de le lâcher … Des choses comme ça. Et, de surcroît, plus ils sont cultivés plus je suis contente.
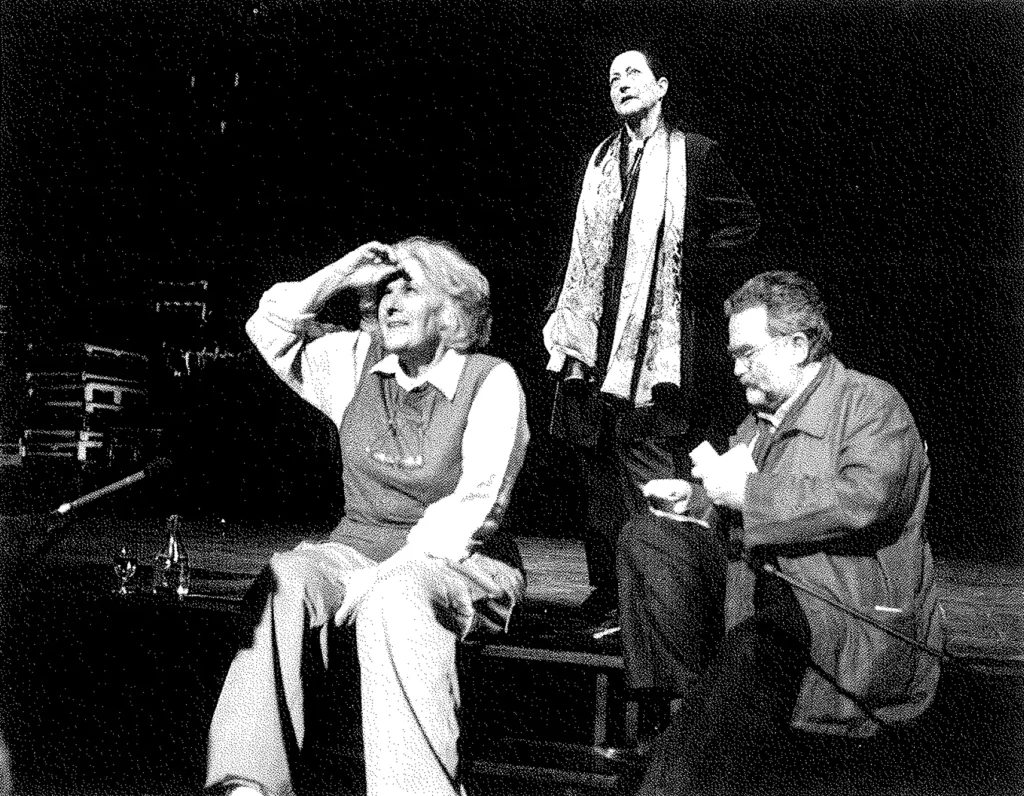
G. B. : Il y a très longtemps nous avons fait pour la revue L’Art du théâtre un numéro consacré aux metteurs en scène pédagogues, et tu m’as écrit cette lettre que j’ai reprise. Je la lis maintenant.
Cher Georges Banu,
Je viens de lire parmi les plus beaux textes qui soient sur la formation de l’acteur. Je veux dire parmi les plm beaux textes occidentaux, ceux de Copeau, Dullin, Jouvet. Et ils sont d’une telle force, d’une telle vérité, d’une telle inspiration que ce que je pourrais dire en ce moment ne serait que banalité et surtout vanité. Je préfère les écouter silenciemement. Écouter : première loi de l’acteur.
Très amicalement,
Ariane.
A. M. : C’est vrai. Je pense que ces gens-là — quand je dis « les occidentaux », c’est parce qu’ il y a aussi les grands textes orientaux, et les Russes aussi -, nous ne pouvons, nous, que redire, en rafraîchissant les choses, ce que disent leurs textes. Mais redire, ce n’est pas négligeable, d’ailleurs. Je pense qu’il faut redire, mais je crois qu’ on peut quand même être conscient que c’est de la redite. Nous, qui redisons, nous devons savoir que, finalement, eux ont eu le talent, le temps, le désir de mettre sur le papier presque toutes les lois essentielles du théâtre. Et que lorsqu’on en doute il suffit de les relire pour trouver sa nourriture. Alors notre rôle à nous est de redire, et il y a des gens qui le font particulièrement bien. Il y a des ouvrages plus récents où il y a des choses magnifiques : par exemple, je trouve que Barba fait vraiment un travail de recherche et de mise au point pédagogique qui est formidable. Mais il est vrai que moi, je crois, je n’ai pas suffisamment le désir de passer du temps pour écrire cela. Je préfère le moment sur le plateau, où ces choses-là sont demandées d’une façon totalement concrète, et à ce moment-là, d’ailleurs, paraissent et sont oubliées par tout le monde, y compris par moi-même. Parce qu’au fond une répétition c’est, quand même, souvent essayer de retrouver les lois du théâtre qu’on a oubliées depuis la veille. Je sens que chaque jour de répétition c’est se dire : « Mais pourquoi ça ne vient pas. Mais pourquoi ? ». Bien sûr, puisque la loi essentielle, ce jour-là, nous l’avions oubliée, et c’est là qu’il est important de redire.
G. B. : Tu as souvent reconnu l’importance pour toi et le Théâtre du Soleil de la tradition orientale. Nous avons parlé ici de la relation maître/disciple. Mais parfois tu contestes la notion de « maître » pour l’Occident, en disant d’une part que tu ne te sens pas proche du maître parce qu’il n’est plus en état de recherche, et d’autre part que le maître n’a pas d’attachement.
A. M. : Si j’ai dit que le maître n’était plus en état de recherche, c’est une erreur. Par contre, pour ce qui est de la différence entre le travail d’un chef de troupe, d’un metteur en scène, et d’un maître, je crois qu’il est vrai qu’un maître n’a pas, ou en tout cas ne doit pas avoir, d’attachement. C’est-à-dire qu’au fond ses élèves, ses disciples, non seulement il accepte qu’ils partent, mais ils doivent même absolument partir. Par contre, moi, j’ai un attachement énorme. Et cet attachement me nourrit, je ne pourrais pas travailler sans lui. Il m’est nécessaire. J’ai besoin d’imaginer que mes acteurs vont rester là toute la vie, je ne veux pas travailler avec quelqu’un dont je sais qu’il va s’en aller. C’est une faiblesse, peut être, mais c’est aussi parce je crois qu’il y a une telle force de rapport entre les acteurs et moi, ou tout metteur en scène du même style. C’est une façon de travailler. Mais un maître ne peut pas faire cela. Il est dépositaire de mille ans ou deux mille ans, d’une éternité, non seulement de savoir mais de réflexion sur ce savoir. Il doit le transmettre, et avoir suffisamment d’indifférence ou de détachement en lui pour voir partir son élève, en accueillir un autre. Pour ce qui est de moi … on ne dit pas seulement « une troupe », on dit « une compagnie » — il y a du compagnonnage dans cela. Au fond, un maître est au-delà des batailles. Ce n’est pas qu’il n’est pas dans la recherche, je crois plutôt qu’il ne doit pas être dans la bataille. Alors que, nous, quand nous faisons du théâtre, nous sommes tout le temps dans la bataille. Donc on est ensemble, on tient les uns aux autres. Et, moi, je tiens à eux, c’est-àdire que je tiens par eux, aussi, et ce n’est pas quelque chose que j’ai envie de changer. Peut-être cela a‑t-il à voir avec le combustible. Ce bateau, il a besoin du vent pour avancer, il a besoin de sa chaudière … Il y a des choses qui se brûlent là-dedans. Il me paraît tout à fait illusoire d’imaginer qu’on va faire de l’art sans brûler quelque chose, sans non seulement donner quelque chose, mais sans même perdre quelque chose. Je ne vois pas comment c’est possible : d’où cela viendrait-il, si vraiment nous ne laissions aucune plume, aucun bout de nous-mêmes. Parfois, des gens de théâtre prétendent que ce n’est pas du tout le cas, et je suis toujours étonnée. C’est parfois tellement prenant, fatigant, il y a des chagrins, il y a des moments de la vie qu’on ne vit pas parce qu’on vit cela. Je ne suis pas du tout en train de me plaindre. Mais j’admets qu’il y a des choses dont je me dis : « Tiens, ça c’est passé pendant que je faisais du théâtre ». Cela ne s’est même pas passé matériellement pendant une répétition, mais cela s’est passé pendant que toute mon énergie, tous mes rêves, toutes mes capacités se trouvaient dans cette terreur sacrée qui était : « Est-ce que le théâtre, oui ou non, va venir ? Est-ce qu’on va être dignes de ces gens qui attendent dehors que la porte s’ouvre pour venir au théâtre ? » Moi, cela me fait trembler, cette responsabilité. Et, quand je vais au théâtre, parfois, je me demande comment c’est possible d’ouvrir la porte alors qu’on a un spectacle pareil. Parce que, moi, j’ouvre la porte en tremblant, et je ne parle pas seulement du jour de la première. Toujours j’ouvre la porte en me demandant si c’est digne de l’attente des gens, parce que dans les yeux du public on voit cette attente ; et à ce moment-là on comprend pourquoi il y a des parties de sa vie qu’on a laissées sur une étagère … Je parle du théâtre, mais, s’il y a des pratiquants d’autres arts, ou même de la science, de toute recherche vitale — parce que l’art est une recherche vitale, et en ce moment il y a des recherches scientifiques qui sont des recherches vitales — je suis certaine qu’ils vous diront qu’ils ont brûlé beaucoup de leur vie dans leurs éprouvettes pour essayer de nous guérir des pestes qui sont là en ce moment. Et quelqu’un qui ne veut pas brûler un peu de lui-même, il ne faut pas qu’il fasse ce genre de travail.
Public : Jacques Lassalle dit : « Enseigner c’est mettre en scène et mettre en scène c’est encore enseigner ». Que pensez-vous de cela ?
A. M. : Je pense que c’est vrai. Je pense que mettre en scène c’est enseigner, mais aussi à soi-même. Ce qui se passe entre un metteur en scène et des comédiens, quand on se donne le temps, c’est vraiment un échange. C’est comme s’il y avait un tuyau qui les reliait… Les comédiens me donnent, et je crois que je donne. Donc, bien sûr, mettre en scène c’est enseigner ; mais pas trop non plus, quand même, parce qu’autrement on se retrouve dans la situation du maître, justement. Et je pense que le metteur en scène est quand même sur le même bateau que les comédiens.
G. B. : À un moment donné, s’est produit un changement assez important dans la vie du Soleil, et, je dirais, même dans ton approche : tu as ouvert brutalement les portes. Avant, tu procédais par une sorte d’intégration progressive du groupe, par cooptation, et, d’un coup, tu as décidé d’initier de grands stages, qui ont vraiment été des moments importants pour la nouvelle génération des comédiens. À quoi cette mutation correspondait-elle ?
A. M. : C’est un peu comme aux Salines : au début, j’ai ouvert des stages pas du tout pour cela. À l’époque il y avait beaucoup de jeunes apprentis comédiens qui ne pouvaient pas rentrer au Soleil parce que c’était plein, mais qui voulaient travailler avec moi. À un moment donné, on s’est dit qu’on avait un outil, un lieu, une subvention, et qu’on pourrait faire des stages gratuits. On a commencé comme ça, un peu par devoir — vraiment le premier stage c’était un devoir. On ne s’est rendu compte de rien : on n’a pas fait de sélection, on a lancé l’idée, on a répondu aux gens en fixant une date, et on ne s’est pas préoccupé du reste. Et le matin de ce fameux stage il y avait 450 personnes. Et comme on n’allait pas les renvoyer, on a fait un stage à 450. Et c’est vrai que cela a été très difficile, mais en même temps cela a été extraordinaire. Cela a duré très longtemps, le stage s’est écrémé, un événement grave a fait qu’on a dû l’interrompre, puis on l’a repris … Et, en effet, il y a toute une génération des comédiens du Soleil, et non des moindres, qui est entrée par le biais de ce stage. Et évidemment, après, on s’est dit qu’on allait en faire de temps en temps, parce que tout le monde s’était, diraisje, beaucoup amusé. Et moi, cela m’avait fait beaucoup de bien, parce que j’avais beaucoup appris pendant ce stage. On a donc décidé d’en faire, non pas régulièrement, mais souvent. Par la suite, on a un peu sélectionné, ce que je déteste … mais à ces stages il y a quand même au moins 100 ou 150 personnes, et c’est très bien. Il se passe des choses magnifiques. Ce sont des stages courts, juste pour se connaître un tout petit peu. J’ai toujours envie de les appeler « On peut aussi faire autrement ». On fait ce qu’on aime faire. On découvre beaucoup de choses. Mais je ne dirais pas que j’ai ouvert les portes brutalement ; ça c’est fait comme cela.
G. B. : Dans le travail tu utilises beaucoup de métaphores. On l’a vu tout à l’heure : l’oiseau, le bateau qui brûle. Je crois que c’est assez important, le vocabulaire qu’on emploie pendant la répétition, surtout dans le cas du Soleil. La répétition et la pédagogie se confondent presque. Est-ce que cet usage de la métaphore est un usage qui t’aide à ouvrir les vannes de l’imaginaire ? Par ailleurs tu es extrêmement précise : tes demandes quant au travail corporel, d’après ce qu’on a vu dans les films, sont extrêmement précises. Tu formules une double demande : d’un côté l’ouverture de l’imaginaire vers la métaphore, et de l’autre l’exactitude maximale.
A. M. : Je dirais que « ça se précise », mais que je ne suis pas du tout précise au début. Le voudrais-je que je n’y arriverais pas. En plus, je ne le veux pas. Mais pour ce qui est de la métaphore … Oui, j’ai l’impression que c’est parfois plus inspirant pour les acteurs de leur parler d’un bateau qui brûle que de leur dire : « S’il te plaît, poussetoi un petit peu plus au jardin ». Parce que je pense qu’un acteur ou une actrice qui a la vision juste, l’état juste, sera exactement là où il faut au jardin, sans qu’on ait à le lui dire. Mais, par contre, j’ai besoin de leurs métaphores et de leur combustible, c’est-à-dire que j’ai besoin de leurs propositions, de ce qu’ils m’offrent tout le temps, et je crois que, eux aussi, ils ont besoin que j’apporte mon combustible, à savoir, effectivement, mes images, mes métaphores ; des choses qui parfois n’ont strictement rien à voir, mais, comme on se connaît bien, cela les nourrit. Cela nourrit leur imagination — et après tout de quoi d’autre ont-ils besoin que d’imagination, et de force ?
Public : Un engagement tel que celui qu’implique votre travail n’a-t-il pas pour risque d’engendrer fatalement des crises ?
A. M. : Le problème est que, lorsque les crises arrivent, on a beau se dire : « non, non, s’il vous plaît, pas de crise », les crises surviennent quand même … Je me dis aussi, souvent : « C’est bien, il faut des crises de temps en temps, mais surtout pas maintenant, s’il vous plaît, pas maintenant ! » … Mais je pense que, de toute façon, nous n’avons pas vécu plus de crises que d’autres. Et l’on ne peut pas éviter les crises, pour différentes raisons — des raisons d’ego, des raisons de désir, toutes les raisons humaines.
G. B. : Le titre de ce dialogue que nous portons maintenant c’est toi qui l’as proposé : « De l’apprentissage à l’apprentissage ». Le sens apparemment est simple, mais en même temps très compliqué.
A. M. : J’ai suggéré « De l’apprentissage à l’apprentissage » parce que je pense qu’au fond chaque spectacle c’est ça. Avec des périodes comme celle que je traverse pour l’instant, où les comédiens jouent, et moi je fais l’accueil. Les comédiens jouent, et ils doivent donc trouver les forces, ils doivent se nourrir pour ça. Alors que, moi, j’ai l’impression, au contraire, d’une espèce de vide, un terrible vide. Et puis de petites idées me viennent : « Ah oui, si on faisait ça », n’importe quoi, je passe alors d’une idée à une autre … Et je me dis qu’au fond je saurai ce que je vais leur proposer pour la suite dès le moment où je saurai ce que j’ai envie d’apprendre. Pas seulement où j’ai envie d’aller. Pas seulement l’histoire que je voudrais raconter. Non : le spectacle que j’ai envie de voir, parce que je sais que ce spectacle fera de moi quelqu’un qui aura peut-être appris. Vous connaissez cette phrase fameuse, de Copeau je crois, qui dit : « Il y a deux sortes de metteurs en scène. Celui qui se demande : qu’est-ce que je vais faire de cette pièce ? Et l’autre se demande : qu’est-ce que cette pièce va faire de moi ? ». Disons que je suis plutôt du genre à me poser la deuxième question. C’est pour cela que j’ai pensé au titre « De l’apprentissage à l’apprentissage ». C’est-à-dire qu’à chaque spectacle, on part à zéro, au sens propre comme au sens figuré. On commence dans une salle de répétition, il n’y a plus rien. Il y a quelques vieux costumes à l’arrière, des tables pour que les comédiens puissent se maquiller, s’ils le veulent, et il y a un plancher ou un tapis. Il n’y a rien d’autre. Donc, à chaque fois : est-ce que le théâtre va exister ? Est-ce qu’on va le retrouver ?
Texte publié avec l’accord d’Ariane Mnouchkine qui, en raison de la tournée des TAMBOURS SUR LA DIGUE, s’est trouvée dans l’impossibilité de corriger son intervention. Nos remerciements pour la confiance qu’elle nous a faite. G. B. et C. T.