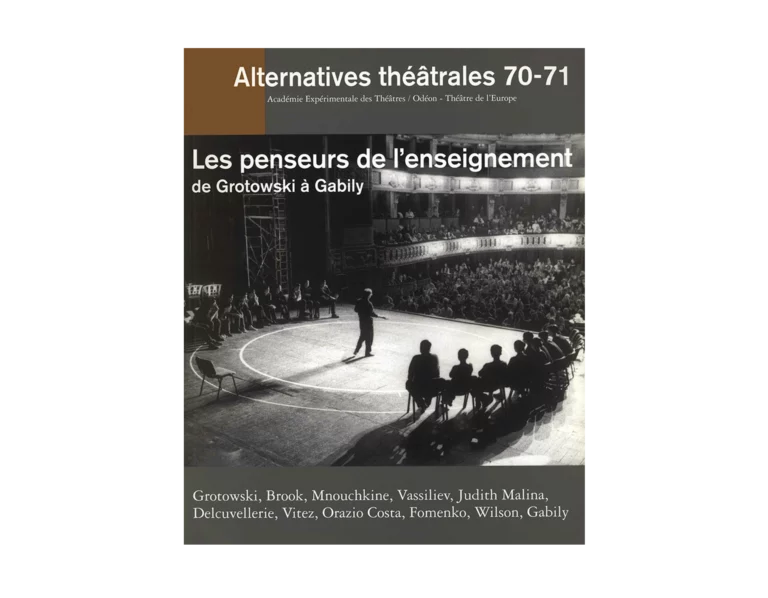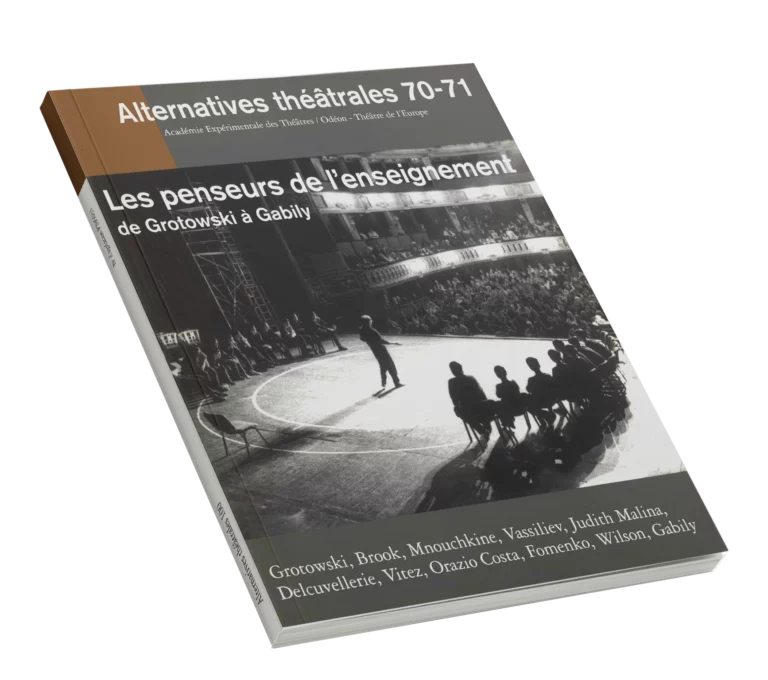« JE VEUX que vous vous rappeliez si possible tout ce que j’ai pu vous dire. Je ne sais pas si je serai là l’année prochaine — nous n’avons rien envisagé encore — mais s’il vous plaît je veux que vous essayiez et reteniez. S’il vous plaît, entraînez-vous et faîtes que tout cet effort ne soit pas vain, faîtes en sorte de mettre à profit pour d’autres partitions ce que je vous ai donné, aussi peu que cela soit, et de le mettre à profit dans le courage, le phrasé, la diction, dans le courage encore parce que ce n’est pas une carrière facile — ne pensez jamais que c’est une carrière facile.
(…)
En guise de remerciements, la seule chose que j’attends de vous est que vous chantiez correctement, que vous appliquiez dans le travail de vos partitions le savoir que j’ai pu vous apporter, quel qu’il soit. C’est à cette heure la seule chose que je peux dire à tous et à chacun de vous. Cela ne s’arrête pas ici. Vous devez continuer, parce que vous êtes sensés assurer la continuité de ce que nous avons fait.
Que je continue à chanter ou non ne fait aucune différence. Vous êtes la jeune génération, et vous devez l’appliquer, et ce sont les seuls remerciements que je désire vraiment. Continuez, et dans la bonne voie. Non pas en faisant des feux d’artifice ni en vous contentant de succès faciles, mais en basant votre travail sur le sens des mots, la diction, l’expression de vos véritables sentiments, quels qu’ils soient. C’est ce que je veux dire, et je ne suis pas douée avec les mots.
Donc voilà, c’est tout ».Maria Callas, Adieux aux étudiants, Juilliard School, 16 mars 1972.
Ainsi Maria Callas concluait-elle la série de master classes qu’elle donna à laJuilliard School, à New York, pendant douze semaines, à raison de deux séances hebdomadaires entre octobre 1971 et mars 1972. Cette allocution, qu’elle dit elle-même maladroite, pourrait se résumer en quelques mots : exigence, travail, intégrité, vérité, art. Ces mots, je ne les lui prête pas, ils sont à elle. Dans tous les témoignages — écrits, audio et vidéo — que nous avons encore de la cantatrice1, ces mots reviennent inlassablement, devise d’un combat de toute une vie. Giorgio Strehler disait que chacune de ses mises en scène était un essai sur le théâtre. Chaque représentation que donnait Maria Callas était un manifeste clamant sa conception de l’art qu’elle servait. Ce sont là ses plus grandes leçons pédagogiques. Elle eut cependant envie, à un moment de sa vie, d’un enseignement plus explicite.
Les master classes ou la pédagogie-événement
Beaucoup de chanteurs, vers la fin de leur carrière ou lorsqu’ils se retirent de la scène, sont attirés par la transmission de leur expérience. Ce désir de pédagogie prend généralement la forme de master classes, sessions de travail destinées aux jeunes chanteurs de niveau professionnel, qui ont déjà commencé leur carrière. Les particularités de cette forme d’enseignement viennent avant tout du phénomène de starisation des artistes lyriques.
Maria Callas ou Élisabeth Schwartzkopf donnent des cours, et le public afflue comme à la première d’une nouvelle production. Inconsciemment ou non, le statut de star du chanteur a un rôle à part entière dans sa pédagogie. Il travaille avec l’aura qui l’entoure, avec cette légitimité artistique qu’une carrière internationale et la reconnaissance publique et critique lui ont donnée. Deux personnes alors font face à l’élève : la star et l’artiste.
Souvent publiques, les master classes reproduisent le schéma de la représentation scénique : tout d’abord, en ce qui concerne les master classes de Maria Callas, il fallait donner cinq dollars. On paye pour assister à la leçon. De plus, le pédagogue a sa place auprès du piano, sur scène, face au jeune chanteur mais également au public. Ici, toute intimité est exclue. L’enseignement donné à une personne est reçu par l’audience entière. Basée sur un cas particulier, la leçon prend cependant des allures de cours magistral.
Il est même souvent fixé, devenant archive, par l’enregistrement audio (Maria Callas) ou vidéo (Élisabeth Schwartzkopf).
Sa dimension événementielle est renforcée par la rareté des sessions. Et si l’aspect scénique peut faire douter du naturel du pédagogue — et de l’élève -, le caractère exceptionnel de cet enseignement ne permet pas à celui qui transmet de tomber facilement dans le phénomène de répétition lorsqu’il délivre son savoir. Il n’est pas ancré dans des « habitudes pédagogiques » et de ce fait réagit plus spontanément à la personne en face de lui, à sa voix et son chant particuliers.
La célébrité du pédagogue, les auditions très dures auxquelles est soumise une foule de jeunes chanteurs désirant apprendre de la star, et le peu d’élus renforcent également la notion de choix dans cet enseignement. Le jeune artiste désire auditionner pour les master classes de tel ou tel chanteur, il émet par là des préférences, mais le choix revient à l’enseignant. C’est lui qui choisit préalablement la personne et la voix à qui il va prodiguer ses conseils, confier l’héritage d’une expérience. Sur trois cents candidats, Maria Callas n’en avait retenu que vingt-cinq.
Quel contenu ?
Il faut aborder ici la notion de répertoire. Tout chanteur se constitue au fil de sa carrière un répertoire, en fonction de sa voix, de sa sensibilité musicale et artistique. Contrairement à l’acteur ou au metteur en scène, son expérience se base sur un nombre relativement restreint d’oeuvres qu’il chante dans le monde entier, dans le cadre de différentes productions. Ces musiques, ces livrets, il les porte en lui, toute une vie durant. Il en a une connaissance quasi-organique. La leçon devient alors exceptionnelle.
L’artiste, revenu cent fois sur les difficultés de ces partitions, peut aider le jeune chanteur à trouver les moyens de leur faire face et de les vaincre. C’est l’aspect technique — primordial — du chant. Mais, par son expérience scénique du rôle, ses rencontres avec divers metteurs en scène, il peut également transmettre des indications dramatiques pour une véritable interprétation du rôle.
Mais nous ne devons pas croire que ce répertoire limite les capacités pédagogiques de chanteuses telles que Maria Callas ou Élisabeth Schwartzkopf. La finesse de leur perception auditive et leur compréhension profonde de la musique rendent justes et passionnantes leurs remarques sur n’importe quel rôle, y compris masculin.
Enfin, au-delà, une esthétique, une conception particulière, personnelle de l’art de l’opéra est transmise en écho d’une expérience artistique intense.
La recherche artistique : une quête d’identité
Il y a toujours chez celui qui veut apprendre, une quête de sa propre identité. Se confronter à l’Autre, c’est apprendre à se connaître soi-même. De même, s’atteler toute sa vie à une recherche artistique implique consciemment ou non de partir à sa propre découverte.
Au moment où Maria Callas marquait profondément des rôles comme Violetra (LA TRAVIATA de Verdi) ou Médée (MEDEA de Cherubini), leur offrant une dimension dramatique exceptionnelle, Élisabeth Schwartzkopf atteignait de même les sommets de l’interprétation lyrique — souvenons-nous de sa Don Elvira (DON GIOVANNI de Mozart) ou de sa Maréchale (DER ROSENKAVALIER de Strauss). Chacune a travaillé ses rôles en insistant sur le respect musical, dramatique de la partition et du livret, sur la clarté de la diction et la précision du jeu scénique. Pourtant, il y a entre l’art de ces deux cantatrices toutes les différences qui séparent le Sud du Nord. Tout ce qui sépare Bellini de Mozart et Verdi de Strauss. Un répertoire se constitue aux vues des possibilités vocales, mais également à partir du tempérament de l’artiste — tempérament qui s’enracine dans l’identité culturelle. Sa façon de le livrer au public subit la même influence. Schwartzkopf donne toute sa force retenue, toujours génialement dans la mesure. Callas, avec l’emportement de la passion méditerranéenne, provoque sans cesse les frontières, défie les limites du possible.
Question de fond…
Ainsi, ce qu’elles ont défendu et montré sur scène à chaque représentation se retrouve à la base de leur enseignement.
Elles restent avant tout très attentives au placement de la voix, sans lequel rien n’est possible. Mais d’autres paramètres sont pour elles primordiaux. Le rythme d’abord. Plus que toute autre, la musique lyrique revendique son caractère dramatique — porteuse d’une action théâtrale qui se développe au fil de l’ oeuvre. Maria Callas et Élisabeth Schwartzkopf tiennent particulièrement à l’adéquation entre la dynamique de la musique et celle de la voix. Ensuite vient la respiration : de son placement dépendent les attaques, les nuances, les couleurs, tout ce qui donne vie et liberté à la partition et au rôle. Elles reviennent également sans cesse sur l’importance de la prononciation — pour la compréhension du personnage — et de la justesse des ornements — pour sa « vraisemblance » dramatique. Jamais elles ne perdent de vue l’essence-même de l’opéra, art hybride où musique et théâtre s’engendrent l’un l’autre.
Mais, tout comme dans leur recherche artistique, si le fond pédagogique est le même, la forme diffère.
… et de forme
Les archives vidéo montrent Élisabeth Schwartzkopf assise auprès du pianiste, les yeux fixés sur l’élève, se référant régulièrement à la partition. Attentive à tout, elle ne laisse rien passer, faisant reprendre autant de fois que nécessaire une attaque mal placée, une couleur de note qui détonne, toujours concentrée sur le placement de la voix.
Ses indications sont essentiellement techniques. C’est par là qu’elle aide le jeune chanteur à atteindre la meilleure interprétation possible, dans le respect de la partition tant au niveau musical que dramatique. Elle insiste sur le fait de « construire son instrument » en se concentrant sur le placement physique de la voix — appui du souffle sur le diaphragme, ouverture de la mâchoire, du palais, de la bouche, position du menton … Pour cela, elle use de métaphores. Elle compare la voix à un appareil photographique. Avant de prendre un cliché, tous les réglages doivent être faits. De même, avant qu’un son soit émis, tout le corps doit être prêt et la note déjà pensée.
Pour expliquer comment rendre une nuance, elle compare les mouvements de la voix aux coups d’archet d’un violon, allant jusqu’à mimer le violoniste. Elle crée ainsi pour l’élève un système de représentation qui lui permet de visualiser plus concrètement ce qu’il doit faire avec sa voix.
Pour soutenir ses paroles, Élisabeth Schwartzkopf leur allie le geste. Celui-ci suit parfois la musique pour souligner les nuances — particulièrement un legato — ou mettre en valeur les caractéristiques d’une note, sa rondeur, sa tenue. Elle emprunte alors le vocabulaire gestuel du chef d’orchestre. Mais le geste se double. souvent d’une autre fonction : soutenir l’élève dans son effort physique. Les bras montent, paumes ouvertes vers le ciel, comme un prière, et semblent aider le chanteur à porter sa voix qui doit rester placée en haut, dans les résonateurs fac iaux, alors qu’elle voudrait tomber de tout son poids sur la gorge.
La complexité du placement de la voix lyrique, dont Élisabeth Schwartzkopf connaît tous les secrets, reste le problème majeur. Elle se pose alors en miroir. Miroir qui montre les défauts de la position faciale du chanteur et la position correcte à adopter pour émettre telle ou telle note. Elle mime le chant en même temps que l’élève.
Callas agit différemment. Ceux qui n’attendaient de sa part que des leçons purement techniques, des « trucs » pour aider à se confronter aux difficultés d’ une partition furent bien évidemment déçus. À l’écoute de ces master classes, il est très facile de comprendre que ce n’était pas son but. Callas n’imaginait même pas que l’on puisse commencer à travailler l’interprétation d’un rôle avant d’en avoir résolu les difficultés techniques — précisons à nouveau qu’un chanteur n’a accès aux master classes, qui sont des cours d’interprétations, que lorsqu’il a terminé sa formation dans un, voire plusieurs conservatoires et auprès de professeurs particuliers. Maria Callas voulait avant tout leur faire prendre conscience de leur rôle de passeur, leur responsabilité immense envers le compositeur et donc de la rigueur de travail qu’exigeait une celle vocation. Elle n’abordait la technique que pour mettre en avant l’interprétation.
D’après les enregistrements et les témoignages, elle prenait d’abord toujours le temps d’écouter consciencieusement l’élève chanter une première fois l’aria, tout en prenant quelques notes sur un carnet. Ensuite elle le faisait reprendre et se permettait alors d’intervenir à chaque imperfection.
Elle donnait toujours une proposition d’interprétation (sinon plusieurs) en l’accompagnant d’explications. Elle parlait, peu, et ses indications étaient de deux natures différentes : musicales et dramaturgiques. Elle se référait toujours à la partition, aux indications du compositeur et à la logique de la phrase musicale toujours mise en rapport avec les mots. D’abord les notes, puis le sens. D’autre part, pour expliquer le sentiment du personnage ou l’atmosphère de tel ou tel passage, elle le remettait toujours dans son contexte dramatique : « Qu’est-ce qu’il se passe ? », « Qu’est-ce qu’il se dit ? » sont des questions qui revenaient sans cesse.
Souvent, elle montrait, en reprenant la phrase musicale. Le principe n’était pas de l’imiter — comme certains ont pu le croire, déclarant que Callas voulait se poser en modèle absolu sur lequel tous devaient se plaquer — mais de poser sa voix sur la sienne pour sentir le mouvement, les vibrations de la musique et être ensuite capable de les trouver soi-même, avec sa propre sensibilité. Elle tentait de transmettre « une certaine qualité d’écoute » : savoir ne faire qu’un avec la musique pour sentir les phrasés, la justesse de la nuance et du sentiment, sentir le sens et le souffle de vie de l’oeuvre, sa respiration profonde, sa source. Comme on guide de sa main la main de l’aveugle sur une forme pour lui apprendre à la connaître, Callas guidait la voix et l’oreille dans la découverte de l’intuition profonde de la musique. Car plus qu’un savoir-faire, Callas voulut transmettre un « savoir-être dans l’art ». Transmettre une conception de l’art du chant lyrique qu’elle reçut de ses maîtres — Elvira de Hidalgo, Tullio Serafin, Victor de Sabata — et directement des compositeurs à travers un travail acharné des partitions de leurs oeuvres — Bellini, Donizzeti, Verdi.
Transmissibilité, transmission, mémoire
On ne peut échapper, lorsque l’on parle d’artistes comme Callas ou Schwartzkopf, à la question traditionnelle de la transmissibilité d’une personnalité, d’une nature hors norme, du génie — notion bien mys térieuse et parfois si pratique car elle élimine toute explication. C’est ce que certains, ne trouvant pas ses master classes à la hauteur de son talent de cantatrice, ont reproché souvent à Maria Callas. C’est pourtant un faux problème. La pédagogie n’a pas pour but de produire des clones mais d’aider l’élève à se trouver lui-même — ici en tant qu’artiste.
La personnalité est définie par les actes et l’acte primordial d’une artiste lyrique est le chant. De la scène ont jailli celles de Maria Callas et Élisabeth Schwartzkopf, plus que de leurs paroles. Ceci n’enlève rien à la richesse de ces moments d’enseignement-éclair, justement lumineux, où le travail d’un seul aria prend forme d’exemple sur la façon d’aborder son art, toute une vie durant.
Comment léguer l’expérience de vingt ou trente ans de labeur intense et rigoureux en vingt minutes de cours ? Cette impossibilité procède de la nature même de l’art scénique. La transmission ne peut être que partielle, fragmentaire, pareille à la mémoire du théâtre.
- Coffret de trois disques compacts, Maria Callas at Juilliard : The Masterclasses, EMI Classics, 1987. ↩︎