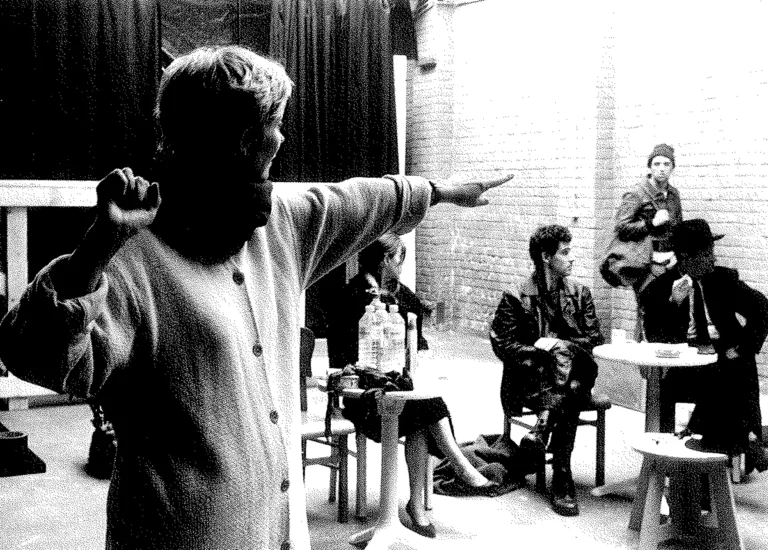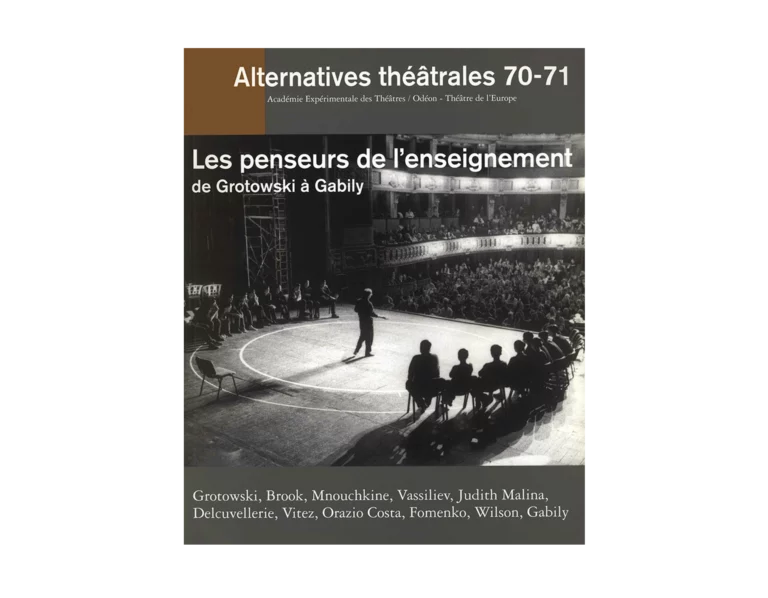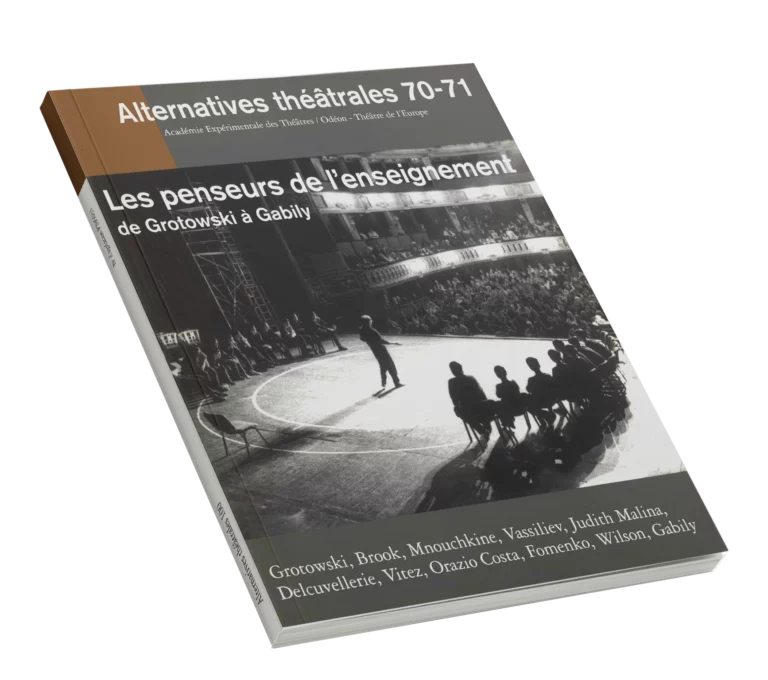FABIENNE VERSTRAETEN : Dans son introduction à ce numéro d’Alternatives Théâtrales sur « Les penseurs de l’enseignement », Georges Banu reprend une phrase de Jacques Copeau disant que l’idée de la mise en scène et l’idée de l’école ne sont qu’une seule et même chose, que l’enseignement du théâtre naît en même temps que la mise en scène. Dans ton parcours personnel, puisque tu as commencé à enseigner très jeune, peut-on parler d’une naissance simultanée de ces deux pratiques, mise en scène et enseignement ? Et de quel enseignement as-tu bénéficié pour développer ensuite toi-même ces deux pratiques ?
I. P.: Mon père qui est compositeur et professeur de musique contemporaine a beaucoup compté dans ma propre formation. Enfant, puis adolescente, j’ai été très tôt confrontée à l’écart qu’il y avait entre la complexité de sa musique et la grande clarté avec laquelle il l’expliquait. Il a un jour donné une conférence à l’Atelier Sainte Anne — j’avais 17 ou 18 ans — devant un public composé de vieilles dames, et ce public qui n’était pas familier de la musique contemporaine était extrêmement réceptif. Mon père arrivait donc à rendre accessible cet objet difficile qu’est la musique contemporaine. À l’âge de 12 ou 13 ans, j’ai dü faire un exposé sur la musique à l’école. Nous avons travaillé ensemble lui et moi, et ce moment a agi comme une révélation : il m’a expliqué comment l’histoire de la musique était liée à l’histoire tout court, en quoi la musique romantique était contemporaine de l’avènement de la bourgeoisie, de l’individu, qu’un orchestre de quarante musiciens n’était plus que l’accompagnement d’un seul interprète … Et quand j’ai donné cet exposé à l’école, je me suis moi aussi retrouvée pour la première fois en position de transmission. Plus tard, en troisième année à l’INSAS, j’ai fait un exposé sur SHAKESPEARE NOTRE CONTEMPORAIN, de Jan Kott. À l’issue de cet exposé, René Hainaux1 m’a dit que je devrais enseigner. À cette époque, j’étais plutôt partagée entre le jeu et la mise en scène, la question de l’enseignement ne se posait pas. L’année suivante, j’ai écrit mon mémoire de fin d’études, « Jouer ensemble » : il s’agissait d’un répertoire d’exercices nourri d’expériences personnelles, de lectures diverses. Ce mémoire m’a ouvert les portes de l’enseignement. René Hainaux m’a demandé d’enseigner au Conservatoire de Liège et Paul Anrieux m’a proposé de donner cours à l’INSAS.
F. V.: Tu achèves tes études et tu commences donc aussitôt à enseigner sans être passée par la pratique ? À l’inverse de beaucoup qui deviennent enseignants en pratiquant la mise en scène, toi tu deviens metteure en scène à l’intérieur de l’école à travers ta pratique de l’enseignement.
I. P.: Lorsque je débute au Conservatoire de Liège, je n’ai encore réalisé aucune mise en scène, sauf en troisième année à l’INSAS : pour le 15e anniversaire de l’école, nous avions obtenu de réaliser un spectacle ET MAINTENANT, MONSIEUR BRECHT, QUELLE EST VOTRE OCCUPATION ?, d’après les minutes de l’interrogatoire de Brecht devant la Commission des activités antiaméricaines. C’était un travail collectif où j’ai très vite pris la place du regard extérieur. Au Conservatoire de Liège, René Hainaux m’a demandé de mettre en pratique les exercices rassemblés dans mon mémoire, mais je me suis retrouvée face à une classe qui refusait cette démarche — le Conservatoire avait connu un grève longue de quatre mois, les élèves voulaient passer à la scène. J’ai donc choisi SCÈNES DE CHASSE EN BAVIÈRE de Martin Sperr, une pièce plutôt réaliste qui comporte de beaux personnages et des situations intéressantes. Au cours de ce travail, je n’ai pas arrêté de me dire que je ne continuerais pas ce métier. J’étais assez inquiète, les étudiants étaient faibles, mais j’ai énormément travaillé et au bout du compte, le résultat était probant. À l’issue de ces deux mois et demi de travail, j’ai été vraiment intégrée à l’école. Au Conservatoire de Liège, les chargés de cours doivent proposer un projet mais aussi répondre aux demandes des étudiants. Des étudiants en cours supérieur ou en dernière année m’ont demandé de diriger leur travail : Francine Landrain m’a demandé de suivre un travail sur LE SILENCE de Bergman, Alain Legros et Monique Ghyssens des scènes de W OYZECK… C’est ainsi que j’ai découvert le répertoire. À l’INSAS, l’enseignement portait sur l’improvisation, l’écriture, le montage, les grands spectacles des années septante n’étaient pas des spectacles de texte, de répertoire, mais plutôt du théâtre de pure création : Pina Bausch, Kantor, Bob Wilson… En sortant de l’école, les metteurs en scène n’ont presque aucun rapport à la pratique : en général, ils attendent un an ou deux avant de pouvoir monter un premier spectacle. C’est donc l’enseignement qui m’a apporté la pratique. À cette époque, au Conservatoire de Liège, la formation était centrée sur l’acteur et le texte : obtenir un projecteur ou un costume étaient choses quasi impossibles. Cela a déterminé mon rapport au théâtre, l’idée que le théâtre c’est d’abord un texte et des acteurs et que donc même sans argent on peut toujours travailler.
L’enseignement a donc toujours été le lieu de mon apprentissage, puisque j’y ai tout appris, notamment dans la direction d’acteurs : le fait d’être confronté à de très jeunes acteurs oblige à chercher en soi-même, alors que si on fait ses premières expériences avec des acteurs plus expérimentés, on ose en général moins intervenir ou diriger, et on cherche peut-être moins en soi.
F. V.: Quand as-tu fait le choix de l’INSAS comme lieu d’enseignement ?
I. P.: Durant plusieurs années j’ai été chargée de cours dans les deux institutions, le Conservatoire de Liège et l’INSAS. Paul Anrieu m’avait également demandé de travailler à partir des exercices de mon mémoire, en section de mise en scène à l’INSAS. Ensuite Michel Dezoteux2 a repris la direction de la section d’Interprétation dramatique et il m’a engagée. Durant plusieurs années, j’ai donc enseigné dans les deux écoles, puis j’ai abandonné le Conservatoire. J’ai continué à enseigner à l’INSAS, en Interprétation dramatique et en Théâtre et Animation culturelle, la section de mise en scène, tout en continuant de suivre ce qui se passe à Liège en participant aux jurys.
F. V.: Pour Georges Banu, le « Penseur de l’enseignement » articule la notion de savoir et de recherche, il refonde l’enseignement dans sa structure institutionnelle, il renouvelle les conditions de son exercice et élabore des processus inédits. Tu enseignes depuis des années à l’INSAS et, depuis l’installation du Théâtre Océan Nord à Schaerbeek, tu développes une pédagogie parallèle. Quelle est la nécessité de ce travail pédagogique au sein du théâtre ? Vient-il d’une insatisfaction face aux limites de l’institution scolaire ? Et pourquoi ce mouvement se développe-t-il parallèlement, dans le théâtre, et non à l’intérieur de l’école ?
I. P.: Il y a dix ans, en 1991, j’ai traversé une crise importante, au moment où j’ai réalisé mon dyptique sur le rêve, LE SONGE de Strindberg et SI L’ÉTÉ REVENAIT d’Adamov. C’était un spectacle d’envergure, créé à Marseille, accueilli en Avignon et qui a connu une belle diffusion. La distribution était conséquente et j’ai eu l’impression d’aller au bout de quelque chose, d’un mouvement de réussite personnelle. Avec ce dyptique, je prouvais que je pouvais monter des pièces dites difficiles. Et j’éprouve en effet du plaisir à démêler les constructions complexes, à m’attaquer à des textes qui décèlent un théâtre « caché ». Ce spectacle était une grosse machine et j’ai eu l’impression de perdre, surtout dans la mise en scène du SONGE, le rapport humain à mon équipe. LE SONGE, comporte quatre grands rôles et quantité de petits rôles, ce qui a déséquilibré le travail : nous étions tout le temps à cinq, les autres comédiens venaient de temps en temps. Au même moment, l’Atelier Ste Anne à Bruxelles et Le Théâtre des Bernardines à Marseille m’ont proposé un partenariat à plus long terme, au-delà de l’idée de production. Je me posais des questions : où en suis-je dans mon parcours théâtral ? Vers où aller ? J’avais 34 ou 35 ans et l’idée de la transmission m’est venue très naturellement, comme un manque, quelque chose que je ne pratiquais pas suffisamment même si j’enseignais.
F. V.: Enseigner, ce n’était donc pas transmettre ?
I. P.: Si, mais il fallait aller plus loin. Après cette crise, j’ai élaboré le projet de « À ceux qui naîtront après nous », sur les thèmes de la transmission, de l’héritage. Lorsque j’ai réfléchi à cette thématique, je me suis dit que je n’avais pas d’enfant, que je n’en aurais peut-être jamais, et que cette question pouvait inspirer mon travail. Moins d’un an après j’étais enceinte et je montais ce spectacle en partie enceinte, en partie en portant un bébé de quatre semaines dans mes bras… J’étais préoccupée par la question du futur, de ce qui vient après : comment ne pas arrêter le mouvement à soi-même, comment se mettre en circulation dans une énergie plus vaste que soi ? Le théâtre devait être circulation, et non pas objet, finalité. Le rôle du metteur en scène est de permettre cette circulation, de la rendre la plus énergique, rigoureuse et riche possible, partant de l’auteur jusqu’au public. J’ai alors dirigé mon premier atelier pour acteurs professionnels à Marseille, à la demande d’Alain Fourneau, directeur du Théâtre des Bernardines, un atelier qui a duré 4 mois, avec 30 comédiens ! Et j’ai découvert que je pouvais travailler avec 30 personnes dans la mesure où ce que j’enclenchais, c’était une circulation, des mouvements qui rebondissent, rejaillissent entre les différents interprètes. Ce travail m’a procuré un immense plaisir, il n’y avait pas de résultat, l’atelier a été présenté durant un week-end. J’ai eu ainsi l’impression d’avoir franchi un cap : ma période narcissique était terminée, il n’y avait plus de fantasme de « progrès personnel ». Et l’idée de circulation est devenue fondamentale. « À ceux qui naîtront après nous » a été la première réponse à cette problématique et deux ans plus tard je me suis dit qu’il fallait aussi trouver un moyen spécifique en dehors des productions. C’est à ce moment là, pour répondre à ces questions de la transmission et de la circulation, que ma compagnie s’est implantée à Schaerbeek. Chose difficile à faire entendre aux pouvoirs publics encore aujourd’hui : pourquoi, alors qu’il y a une dizaine d’années, je me trouvais dans des institutions de grande visibilité, les lieux de la réussite, suis-je allée m’enterrer dans un garage à Schaerbeek ?
F. V.: Il y a donc d’un côté l’école, l’INSAS et de l’autre côté le Théâtre Océan Nord où tu développes une pratique axée sur la transmission, tout en continuant à réaliser des spectacles. Comment se fait-il que ce mouvement de transmission se passe uniquement au Théâtre Océan Nord ? Ne déborde-t-il pas un peu sur l’école ?
I. P.: À l’école, je n’ai pas de responsabilité, j’essaie simplement d’enseigner et de répondre à des demandes précises. Mais je ne peux pas penser la pédagogie, je ne peux donc avoir un projet pour l’école. D’où l’ouverture du théâtre à Schaerbeek : afin de réaliser quelque chose de cohérent, un projet global. Je continue à enseigner à l’INSAS, je m’y implique beaucoup mais c’est une institution dotée de règles strictes, qui ne permet pas une grande mobilité.
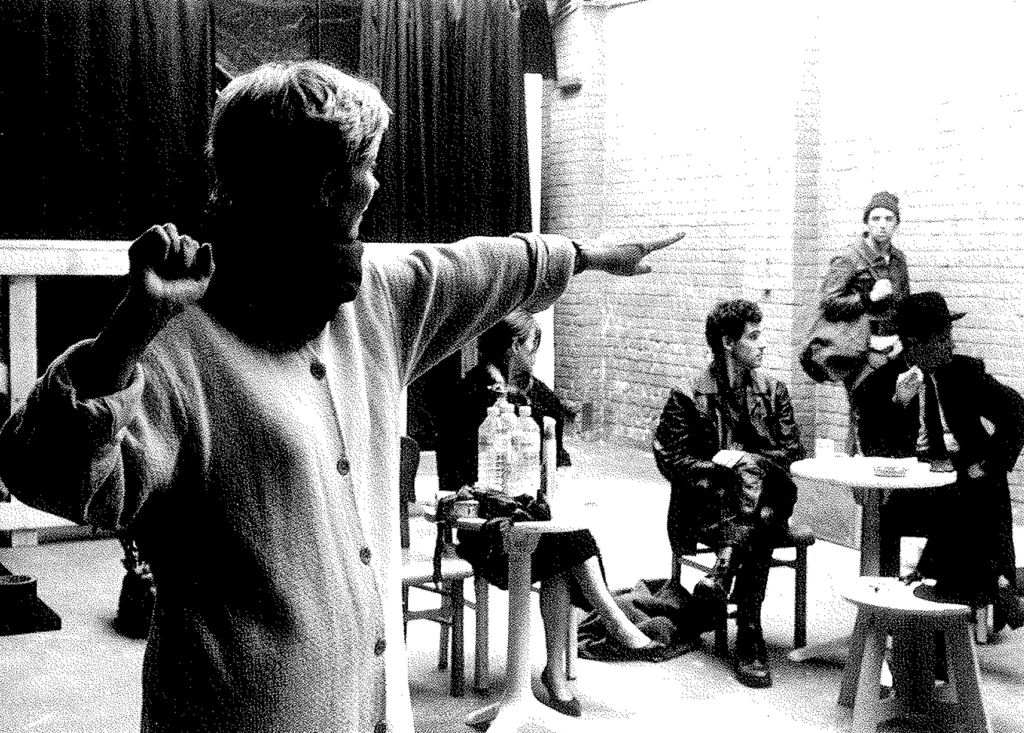
F. V.: Et tu ne peux changer cette institution de l’intérieur ?
I. P.: Il y a eu des tentatives de changement, qui se sont avérées très difficiles. Nous étions plusieurs à rêver de nouvelles écoles, notamment avec Thierry Salmon3. La situation politique actuelle en matière d’enseignement artistique ne permet aucune ouverture. C’est peut-être pour cela que j’ai initié cette pratique de la transmission au Théâtre Océan Nord. Mais en travaillant avec des acteurs professionnels, je ne vise pas le même public qu’à l’école.
F. V.: Un atelier hebdomadaire est en cours au Théâtre Océan Nord, le « Studio », que tu mènes avec une quinzaine de comédiens et praticiens. Comment cet atelier s’inscrit-il dans ton parcours de transmission, à la suite des ateliers pour comédiens professionnels qui se sont donnés à deux reprises durant l’été, 1997 et en 1999 – 2000.
I. P.: Ces deux ateliers s’inscrivaient dans la continuation de l’expérience entamée à Marseille. Pour moi, transmettre n’a rien à voir avec le savoir ni avec l’idée du « maître ». Si j’enseigne depuis très longtemps et si l’enseignement a toujours été présent dans ma vie, je ne me définis pas pour autant comme « professeur », au sens de celui qui sait, qui attribue des notes, qui juge et fait passer des examens. Je ressors toujours des examens d’entrée à l’INSAS, emplie de doute. Pour moi, le moment de la transmission c’est lorsque je me transmets moi-même au travail, je me mets en travail. C’est aussi pourquoi j’aime proposer à mes étudiants des textes que je ne connais pas. J’aime arriver avec un matériau que je ne maîtrise pas, mais ce que j’amène, c’est ma curiosité, ma fascination, mon étonnement, ma non-connaissance. Et cette non-connaissance produit du travail, de l’énergie, de la passion, elle est au coeur de la transmission. Enseigner ou élaborer un spectacle, c’est la même chose, seule la finalité est différente. Face à des acteurs, l’élément premier de la circulation est toujours ma propre mise en travail. À l’école, il faut pouvoir se donner en « modèle » de passion par rapport au théâtre, au texte, aux autres avec lesquels on travaille. Le théâtre est l’art de l’altérité absolue, il faut transmettre la rigueur, la pensée, et l’autonomie. Ce que j’ai expérimenté dans l’Atelier Quai-Ouest il y a dix ans, à Marseille, c’est qu’enseigner, c’est aller vers l’autonomie de l’autre, tout comme dans l’éducation d’un enfant, trouver l’endroit où agir afin que l’autre ne dépende plus de soi… Et donc l’axe de travail de ces ateliers pour les acteurs professionnels, c’est l’autonomie : jusqu’où l’acteur peut-il porter une parole, une pratique en n’étant pas dépendant ? Bien sür, il faut que je sois là, mais trente personnes peuvent travailler sans que je ne sois omniprésente. Le « Studio » qui est en cours cette saison, représente le point d’aboutissement de ce travail mais plus encore, le lieu même de l’aller-retour : je propose une interrogation, je la nourris, j’en fais part aux comédiens mais ce faisant, je sais que ce questionnement va rebondir chez eux et je le leur propose dans l’attente de leur réponse. Transmettre, c’est aussi recevoir et ce qui m’intéresse, c’est ce mouvement double, d’échanges. Le « Studio » participe peut-être d’une deuxième crise en rapport à la création et à la réalisation spectaculaire : j’ai l’impression que dans mes spectacles, je n’arrive pas à faire le lien avec cette problématique, je n’arrive pas à « inventer un nouveau théâtre », à nourrir mes productions des circulations que j’initie dans les ateliers. C’est pour cela que le « Studio » s’adresse à des comédiens professionnels. À l’école ou dans les ateliers pour amateurs, j’apporte des outils qui peuvent être enseignés. Mais avec les quinze acteurs professionnel du « Studio », il s’agit au contraire de recevoir aussi, de s’aider les uns les autres. J’ai du mal à dire ce que nous cherchons, je ne sais pas ce que nous allons trouver. Je sais que le besoin est là, il a suffi d’une seule séance pour le savoir et cette nécessité est le ciment du « Studio ». Pour le moment nous n’avons que de tout petits bouts de réponses. Mais l’idée de circulation est fondamentale.
Entretien réalisé et retranscrit par Fabienne Verstraeten, octobre 2001.
- René Hainaux : comédien, enseignant à l’INSAS et au Conservatoire de Liège. ↩︎
- Michel Dezoteux : metteur en scène et co-directeur avec Michel Delval du Théâtre Varia à Bruxelles. Il dirige la section « comédiens » à l’INSAS. Il a mis en scène cette saison LA CERISAIE de Tchekhov. ↩︎
- Thierry Salmon : metteur en scène décédé en 1999. Initiateur et metteur en scène de vastes projets théâtraux souvent issus de grands romans du XIX’ siècle et élaborés en plusieurs étapes clans le temps : DES PASSIONS d’après Dostoïevski ↩︎