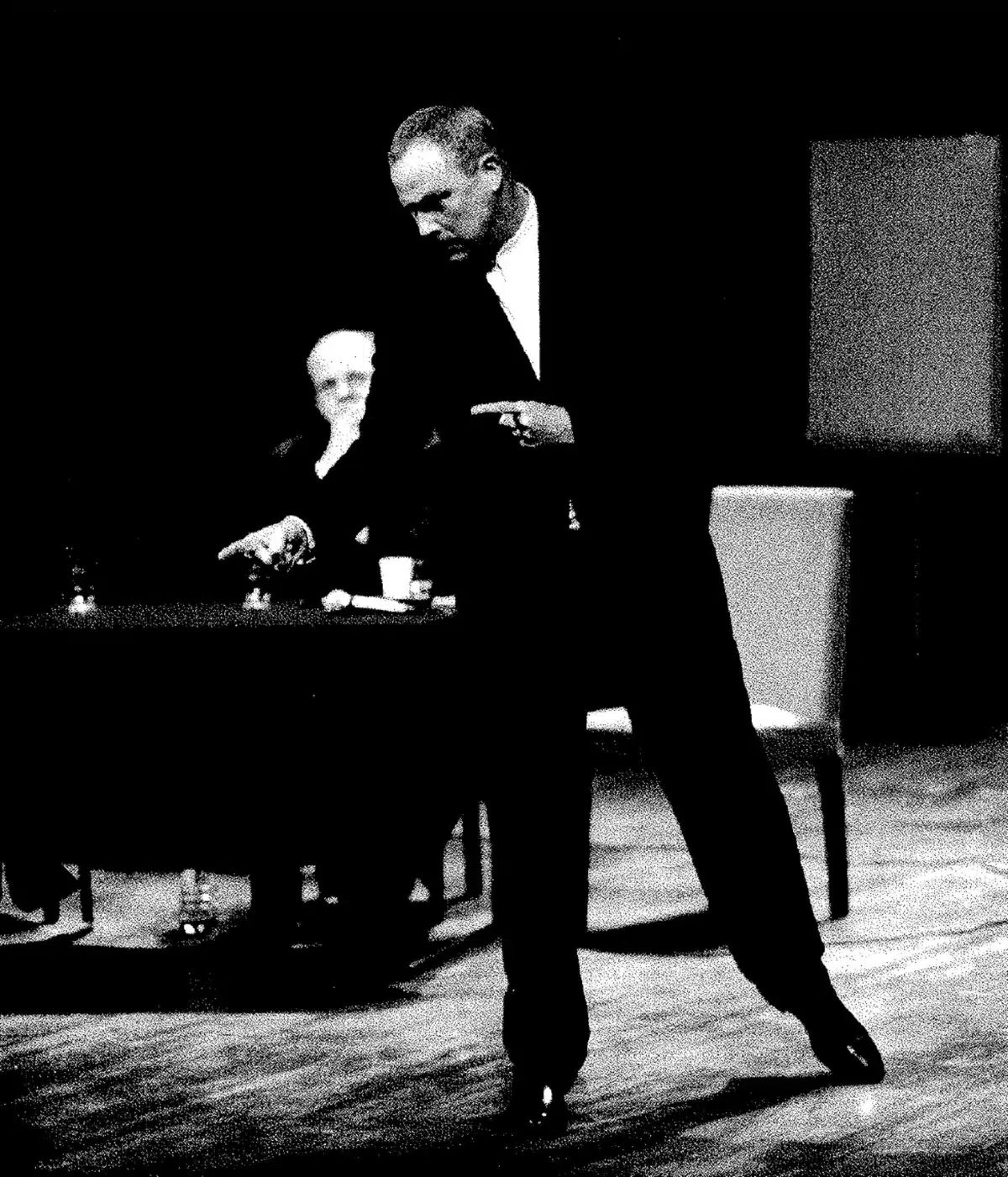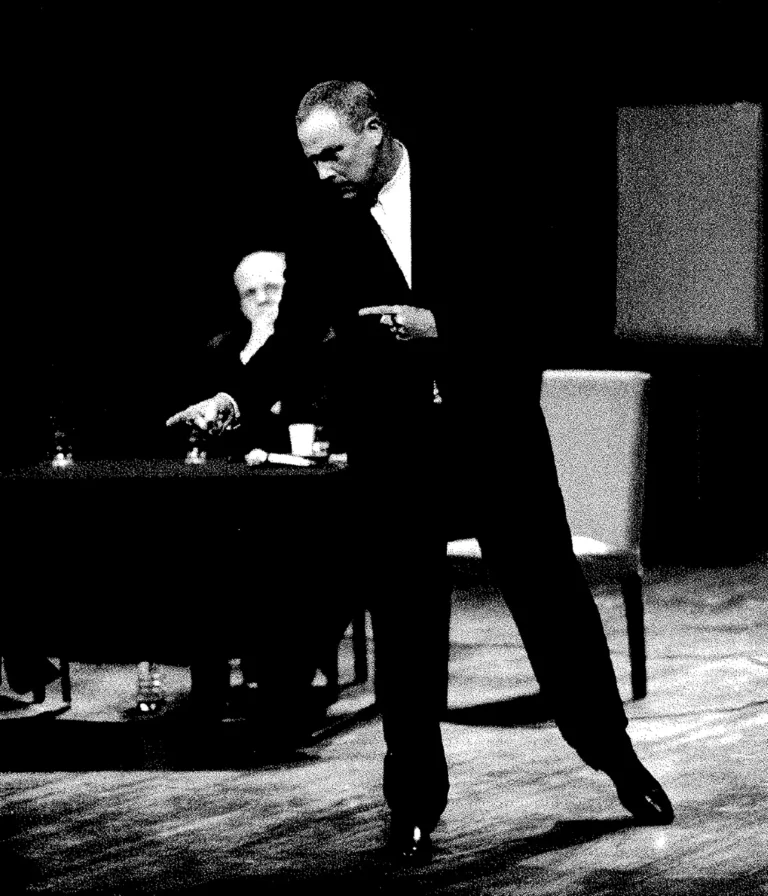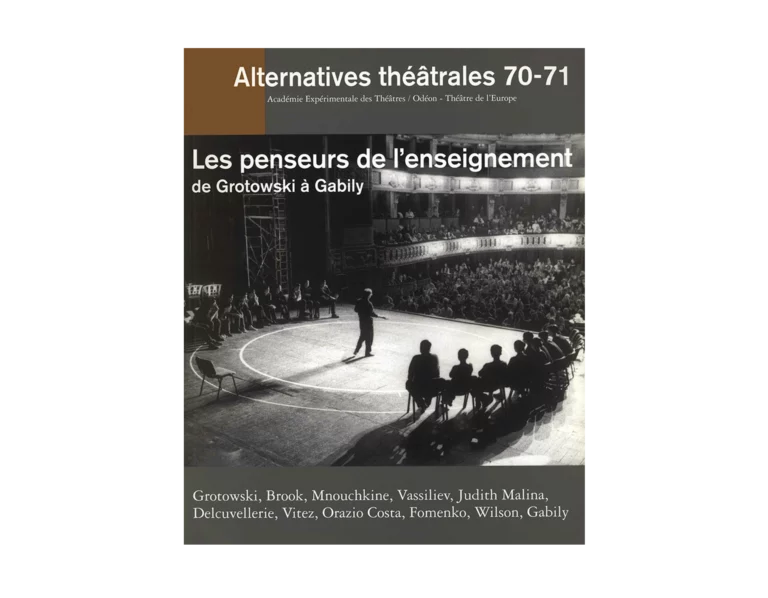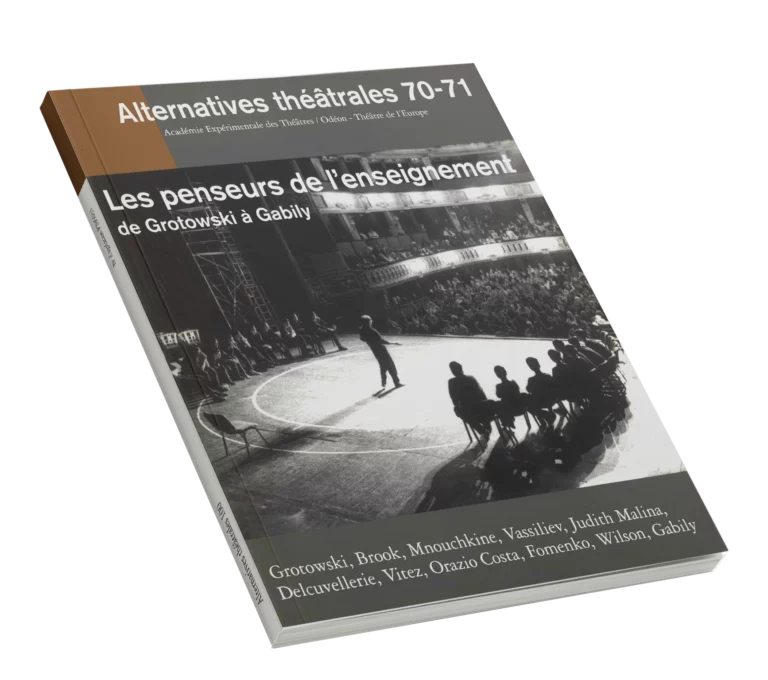« On n’apprend jamais rien.
Robert Wilson.
Ce qui importe, c’est l’expérience de l’apprentissage … »
DEPUIS 1992, Robert Wilson invite chaque été ses collaborateurs les plus fidèles, ainsi qu’un nombre limité de stagiaires, à le suivre dans l’aventure de la création de sa plus grande utopie : The Watermill Center, un laboratoire interdisciplinaire et international situé dans un environnement naturel.
The Watermill Center est l’aboutissement d’un rêve de longue date de Wilson : posséder un lieu dans lequel il pourrait expérimenter et travailler sur plusieurs projets à la fois. On trouve d’ailleurs plusieurs traces d’un tel désir dans ses archives : dans les années 60, sa compagnie, The Byrds, recherchait un lieu de création dans un environnement naturel en dehors de New York. Il s’est vu proposer un lieu dans sa région d’origine, à Waco, Texas, et en 197 3 on lui a offert un terrain perdu au fin fond de la Colombie Britannique. Ces lieux n’ont fonctionné que quelques années1. Ce n’est qu’à la fin des années 80, après avoir beaucoup travaillé à l’étranger et accumulé une fatigue résultant de ses déplacements incessants, que Wilson pensa de nouveau à son rêve. Un rêve qui commença à prendre forme avec la découverte d’une ancienne usine à Watermill, petit village situé au bord de la mer, à l’est de long Island dans les Hamptons, quartier très en vogue à deux heures et demie de route de Manhattan.
À première vue, ce qui lui plaisait surtout était que l’immeuble ressemblait au loft où il avait fait ses premières créations. Wilson y trouva cette union entre l’ancien et le très moderne, ambiance clé clans laquelle il préfère développer son travail. À l’origine, le centre avait été créé en 1926 par The Western Union qui y implanta un laboratoire d’électronique, afin d’y conduire des expériences et des recherches. Comme l’explique Wilson, « nous y faisons la même chose aujourd’hui. De jeunes artistes, des scientifiques peuvent se rencontrer pour faire des expériences dans ce lieu au sein de la nature »2.
Dans les années qui suivirent, Robert Wilson acheta le lieu qu’il donna par la suite à The Byrd Hoffman Founclation Inc. (une organisation sans but lucratif), avec laquelle il poursuit son travail depuis 1969. En 1992, ils fondèrent The Watermill Center comme une institution internationale afin d’aider à la nouvellee création artistique. Pour des raisons évidentes de sécurité, tout l’immeuble était à refaire. Aussi, pendant les quatre premiers stages d’été du centre, Robert Wilson, l’architecte Richard Gluckman et un groupe constitué d’architectes, de designers et d’étudiants ont collaboré à la remise en forme du bâtiment. Ils ont choisi de rénover les structures existantes et de créer de nouveaux espaces pour le dépôt d’archives et la collection d’art du Centre. À ce jour la rénovation n’est pas encore terminée ; c’est pourquoi le centre est uniquement animé pendant les stages d’étés. Il devrait voir les travaux achevés dans le courant de l’année 2005, date à partir de laquelle il sera ouvert toute l’année et se prêtera alors à des stages, des résidences d’artistes, des programmes d’éducation. Il fonctionnera comme lieu de conférences, comme lieu de stockage des archives de Robert Wilson et de ses collaborateurs, et comme lieu de présentation de la collection d’objets d’art et de meubles de Wilson (la Watermill Collection). Lieu protéiforme où peut-être Wilson s’installera le jour où il sera fatigué de continuellement se déplacer3.
Dans la réalisation du Watermill Center, Robert Wilson s’est heurté à de nombreuses difficultés matérielles. En Europe, notamment en France et en Allemagne, on lui a proposé à maintes reprises une telle possibilité. Pourtant, malgré ou peut-être à cause d’un manque manifeste de reconnaissance de son travail clans son pays d’origine, Wilson a insisté pour voir son utopie d’art se réaliser aux États-Unis4. Pour faire vivre un tel projet, il a dû convaincre ses sponsors et ses partenaires, activité clans laquelle il se montre très cloué et qui lui demande beaucoup d’énergie. Comme il l’écrit à la Byrd Hoffman Founclation, dès la fin des années 60 : « je passe tant de temps à faire du commerce, que je suis obligé de faire mon travail créatif en même temps »5.
Pour terminer les travaux comme prévu, dans les cing ans qui viennent, il manque encore quatre millions de dollars. Wilson contribue lui-même aux financements du Watermill avec l’argent qu’il perçoit en vendant ses réalisations (90 % de son salaire vient de l’Europe)6, et The Byrd Hoffman Fondation a crée un système de subventions privées. De plus, un gala de soutien a lieu sur place, au mois d’août, chaque année depuis 1992 (l’été 2000, la fête était conçue par Giorgio Armani, et le prix des billets d’entrée allait de $ 300 à $ 1000). C’est une manifestation très suivie par la presse newyorkaise, et l’on y voit de nombreuses célébrités du monde artistique ainsi que de richissimes personnalités des Hamptons. À cette occasion, Wilson semble prêter beaucoup d’attention à ses diverses relations et à leur reconnaissance. Cet événement, ainsi qu’une vente aux enchères de photos, sculptures et objets du maître, permet d’apporter $ 700 000 par an, et constitue une des ressources principales du Centre. Espérons qu’elle pourra garantir la fin des premiers travaux, pour lesquels le permis de construire prend fin dès l’année prochaine.
Il peut sembler contradictoire que Wilson réalise son utopie dans un pays qui, comme il le définit lui-même, se réclame d’une tradition théâtrale conservatrice et commerciale, où les subventions publiques soutenant l’art sont rares, voire inexistantes. Un système dans lequel il doit compter sur l’aide financière de riches amis, envers lesquels il doit rester reconnaissant. C’est pourquoi Wilson fait aussi appel à des sponsors internationaux : les stagiaires qui viennent pendant l’été sont en général financés par leurs gouvernements ou par des organismes culturels de leur pays. les demandes sont prises en charge par The Byrd Hoffman Foundation, qui fait appel à leur participation sur un projet précis, souvent commandé par une institution de leur pays. Wilson a créé le système des stages également parce qu’il préfère travailler avec des personnes qu’il connaît et sur fond de confiance mutuelle. Chaque séjour au Watermill revient environ à 40 000 francs. Une partie de cette somme sert aux frais divers, et une autre rentre dans la comptabilité du centre. Ainsi les différentes structures internationales contribuent à la construction de Watermill.
Wilson pense que l’important est de subventionner l’art là où il se réalise et de passer au-dessus du concept des nationalités : « … je crois que nous aidons chaque fois qu’est organisée une rétrospective consacrée à d’autres cultures du passé ou une exposition destinée à faire connaître d’autres arts qui nous sont contemporains, où qu’ils se produisent »7.
Il conçoit Watermill Center comme un lieu de congrégation pour un village global8. Dans le but d’expliquer son fonctionnement, il expose son exemple préféré de la pomme architecturale qu’il dessinait pendant ses études : « nous avons ce centre inflexible, ce cube de cristal au coeur de la pomme, qui reflète l’univers. Le cristal est le noyau, le coeur de la pomme, le centre du village, un peu comme la cathédrale à l’époque médiévale, un centre d’études, un lieu de rassemblement de gens de toutes conditions, un endroit où l’artiste avait sa place. C’est un centre d’activité, c’est un coeur, un centre vital, un endroit où des oeuvres peuvent être créées, peuvent être détruites, les oeuvres peuvent avoir une existence éphémère ou, au contraire, permanente. C’est un lieu de rencontre »9. L’objectif ultime est de rendre Watermill disponible durant toute l’année, qu’il devienne également un centre permanent, et ce longtemps après la disparition de Wilson lui-même.10
Le projet de Watermill est le fruit d’une pensée esthétique, d’une manière de voir le monde et d’un mode de vie. En ce sens, il se rattache à des utopies comme celle du Bauhaus. Wilson affirme qu’il veut ouvrir un laboratoire au sein duquel les artistes, expérimentés ou non, peuvent s’inspirer mutuellement. En ce sens, il renouvelle la pratique de la formation.
Par ailleurs, l’architecture reflète cette idée. La forme et la structure originelles sont préservées. C’est un bâtiment qui comporte de nombreuses fenêtres, ouvertures et peu de portes. Il existe une série d’espaces « multiculturels » qui servent au dessin, aux répétitions et à diverses expositions11.Tout cela clans le but de favoriser les échanges entre les différentes personnes et les arts.
Pour le moment, seule la cave de l’immeuble est utilisée comme lieu de documentation et d’administration du centre pendant l’été. Les autres espaces, en particulier l’espace de jeu et l’espace d’exposition, se trouvent à l’extérieur sous cieux grands chapiteaux blancs.
Ce sont des structures qui répondent à l’idée spatiale de Wilson : tout le monde peut toujours suivre les différentes activités du centre et se sentir invité à y participer. C’est un lieu qui paraît éphémère. Dans l’une des tentes, on trouve une exposition cl’ objets d’art du monde entier, dont de nombreuses chaises. Très régulièrement, Wilson implique les artistes invités clans les réajustements du placement des objets, selon ses indications. On peut parfois s’inquiéter pour la conservation de tous ces objets d’art, lorsque qu’il pleut par exemple, mais pour lui ce n’est pas important, comme son désir consiste à vouloir briser le rapport formel qu’a l’être humain moderne avec les objets d’art. « À Watermill nous travaillons et vivons avec les objets d’art ». Tout cela participe à la construction cl\m lieu sacré que tout le monde respecte.
Pendant les stages, les participants s’inscrivent dans un projet précis et restent au Watermill pour la durée de ce projet, qui varie entre trois et six semaines. Les stagiaires vivent dans le centre, ils travaillent tous les jours de la semaine, du matin au soir. Ce sont eux qui prennent en charge le lieu, qui s’occupent du jardin, du ménage et de l’organisation. Selon Wilson, « c’est dans le but d’établir une ambiance qui mêle le travail avec la vie et qui reflète l’idée qu’un artiste travaille différemment dans un milieu qu’il a lui-même contribué à créer et à prendre en charge par la suite »12. De temps en temps, on entend quelques personnes peu satisfaites de ce principe. Mais devant les tâches quotidiennes tous sont égaux, et cette manière de faire vivre le centre crée le lien entre les artistes afin qu’il travaillent ensemble. À Watermill, Wilson convertit en quelque sorte sa « démocratie esthétique de scène », comme le disait Heiner Müller, en processus de travail. Chaque individu vient dans le but de travailler sur les projets de Wilson, dont celui de Watermill, sans remettre en cause sa place de leader. Dans sa pensée, il est aussi important de faire la cuisine et le jardin que de travailler son art.
Pour Wilson, « la communauté de Watermill, c’est un groupe de gens qui se réunissent pour une courte période et établissent des échanges en fonction de leurs différences d’âge, d’expériences, de culture… »13. L’interaction libre entre étudiants et artistes, dans cet environnement naturel, fait de Watermill un lieu unique parmi les institutions artistiques clans le monde.
La population d’été varie entre 50 et 60 personnes chaque année. Des professionnels du monde artistique ont été invités pour collaborer sur des projets précis, comme Trisha Brown, Lucincla Chilcls, Philip Glass, Isabelle Huppert, Donna Karan, Miranda Richardson, Dominique Sanda ou Susan Sontag. Les stagiaires viennent de filières multiples : l’architecture, les archives, la médiation culturelle, le design graphique, la création de costumes, la mise en scène, la dramaturgie, la création de meubles, la lumière, la composition, le jeu d’acteur, la danse, la photographie, la production, la scénographie, le son, la vidéo, le cinéma… La plupart d’entre eux sont des étudiants accomplis et des artistes confirmés qui espèrent travailler plus tard avec Wilson dans un contexte professionnel, ou simplement en apprendre plus sur ses méthodes de travail inhabituelles.
Depuis le début des stages d’été en 1992, le programme a développé un grand nombre de nouveaux travaux pour des théâtres et musées dans le monde. On peut parler d’une usine de production, proche de la Factory d’Andy Warhol, collaboration libre où les gens vont et viennent — selon les envies de Robert Wilson. L’accès aux stages se fait en général par invitation, et ce pour des artistes et étudiants qui travaillent déjà avec Wilson. The Byrd Hoffman Foundation essaie, dans la mesure du possible, de trouver des bourses pour les participants, et pour ceux qui financent eux-mêmes leur rêve de travailler avec le maître, il y a régulièrement des déceptions au vu du déséquilibre entre tâches physiques et création artistique : on voit parfois des stagiaires repartir assez vite après leur arrivée. Mais « il n’est pas seulement question d’une expérience unique », comme l’explique Carlos Soto, qui participe aux stages depuis 1997, « on sait que cela va continuer : si ce n’est pas en tant que performance qui sera diffusée pendant quelques années, ce sera pour la création du centre lui-même… Ce qui a été créé à Watermill continuera à vivre ».
À Watermill les stagiaires sont en constante activité. Quand ils ne travaillent pas sur les projets dans lesquels ils sont inscrits ou dans lesquels ils se sont intégrés au fur et à mesure du stage, ils aident à la cuisine ou travaillent dans le jardin. Si quelqu’un veut quitter le lieu, même pour peu de temps, il faut qu’il en demande l’autorisation à Wilson ou à son assistant. Même si le maître, la plupart du temps, semble très occupé par ses multiples projets, il semble s’apercevoir de tout, jusqu’au moindre détail. Il arrive régulièrement que Wilson change ses plans, auquel cas il demande à chacun d’être présent et de se tenir informé de l’évolution des différents programmes en cours, organisés par Felipe Fernandez et Clemens Thornquist, les administrateurs de Watermill, Stefan Lang et John Ackerman, les assistants personnels de Wilson, et Sue Jane Stoker, son fidèle régisseur qui le suit dans un grand nombre de ses productions.
Le matin les participants prennent ensemble le petit-déjeuner et assistent ensuite à une réunion d’information sur le programme de la journée. Tous les jours, un certain nombre de visiteurs sont accueillis à Watermill : des journalistes et des photographes, des voisins, des bienfaiteurs et des amis de Wilson. De temps à autre des compagnies de théâtre locales montrent leur travail au coeur du centre et des jeunes profirent du programme d’éducation proposé par Watermill et dirigé par Andy De Groat, Marianna Kavallieratos, Ines Somellera, Kameron Steele, Meg Harper et André Gingras.
Pendant leur visite, tous sont invités à goûter aux oeuvres d’un autre grand maître, Ismail Ahmad, chef de cuisine malais, avec les autres artistes du Watermill et Wilson. Moment privilégié entre tous pour parler à Bob, pendant lequel il se détend et raconte des anecdotes. Il redevient ensuite le maître, incarnant la discipline même, possédant un étonnant regard transperçant.
Robert Wilson semble être un homme paradoxal. Un homme enfermé dans un monde solitaire par sa responsabilité artistique, ce qui tend parfois à frustrer les artistes qui ressentent alors un manque de communication. C’est aussi une personne extrêmement sociable, constamment entouré, se souvenant des noms et des détails personnels de chacun, adorant la présence d’enfants pendant les stages. Wilson considère les six semaines passées à Watermill, pendant lesquelles il travaille jusqu’à seize heures par jour, comme ses vacances d’été. Il aime rencontrer de jeunes artistes ambitieux pour provoquer leur talent. Au début de sa carrière, il a beaucoup travaillé avec des gens sans formation rencontrés au fil de ses pérégrinations. Plus tard, il s’est intéressé à ceux qui possédaient une technique de travail et a commencé à travailler avec des professionnels, toujours en intégrant des personnes sans formation dramatique, dans l’intention d’apprendre sur la valeur théâtrale inattendue du simple fait d’être et de faire. Tassy Thomsson, une plasticienne écossaise, fait partie des artistes gravitant autour de Wilson qui sont devenus comédiens par hasard. Elle dit de lui « qu’il lui est égal qu’on soit acteur ou non. Certaines fois il préfère même travailler avec des non-acteurs sur scène. Grâce à mon métier de sculpteuse, dans lequel je « dessine des lignes dans l’espace », j’ai une compréhension de ce que voudrait Wilson dans son travail de scène ».

Les méthodes pédagogiques de Robert Wilson concernent surtout le travail corporel. Il a observé que souvent les jeunes ont du mal à « trouver » leur corps, et c’est à cela qu’il s’emploie à Watermill. « Le corps est notre instrument, que l’on soit mathématicien, danseur, chanteur, enseignant, scientifique… C’est par lui que tout se fait ; la connaissance gît dans le corps. Socrate dit que le nouveau-né sait tout dès l’origine, que l’enseignant ne fait qu’éveiller la connaissance que chacun porte en soi. Pour lui tout est inscrit dans le corps… »14. Wilson est d’avis que « le corps va plus vite que la tête et laisse fuser imperceptiblement des sentiments complexes ». Ce qui l’intéresse, c’est la complexité des sentiments exprimés dans le corps, sentiments très fugitifs qui ne sauraient être rendus par un jeu psychologique où chaque émotion est indiquée a priori par le metteur en scène. Wilson ralentit la vitesse du corps et fait surgir des émotions fugitives qui restent intérieures. La lenteur chez lui découle des préoccupations des milieux avant-gardistes de la danse, qui trouvent leur origine dans le Judson Dance Theater de New-York et s’inscrivent en réaction à la virtuosité de la chorégraphie classique, et chez qui le mouvement est au centre de toute une recherche qui adapte à la scène les anciennes découvertes de la chronophotographie et la tendance contemporaine au minimalisme en peinture et en sculpture. « On fouille, on détaille sa structure profonde, on analyse sa réalité séquentielle en intervenant sur son tempo. »15 Pendant les séances sont exécutés des « concerts de danse » où l’on pratique notamment la technique du « slow motion ». C’est un mouvement ralenti, mais ce n’est pas tant le choix du tempo qui le définit, que ce que l’on perçoit au moment où on est en train de l’exécuter : l’expérience à travers l’étirement du temps.
À l’inverse du metteur en scène occidental traditionnel, Wilson se refuse à privilégier certains sentiments, et laisse toute latitude au spectateur pour faire son choix16. Pendant les stages à Watermill, il montre aux participants comment marcher, comment bien distribuer le poids dans le corps, comment se contrôler comme un danseur, en enchaînant les gestes. Il rééduque ainsi le physique : marcher sans balancer les bras et maîtriser toujours chaque attitude. Aux nonacteurs, Wilson fait des remarques comme s’ils étaient comédiens de profession : « Fais attention où tu t’assois. Bouge dans ton esprit avant que tu ne bouges ton corps ». Les acteurs professionnels espèrent garder leurs rôles dans le projet final. Et à ceux-là, Wilson fait des remarques plus sévères : « Fais attention à ne pas t’exprimer, s’il te plaît. Si tu essaies de le faire, cela devient insupportable… d’abord, juste le mouvement. Ainsi tu le sens. Le mouvement est déjà là. On ne peut jamais commencer un mouvement. Le mouvement ne peut que continuer ».
Pour Wilson, ce qui importe c’est la perception « de chaque infime mouvement corporel et de son rapport exact à l’espace où il se meut »17. C’est là une idée qu’il tient de Alwin Nikolais, avec lequel il a étudié. Nikolais demandait à ses danseurs de « bouger si lentement qu’on ne voit pas le mouvement, seulement le changement qui survient dans l’environnement pendant ce temps »18.
« Le temps n’est pas un concept. Si on le considère comme tel, on limite l’expérience qu’on en fait. Si je dis à quelqu’un : « Bouge lentement », c’est ennuyeux. Mais si on le fait sans y penser, dans le mouvement il y a toute une pluralité de temps. Ils se passe des milliers de choses dans un geste… C’est une question de construction et de décision ».
« L’acteur doit être aussi précis que possible avec son corps. Croyez-moi, c’est la seule façon de battre la machine ». Wilson décompose, ralentit un temps qui prend sa source dans une logique orientale comme on peut la voir à l’oeuvre dans le ballet balinais et le théâtre Nô. Le travail d’acteur chez Wilson consiste à apporter ses secrets personnels, son mystère, à être toujours présent et jamais déchiffré. Wilson dit « penser » : « Penser à chaque instant, sans révéler, sans expliquer au public, mais toujours laisser une énigme ouverte… » Jouer au bord. Il s’agit de toujours installer une tension, un danger permanent. Comme le raconte Phillipe Chemin19, « c’est déjà un véritable manifeste de l’art de jouer wilsonien… Il ne demande aucune interprétation d’un personnage préfiguré et ne se livre à aucun commentaire sur le texte. Il abandonne l’acteur sur scène, livré à lui seul ; la personne est là, avec son expérience s’apprêtant à devenir personnage ».
Les acteurs de Wilson doivent devenir sensibles à la qualité de l’espace et être suffisamment préparés pour percevoir à chaque instant l’espace dans son ensemble. Ils doivent savoir que même un infime mouvement du corps provoque des réajustements de l’ensemble de l’image ; ils doivent pouvoir l’imaginer, le prévoir pour le maîtriser. Apprendre la « physique wilsonienne » implique une très grande discipline. Wilson demande en quelque sorte au comédien de s’effacer et de désapprendre a jouer : « devenir pantin pour pouvoir entrer dans la vision wilsonienne », comme l’écrit Laurent Gaudé20. Watermill est avant tout une belle école d’humilité et de discipline. Selon Wilson, « on n’apprend jamais rien. Ce qui importe, c’est l’expérience de l’apprentissage… » L’année dernière, il commençait le travail du stage en lisant un texte de Martha Graham : « Il n’est pas nécessaire de croire en soi-même ou en son travail. Il est nécessaire de rester ouvert et directement conscient des besoins qui motivent. Garde toutes les voies ouvertes. Il n’y a pas d’artiste satisfait. Il n’y a aucune satisfaction à aucun moment. Il n’y a qu’un étrange mécontentement jamais en repos, qui nous oblige à aller de l’avant, et nous rend plus vivant que les autres ».
Wilson est de l’avis « qu’on devrait brûler toutes les écoles de théâtre ». Si on lui demande qui est le professeur idéal, il répond que c’est celui qui ne donne pas de réponse, comme son professeur qui enseignait l’histoire de l’architecture devant trois écrans lumineux représentant des oeuvres disparates de plusieurs architectes. « Ce qu’elle disait n’avait aucun rapport avec ce qu’on voyait. Elle ne nous donnait pas de réponses… Dans ses cours, elle pratiquait des associations libres, (…) on devait nous-mêmes faire les rapprochements, et je crois que c’est ainsi qu’agit un bon metteur en scène, un bon acteur, qui suggère des connexions et reste ouvert à des possibilités qui n’étaient pas là au départ ».
Dans son laboratoire à Watermill, Wilson s’inspire de l’apport personnel de chacun des participants. Il est d’avis qu’avec le dialogue et l’échange qui se font au moment du stage il a souvent l’impression d’apprendre plus des jeunes artistes qu’ils n’apprennent de lui. « Je ne suis pas le genre d’artiste qui peut être assis à une table a écrire tout seul. J’aime travailler avec des gens. Ici, c’est mon studio, et j’aime aller visiter les studios d’autres artistes. Alors c’est très sympa que les gens viennent à mon studio, pour travailler et ensuite l’amener au monde ».
Les critiques l’accusent fréquemment de tomber dans le piège du maniérisme, des répétitions faciles, de faire des productions en série, et ils questionnent son rapport au texte. Wilson se situe au delà du débat qui opposerait qualité et quantité : « je travaille à mes projets sur une longue durée. J’en commence un, ensuite je le laisse, en commence un autre, le laisse, puis je reviens au premier que je vois alors selon une autre perspective, puisque j’ai pensé à d’autres choses entre temps. Mais j’ai vécu avec durant tout ce temps. Il m’est resté en arrière-pensée ».
Watermill joue un rôle important dans son processus de travail habituel, qui passe par plusieurs phases :
- Wilson dessine les scènes en prenant en compte l’espace scénique dans lequel va se dérouler la représentation.
- Quand il travaille, par exemple, avec un compositeur, il lui transmet ses dessins, pour qu’il puisse se laisser inspirer par ces derniers pour composer la musique.
- Wilson commence à travailler avec des stagiaires à Watermill et filme les répétitions. En regardant les scènes enregistrées, le compositeur peut écrire les paroles et la musique. De cette façon, il a une image avec laquelle il peut travailler, il a un modèle de la scène. C’est ainsi qu’il comprend l’idée de Wilson, et par la suite leur collaboration peut commencer.
L’ambiance pendant les répétitions peut apparaître curieusement peu orthodoxe, avec des photographes, des peintres et des historiens d’art, stagiaires, qui occupent la même place que des acteurs et des danseurs expérimentés21. Les stagiaires l’aident à créer son spectacle, en sachant qu’il y a peu de chances que les mêmes personnes fassent partie du spectacle final. Comme le dit Holger Teschke, du Berliner Ensemble, « le projet de Bob est de tout planifier depuis Watermill, et ensuite de partir travailler le vrai spectacle avec les stars ».
Watermill est beaucoup plus qu’une entreprise de création, c’est une entreprise dont tout le monde tire profit. Les stagiaires sont respectés individuellement par Wilson et sont heureux de pouvoir rencontrer d’autres artistes du monde entier et de collaborer avec eux, pour d’autres projets également. Selon Stephen Korns, « Watermill Center n’est pas une colonie d’artistes. C’est un lieu où nous pouvons évoluer en tant que collègues dans un monde d’art ».
L’été dernier, Wilson avait invité un groupe d’hommes d’affaires et de scientifiques du monde entier, pour participer à une conférence traitant du sujet de sa nouvelle pièce : « A ventis, la vie dans le XXIe siècle ». L’environnement créatif de Watermill provoqua des rencontres entre les arts et les sciences. À ce propos, l’anthropologue Edmund Carpenter affirme : « Watermill Center est l’académie du XXIe siècle ».
The Watermill Center est pour Robert Wilson, un lieu des possibles, où à travers le théâtre se réunissent des praticiens de toutes sortes. Une oeuvre-maîtresse, qui, espérons-le, résistera à l’épreuve du temps et de l’histoire.
- Newsletters, Byrd Hoffman Foundation, 1965 – 1975 . ↩︎
- Woodall James, « Laboratory experiments », Financial Times week-end, 19 – 20 août 2000. ↩︎
- Korteweg Ariejan, « Listen with your eyes, Robert Wilson’s laboratory on Long Island », Volkskrant. 24 août 2000. ↩︎
- Mayer Margit J., « Meeting Mr. Wilson, A great genius of contemporary and opera », Swissair Gazette, octobre 1998. ↩︎
- Wilson Robert, « Letter to BHF », handwritten. In : Robert Wilson Papers, C‑General Files-Series I. Box 9, Early BHF Correspondence, 68 – 70. ↩︎
- Théâtre / Public, n°106 sur Robert Wilson. ↩︎
- Thierry Grillet / Robert Wilson, « Wilson selon Wilson », in Théâtre / Public n°106, p 12. ↩︎
- Jan Linders, « Let the Piece Talk to You », in Théâtre / Public n°106. ↩︎
- Thierry Grillet / Robert Wilson, « Wilson selon Wilson », in Théâtre / Public n°106, p. 11. ↩︎
- Ariejan Korteweg, « Listen with your eyes, Robert Wilson’s laboratory on Long Island », Volkskrant. ↩︎
- Jean Poderos, « Une semaine avec Bob Wilson », Beaux Arts, Paris, n°161, oct. 1997, p. 112. ↩︎
- Grande brochure sur « Watermill Center » donnée par The Byrd Hoffman Foundation, 155 Woster Street, Suite 4F, New York, NY 10012. ↩︎
- Jean Poderos, « Une semaine avec Bob Wilson », Beaux Arts, Paris, n°161, octobre 1997, p. 112. ↩︎
- « Bob Wilson, le génie des lieux », Le Monde de la Musique, n°205, décembre 1996. ↩︎
- Frédéric Maurin , Robert Wilson, Le temps pour voir, L’espace pour écouter, Actes Sud, 1998. ↩︎
- Philippe Chemin, « En passant chez Wilson », Théâtre/ Public n°06. ↩︎
- M. Croyden, Lunatics, Lovers and poets, New York, Éditions MacGraw-Hill, 1977, p. 214. ↩︎
- L. Shyer, Robert Wilson and his Collaborators, New York Communication Group, 1989, p. 290. ↩︎
- Philippe Chemin. « En passant chez Wilson », Théâtre / Public n°106. ↩︎
- Laurent Gaudé, « Robert Wilson et la « super-marionnette », ou la dépossession consentie du comédien », Alternatives théâtrales, décembre 2000, n°65 – 66. ↩︎
- James Woodall, « Laboratory experiments », Financial Times week-end, 19 – 20 août 2000. ↩︎