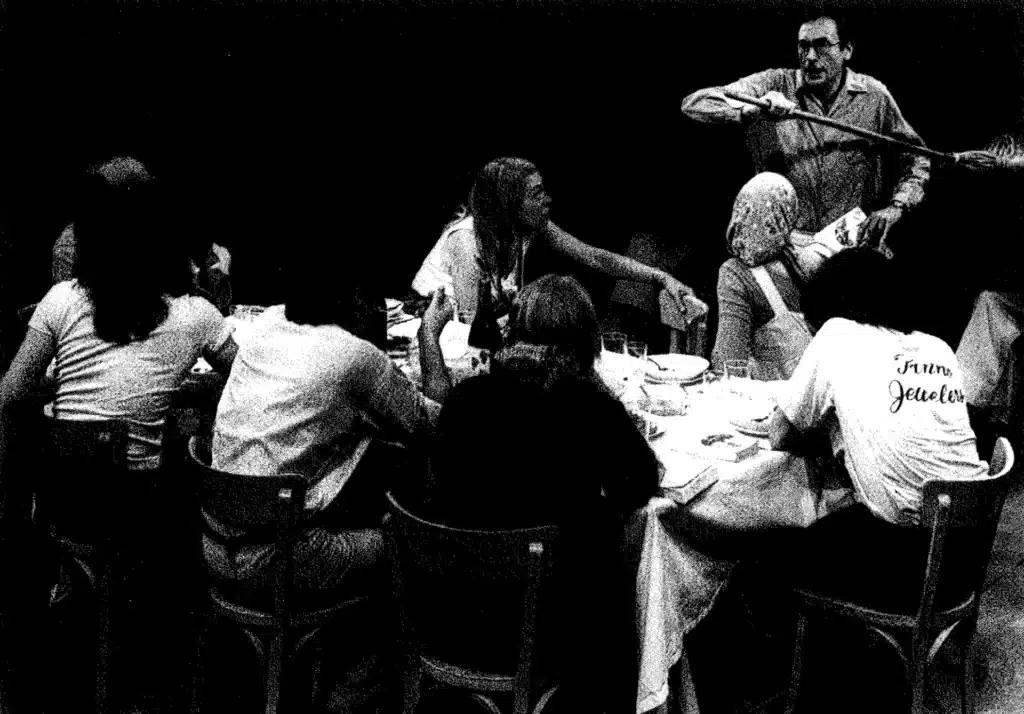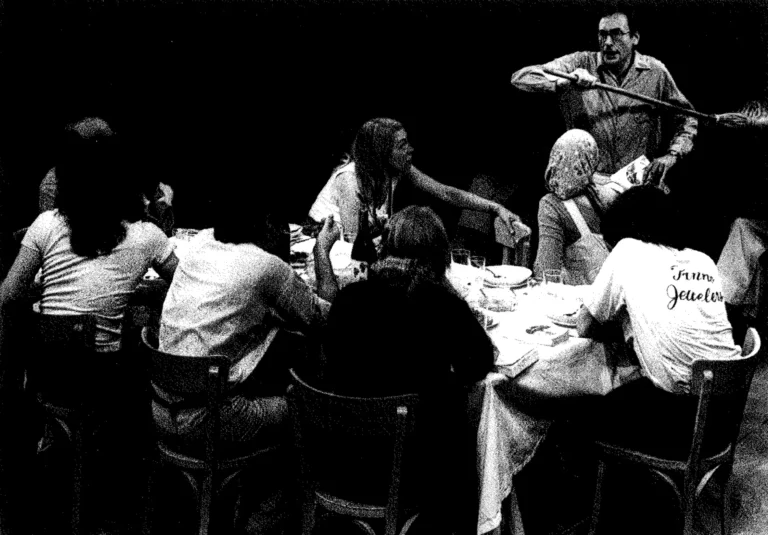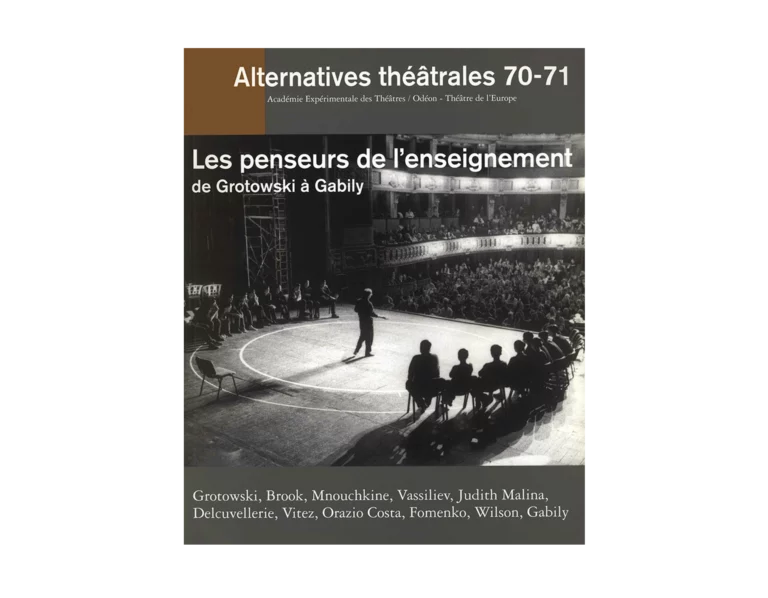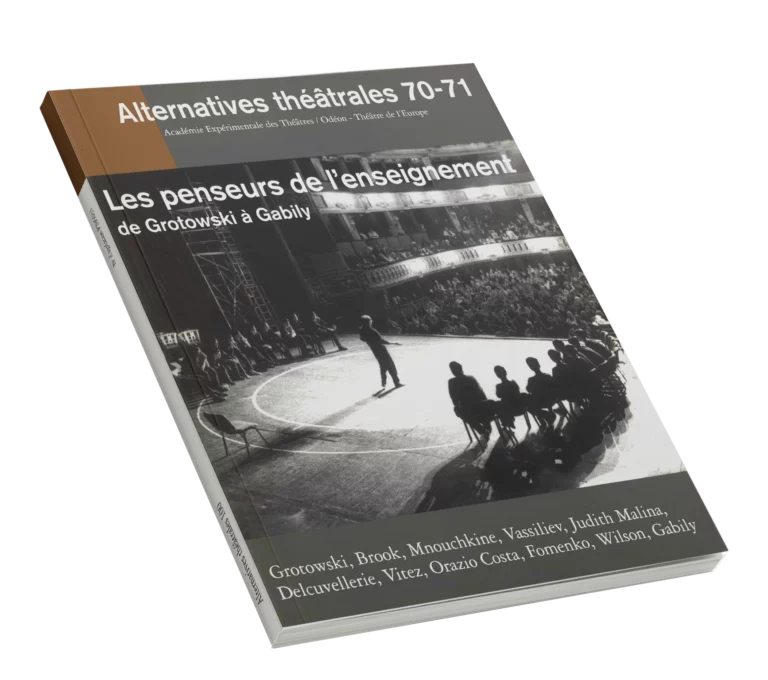Toutes les citations d’Antoine Vitez viennent du volume L’ÉCOLE, édité par Nathalie Léger, Paris, éd. POL, 1994.
POUR VITEZ, l’enseignement a été son ermitage. Homme de tous les désirs — il voulait constamment Tout ! — cette activité souvent qualifiée de secondaire s’est constituée en règle monastique jamais enfreinte, toujours respectée. L’enseignement, il l’a pratiqué, réclamé et imposé comme le centre irradiant de ses activités théâtrales qui, à leur tour, par le succès rencontré, ont rejailli sur les pratiques pédagogiques inlassablement exercées. « L’enseignement fait partie de ma vie, et je ne saurais pas me passer de l’expérimentation constante ». L’originalité de son positionnement, de même que celle de Piotr Fomenko aujourd’hui, vient aussi de là, de cette fidélité à l’école jamais démentie. Elle fut, pour filer la métaphore, l’espace où, sans relâche, il entendait faire retraite. Et forcément se régénérer. De l’école il a sans cesse éprouvé le besoin. Et ne répondait-il pas à la question que je lui posais sur la suite de sa vie une fois terminée la direction de la Comédie-Française : « Ouvrir une école chez moi, à Bièvres ». L’école, au terme d’une carrière, devait finir par intégrer, plus que l’espace d’un théâtre, celui de la maison même, afin de constituer une sorte d’abbaye pédagogique. Là-bas, le maître retiré aurait pu chercher refuge et, à l’écart, poursuivre son oeuvre de formation . Mais, à cet ultime repli, Vitez n’eut pas droit. Il reste sa fiction inaccomplie : l’école comme recommencement.
Vitez a développé et cultivé le dispositif du vieil homme parmi les jeunes. « J’ai fondé tout mon travail sur la jeunesse ». Cela renvoie, sans doute, à Faust, le personnage de Goethe dont il avait fini par faire son double. En se plaçant dans cette posture, Vitez a souhaité instaurer une relation pédagogique où l’âge, en premier, légitimait sa posture. À ses débuts, pourtant tardifs, il pouvait enseigner, pas encore au nom d’une oeuvre accomplie, mais de la recherche préliminaire menée en solitaire. N’oublions pas que lorsqu’il arrive à l’école Jacques Lecocq nul prestige artistique ne l’accompagne et qu’il s’appuie sur un projet théâtral inconnu, sans cesse reporté, projet qui pourtant alimente son enseignement. Avant de l’accomplir au théâtre, il l’expérimentera dans les salles de cours. Pour y parvenir, l’âge devait lui accorder d’abord une autorité morale. C’est à partir de cette hauteur qu’il a toujours parlé.
Parlons encore de l’âge. Il lui emprunta son statut, mais il fut aussi sa ruse. Vitez qui surprenait ses élèves par l’extravagance de ses propositions ne pouvait qu’accroître leur effet en s’autodistribuant dans le rôle du vieux maître indigne. Cette indignité-là séduit surtout lorsque celui qui s’y livre semble être voué à la sagesse et à la réserve. Vitez surenchérissait sur l’âge pour mieux le subvertir et en même temps bénéficier de la plus value dont celui-ci est porteur. Dans cette stratégie on peut reconnaître l’empreinte d’Aragon.
Vitez s’imagine en maître, certes, mais étranger aux prérogatives habituelles de la fonction : « maître sous une apparence non directive ». Le comble de l’élégance… N’a-t-il pas toujours perturbé l’usage habituel des emplois ? Ici il s’attribue lui-même un rôle dont d’emblée il envisage la subversion. Parce que trop inquiet, et seulement en apparence assuré de ses certitudes, Vitez ne pouvait pas s’ériger en « gourou », et de cette faiblesse même il entendait tirer profit. « J’ai dit qu’il ne faut pas… Point de norme ». La modernité de l’enseignement provient aussi de là, de la reconnaissance de son inaptitude à livrer des valeurs sûres. « Il m’est absolument impossible aujourd’hui d’articuler un enseignement de l’acteur… il est en mouvement, il change » car « on ne doit rien laisser se fixer, demeurer ».
L’enseignement de Vitez se refuse au scepticisme et au désengagement. Il a toujours dispensé des leçons d’énergie, mais, à son tour, la présence des élèves l’aidait souvent à régénérer celles-ci. S’il a aimé enseigner c’est aussi dans la mesure où il a cultivé et développé cet échange-là.
L’enseignement de Vitez confirme la justesse de cette phrase de Gilles Deleuze : « c’est ce qu’on cherche qu’on enseigne le mieux ». Son théâtre, finalement, s’est constitué ainsi. « Nous cherchons ici des gens pour inventer ensemble perpétuellement le théâtre ». Quête et utopie se confondent et l’école s’avère être l’espace le plus propice pour pareille aventure. Enseigner, « un travail utile pour les autres qui est le meilleur moyen de nous rendre service à nous-mêmes ».
Vitez se reconnaît épris de « l’immaturité », terme qui renvoie à Gombrowicz, auteur qu’il ignorait, mais dont on peut le rapprocher même s’il se réfère plutôt à Tchekhov et Pavese. « L’immaturité » n’est pas la jeunesse… elle est distincte, autre, car « la maturité » sé constitue en son horizon d’attente. Vitez s’est placé au coeur de cette tension car, lui, l’être adulte par excellence, se montre attiré par « l’immaturité » comme contrepoison à même de stopper les méfaits du sérieux, de la responsabilité, du programme, bref de tout ce qu’il défendait par ailleurs. Enseigner c’est une manière de résister aux exigences de l’extérieur de même qu’aux menaces de la maturité. Dans ce sens l’école, pareille à tout espace clos, protège grâce aux murs qui l’entourent et « l’immaturité » trouve un droit de cité.
Il n’y a rien de plus réfractaire à l’anonymat que la jeunesse. Elle exige le droit à la subjectivité, à l’affirmation de soi, voire même au scandale. Et Vitez à qui Balachova a appris, le goût pour « des exercices scandaleux » aimait cela. La remarque intéresse dans la mesure où l’on peut, une fois encore, déceler là une de ces tensions chères à ce pédagogue écartelé : il réclamait le terme de « maître » sans pour autant s’assigner au devoir de réserve et d’anonymat que pareil statut implique. De même qu’il aimait être un vieil homme indigne, Vitez a adoré aussi être un maître dévoyé. Se réclamer de la norme et en même temps oeuvrer à son détournement — tel fut son programme. Programme « scandaleux ».
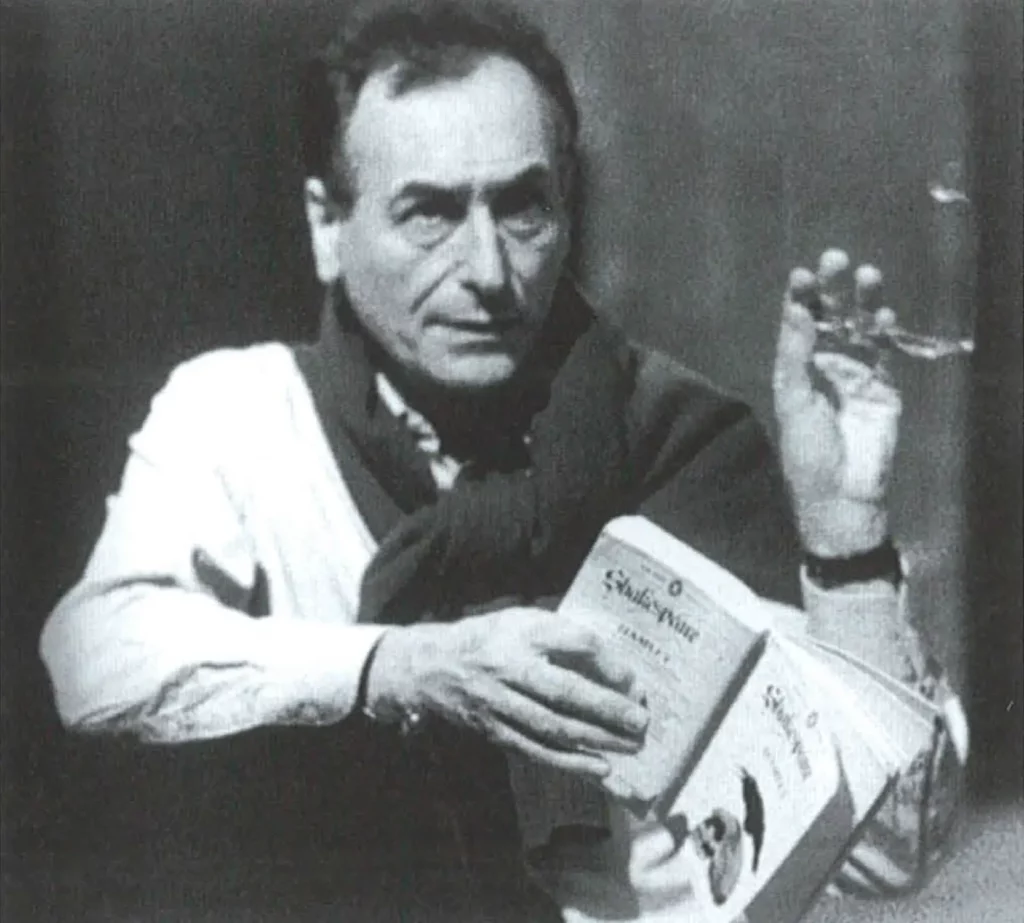
L’école a servi d’échappatoire à cet artiste « engagé ». Lui qui parlait de politique et de cité, d’histoire et de responsabilité a érigé la salle de cours en espace de la gratuité. Comme s’il entendait se reposer ainsi de toutes les tâches assumées pour ses représentations publiques. Vitez a considéré que l’école cire sa raison d’être de l’oubli des contraintes, du sacrifice de la responsabilité, bref de la sauvegarde du droit à l’inutile. Oublier la perspective de la mise en scène pour se livrer à la désinvolture de l’exercice, du crayonné, e.c, par là, de l’inachèvement. Éprouver « une sensation de gratuité » est essentiel car « l’école doit être inutile ». Comme la cerisaie … elle invite à se dégager de la menace de l’utile. Et Vitez, las des critiques de ses propres étud iants, m’avouait un jour l’envie d’abandonner le Conservatoire où « les élèves en crise me demandent sans cesse des solutions pour les emplois dans les théâtres, pour leur carrière. Ça, je ne peux pas le leur apprendre. Mon enseignement perd ainsi sa raison d’être : la liberté ». L’école a été pour Vitez un interstice, un intervalle, un entre-deux. Elle lui a permis d’assurer le va-et-vient encre l’artiste ciroyen et le pédagogue inassouvi. Et ainsi de survivre au coeur des contradictions que pareil programme procure.
Vitez s’est montré dès ses débuts réfractaire à l’étanchéité des années et des classes du Conservatoire au point que, polémiquement, il fut le premier à avoir procédé à leur ouverture. Ceci afin de constituer l’école en un espace généracionnel, où les jeunes parviennent à communiquer et à affirmer une identité collective. Un jour, regardant réunis autour de la tombe ouverte les camarades d’école du jeune comédien disparu, il réfléchissait : « ainsi… naissent les mouvements et les courants dans l’histoire de l’Arc : quelques uns qui se rencontrent dans une école et qui s’aiment » . Enseigner c’est aussi veiller à l’humanité des relations, à la chaleur des échanges, au bien être de ces candidats aux aventures de la scène. Le pédagogue est appelé à fonder une communauté passagère. Et, avec un scepticisme léger, Vitez admet : « on n’y préjuge pas du destin des gens ; ils se seront au moins rencontrés là ».
La posture de Vitez a été socratique. Il a fondé son enseignement sur le dialogue. Ce donc il s’agit c’est de répondre à la question avancée par le maître qui, ensuite, en échange commente, apprécie et critique : c’est parce qu’ il parle qu’ il forme. « Le professeur propose des exercices et enseigne à les lire ». Ainsi il souhaite créer un comédien capable de se nourrir du jugement porté sur le travail ; c’est en cela que le modèle vitézien est socratique. « L’acteur devient un créateur quand il peut prendre conscience de ce qu’il fait et en nommer les parties ». Ainsi on apprend non pas à jouer des rôles, mais « à être acteur ».
Toue enseignement porte la marque d’un projet théâtral. Il n’intéresse que dans la mesure où celui-ci s’assume et déborde le rêve consensuel d’une neutralité pédagogique. Avec Vitez, intuition étonnante, l’enseignement sert d’éclaireur à la mise en scène qui parviendra à s’imposer dès qu’à la suite d’une intuition, d’élève justement, il se décidera à supprimer les cloisons et à adopter le principe des vases communicants. C’est le pédagogue gui a trouvé ce que le metteur en scène a développé. En ce sens il fut un pédagogue metteur en scène, plus qu’un metteur en scène-pédagogue.
L’école ou l’exercice épanoui. Et quand il définissait Chaillot comme un « grand théâtre d’exercice » ne procédait-il pas à la fusion de l’école et du théâtre ? Chez lui , la pédagogie pouvait contaminer le travail sur le plateau au risque parfois d’un oubli des différences.
« Manifeste
nécessité : un grand théâtre d’exercice
danger : que l’exercice se substitue à l’oeuvre »Vitez ne fonde pas une doctrine immuable, mais, en mutation permanence, il varie ses points de vue. Une fois il défend l’école autonome, une autre fois, l’école rattachée à un théâtre. Chaque option dépend de son statut à l’heure de la formulation. Et c’est en tant que directeur de Chaillot qu’il milite pour l’association entre une grande maison et son école qui « est la suite ou le laboratoire, la critique ou la préface de l’oeuvre accomplie par le Théâtre ».
L’enseignement participe d’une manière d’être. En arrivant au Conservatoire, avoue-t-il, « je n’ai rien fait d’autre qu’être moi-même », En ce sens, Vitez, plus que quiconque se montrait imprégné d’un optimisme qui a traversé toutes ses pratiques : il croyait dans la force porteuse du désir. Son enseignement, il ne l’a jamais pensé comme une avancée soigneusement programmée, mais comme un défi peu soucieux de progression et d’évolution. Ainsi entendait-il former, tout en préservant l’esprit de jeunesse, valeur, pour lui, cardinale. La mise à l’épreuve sans précaution, l’insouciance à l’égard de toute pédagogie progressive — voilà le principe d’un enseignement rebelle à l’égard de la maturation. La provocation de Vitez vient de là, de la volonté de mener un travail à partir de la conviction « que l’acteur peut tout ». Dans la salle de cours, comme dans la salle des répétitions. Lui, qui aimait les débuts précoces, faute d’avoir pu en bénéficier, n’a pas cessé de théoriser, sur le plan de l’enseignement, la nécessité d’une telle précipitation.
Dans une lettre à Jacques Rosner, directeur du Conservatoire, il livre son aveu central : « cette technique de base du jeu implique une idéologie de l’enseignement que nous n’avons pas », La fragmentation et« le rapport dérivé avec la fable » trouvent ainsi leur motivation. Palliatif à la synthèse manquante que Vitez, avec une confiance démesurée dans ses ressources, envisageait d’accomplir : « je ne puis avoir d’ambition moindre ».
Néanmoins, il n’a jamais été ni le penseur, ni l’artisan de cette synthèse.
Lui, le meyerholdien né, écrit une phrase qui le rattache à Jouvet dont il fut le véritable successeur, par-delà les nombreuses filiations qu’il s’est constituées : « tout le travail de l’acteur est dans cette recherche de l’état. D’ailleurs si on est dans l’état, ça va tout seul. Et l’état se trouve ou ne se trouve pas, l’état c’est quelque chose comme la grâce ». L’état serait-il « le sentiment » dont parle Jouvet ? Sans doute. Écho explicite d’ELVIRE JOUVET 40, projet dont Vitez, dans un premier temps, n’a pas saisi la portée. Serait-ce en raison d’un trop fort effet de reconnaissance ?
L’enseignement, pour Vitez, ne peut être que de groupe, et c’est dans ce contexte seulement, qu’il s’accomplit, dans ce frémissement communautaire contraire à l’isolement de la « formation individuelle ». Le pédagogue qu’il est se pose sur le bord du « cercle d’attention » qu’il dessine sur la page blanche de la salle où le groupe se réunit. Le poète confronté à l’isolement trouvait une compensation dans l’entité du groupe qui l’attendait. La classe, telle qu’il l’avait constituée, résultat d’un choix réciproque, émettait toujours des appels auxquelles le pédagogue, séducteur et séduit, ne restait pas étranger. L’enseignement servait aussi de cure contre la solitude.
Tout se retrouve : l’enseignement enregistre l’ordre essentiel qui régit la personnalité d’un artiste. Vitez qui s’est montré attiré par les grandes formes de la culture théâtrale, l’alexandrin en particulier, autant que par les marionnettes dans leur version « primitive », a exercé par ailleurs, avec une égale passion, l’enseignement auprès des élèves du Conservatoire et des « amateurs » d’Ivry. Il leur proposait peut-être des exercices similaires, mais sans jamais les soumettre au même regard critique. Celui-ci devait échapper à toute appréciation normative unique. Vitez souhaitait le relativiser car, comme dans ses pratiques théâtrales, la contradiction devait corriger chaque terme en fonction de l’autre. Vitez a appliqué — à la pédagogie les leçons de la dialectique.
Avec Vitez je ne me suis disputé qu’une seule fois : il affirmait « je suis pour une école de théâtre, et non point de l’acteur ou du metteur en scène. Je suis contre la division en facultés ». Tout projet d’enseignement « polytechnique » le révulsait. Il n’a jamais cru qu’à « une école de l’acteur ». Comment interpréter pareille obstination ? Méfiance à l’égard de la mise en scène comme activité dérivée ou confiance absolue accordée à ce centre irradiant du théâtre qu’est le comédien ? En dehors de lui, point de salut. Sauvé ou perdu, le théâtre ne le sera que par lui.
L’école tire sa légitimité plus de ce qu’elle instaure comme liberté que de ce qu’elle dispense comme savoirfaire. Vitez reconnaît y avoir « trouvé tout ce qu’il aurait fait », mais à son tour, lui aussi, il a appris aux élèves comment ne pas « perdre le fantasme » premier. Ensemble ils se livraient à une expérimentation indifférente à toute contrainte. Là-bas seulement Vitez envisageait de « mettre en cause le théâtre tout entier ». Laboratoire de l’alchimiste que le public effraie.
« L’école, le plus beau théâtre du monde » — comment formuler cri de désespoir plus pudique ?Dans cette confession, Vitez identifie l’école à l’espace de liberté où peut se développer la pratique qui lui est la plus chère, celle de l’exercice et de la variation. En poète il se réclame du geste rapide, nerveux et fluide, contraire au travail par additions successives pratiquées par les romanciers. L’école c’est l’espace de la posture poétique. Ailleurs, il faut oeuvrer aux enchaînements, à la construction des architectures, mais aussi se soumettre ou, au moins admettre, le jugement public. Vitez, en amoureux des avant-gardes, aurait aimé s’en affranchir, mais en même temps, en artiste citoyen, il n’osait pas affirmer publiquement pareille attitude. Il sera à jamais un provocateur de cabinet. Et c’est ce à quoi il assimile la salle de classe… espace sans contraintes. Là, seulement, il satisfaisait son appétit de liberté. Le salle restera toujours en-deça et c’est pourquoi l’école sera pour lui « le plus beau théâtre du monde ».
L’enseignement se présente comme un mode de partage de la durée : il renvoie à un temps originaire. « Ceux qui ont suivi mes cours, j’ai le sentiment d’avoir été enfant avec eux, c’est aussi le sentiment qu’on éprouve avec ses propres enfants : nous étions petits ensemble ».
Enseigner, pour Vitez, signifie surtout se trouver à l’origine. L’école, lieu de l’origine. Ne pas hériter, mais enfanter. Se placer au commencement, là où les vocations se formulent, où les identités se dessinent, où le nouveau surgit. Cela renvoie, une fois encore, à la mythologie de la jeunesse dont son enseignement reste indissociable. Il se pense en père des acteurs à venir, en foyer des générations futures, en légataire d’un « théâtre d’exercice » expérimenté dans le laboratoire de l’école. Vitez a assimilé l’enseignement à la meilleure manière d’être le géniteur de son propre groupe, de sa famille, de son monde. Hostile à l’héritage ou à l’adoption, il souhaitait oeuvrer surtout à l’accouchement de ses acteurs.
Arrivé à la Comédie-Française, c’est l’école qui lui a manqué. C’est pourquoi il rêvait de Bièvres et de re-commencement.
Ce texte est repris avec l’aimable autorisation de la revue Europe.