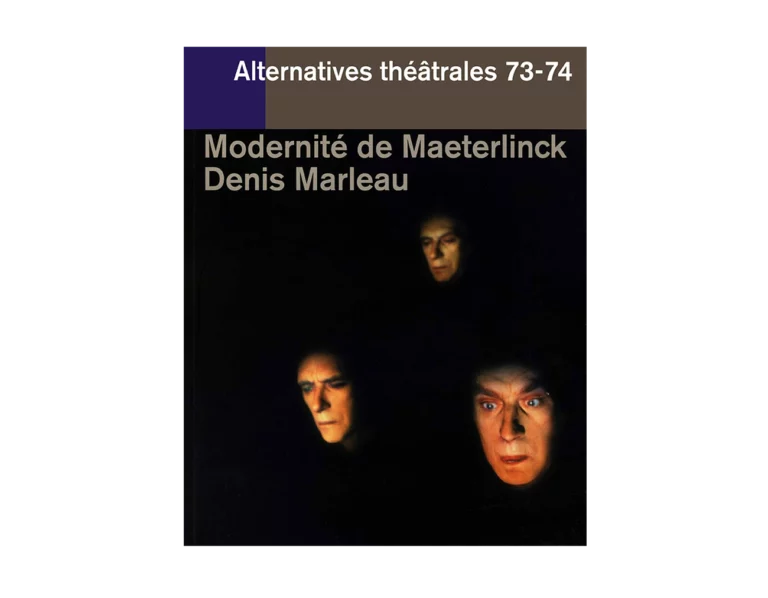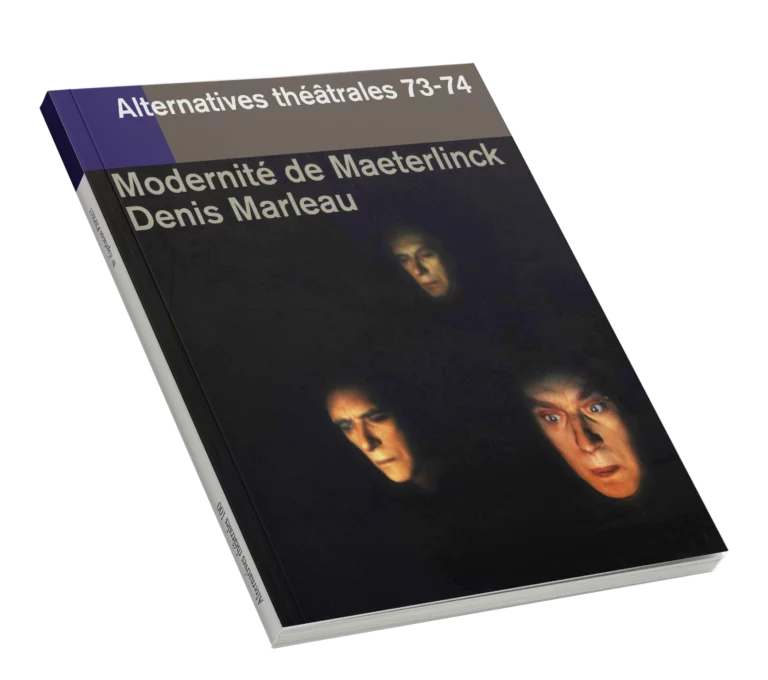LE PREMIER CONTACT de Denis Marleau avec Paris est resté modeste : MERZ OPÉRA, d’après Kurt Schwitters, fragments entremêlés dans la logique délirante du mouvement dada, quelques soirs en 1988 au Centre Georges-Pompidou. Une dizaine d’années, donc, après un séjour européen – de 1976 à 1979 – pendant lequel à travers Giorgio Strehler et Tadeusz Kantor entre autres, il s’était pris de passion pour le théâtre. Entre temps, il était revenu chez lui, à Montréal. En 1982, il y fondait sa compagnie, le Théâtre Ubu, qui, fidèle aux dadaïstes en particulier, aux avant-gardes des années 20/30 en général se produisait de préférence dans les musées, en tous lieux où ses1 collages littéraires, ses recherches plastiques ont trouvé leur place. Au départ, Denis Marleau est un metteur en scène formaliste, on peut le définir ainsi.
Il l’a splendidement démontré avec LES TROIS DERNIERS JOURS DE FERNANDO PESSOA, d’après Antonio Tabucchi – au Théâtre de Dijon-Bourgogne en 1997 – véritable tour de magie par lequel se confondaient le virtuel et le charnel, comme s’étaient confondues les innombrables identités du poète dont le nom signifie « personne ». Il y avait là bien plus qu’un jeu d’images et de corps. Il y avait le mystère d’un homme qui se cache de lui-même. Bien sûr, c’était une vraie personne que l’on voyait étendue tout au long de la représentation. Un comédien représentant Pessoa mourant, rêvant, attirant les créatures passées par le filtre de son imagination. Vraiment une vraie personne ? Que dire alors du visage-vidéo collé au sien plus étroitement qu’un masque ? Des voix artificielles paraissant décalées des lèvres ? Qui était ce nain aux traits invisibles sous son chapeau, traversant latéralement la scène à plusieurs reprises ? Une illusion technologique, mais si prenante, que jusqu’à la fin on se posait la question.
Alors on pouvait penser à Robert Lepage, cet autre Québécois, architecte d’un monde sens dessus dessous aux dimensions mouvantes, où les inventions virtuelles tendent à engloutir les humains. Domaine que les Américains manipulent sans complexe, avec plusieurs longueurs d’avance sur les Européens.
Chez Denis Marleau, en tout cas, rien de mouvant, rien d’incertain. Son PESSOA mettait en action un mécanisme diabolique et enchanteur, d’une précision minutieuse, dans lequel les (vrais) acteurs devaient s’insérer, au millimètre et à la seconde près, sous peine de désagréger le spectacle. Le même principe s’est prolongé dans URFAUST (créé à Weimar en 1998, présenté ensuite à Berlin et à Sceaux, aux Gémeaux). Denis Marleau y renouait également avec Pessoa : il avait mêlé des fragments d’un de ses poèmes à des extraits du texte de Goethe. Là encore, on se retrouvait face à des fantômes étonnamment présents, mais sans cesse prêts de se laisser aspirer par une nuit enveloppante. Face au théâtre dans sa fragilité.
Denis Marleau : sensible, et formaliste. Ce n’est pourtant pas ainsi qu’il s’est d’abord imposé dans les souvenirs personnels. C’était ROBERTO ZUCCO de Bernard-Marie Koltès, en 1993 au Festival des Amériques. Spectacle sans apport technologique, dans la rude beauté d’un décor métallique, structure tout à la fois abstraite et imposante, faite d’échelles pour s’évader, qui sont en même temps les grilles qui emprisonnent, qui barrent le chemin. La pièce est sans doute l’une des plus piégées d’un auteur infiniment énigmatique. La dernière qu’il ait écrite, et parce qu’il s’est inspiré d’un héros de fait divers pour se regarder mourir, elle a parfois été montée en s’appuyant sur le phénomène de société. C’était le parti pris de Peter Stein, qui en avait assuré la création mondiale à la Schaubühne de Berlin avec une vedette de la scène rock. Le plus souvent pourtant, l’onirisme l’emporte, le côté romantisme funèbre à propos d’un homme qui tue comme il se dépouillerait de tout ce qui a fait sa vie.