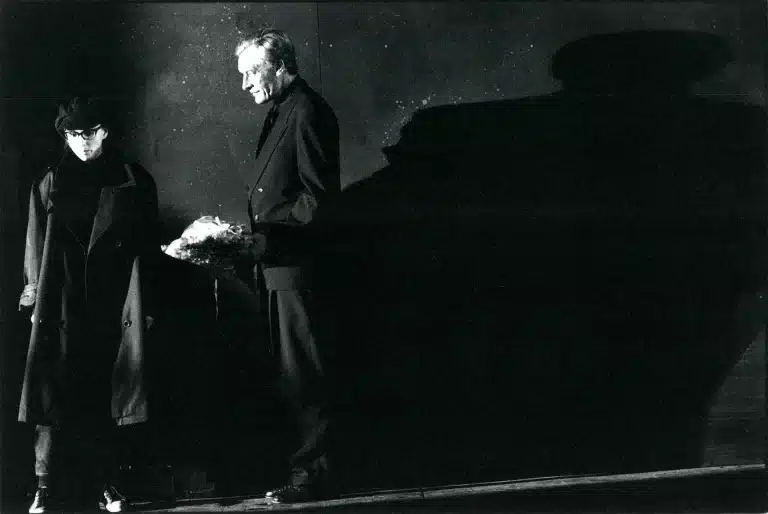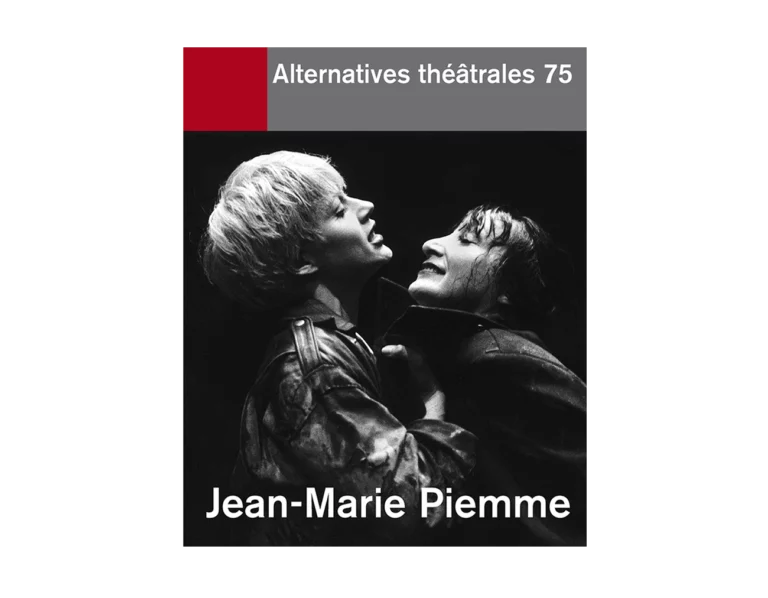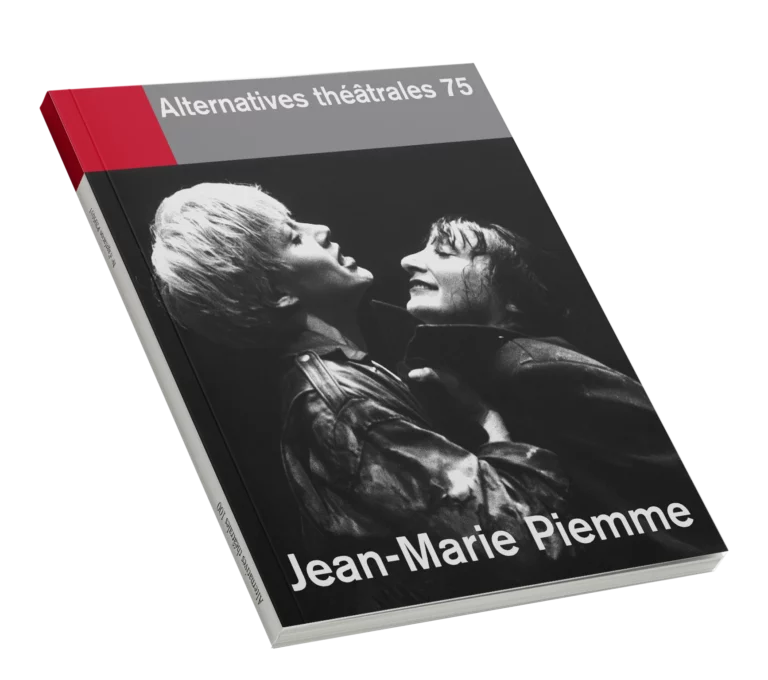DANS LE théâtre de Jean-Marie Piemme, la figure féminine occupe une place particulière. Elle reçoit, dans la lecture qu’organise le texte, un statut singulier, de prime abord quelque peu paradoxal. Elle n’est bien sûr pas une héroïne puisque l’auteur s’inscrit dans la perspective contemporaine qui a dissous les catégories classiques du théâtre. Néanmoins, de Neige en décembre au triptyque Eva, Gloria, Léa, les femmes des pièces de Jean-Marie Piemme gardent une aura dont le théâtre de l’extrême contemporain a souvent vidé les personnages. Elles abritent quelque chose de ce ciel perdu, évacué des scènes désormais sans repères stables. Elles recèlent une part de solidité et même, une part d’utopie. Non que Jean-Marie Piemme décline des passions devenues obsolètes pour des personnages dignes de la Passionaria ou de Pélagie Vlassova, figure centrale de La Mère de Brecht, mais les femmes qu’il montre semblent toujours savoir un peu plus, voir au-delà. Et le dépassement qu’elles symbolisent engage plusieurs représentations possibles, plusieurs façons de se réaliser.
Vont-elles succomber à la promesse d’un ailleurs et viser la limite d’un quelconque ciel ? Ou simplement, signalent-elles la place d’une perception relative à l’autre sexe, d’une alternative au point de vue masculin ? Peut-être encore incarnent-elles une forme de transgression pure et prennent-elles ainsi valeur de métaphore ? Loin de choisir, les pièces de Piemme entrelacent ces trois attitudes et confèrent ainsi à la figure féminine une importance de premier ordre dans la portée de ce théâtre. Ce sont souvent en effet, des figures féminines qui soutiennent et relancent la mécanique théâtrale de cette écriture. Presque d’emblée, elles se situent au-delà des hommes, ces nombreux êtres falots et dérisoires qui habitent le devant de la scène dans un habit de lumière. Or, ce n’est pas une telle concurrence qui anime ces personnages de femmes. Souvent secondes, il est vrai, elles ne sont pourtant pas secondaires. Outre qu’une telle hiérarchisation a perdu sa pertinence dans le théâtre contemporain, elle ne correspond pas davantage à la manière dont la fiction théâtrale de Piemme compose une représentation de l’univers social et de sa division entre genres masculin et féminin. Au fil des textes, l’auteur élaborerait plutôt des figures féminines extrêmes, en passe de se déborder, de « s’excéder ». Nous en suivrons ici les avatars à travers trois des premières pièces, Neige EN DÉCEMBRE, Commerce gourmand et Scandaleuses qui saisissent trois moments de ce qui, chez Piemme, persiste comme une différence radicalement autre.1
« J’étais tout jeune encore et son regard m’apaisait2. »
Tout commencerait avec la Mère, l’être matriciel, refuge fantasmatique qui aimante le personnage de Max dans NEIGE EN décembre. Figure archaïque, elle défie le monde social en s’offrant comme lieu d’oubli et de repos. Figure transcendante, elle abolit, par sa présence immémoriale — Elle fut ma mère, elle le restera, dit Max — le rapport au temps et à la vitesse. Reste encore auprès de moi que je regarde en toi-même comme seule le peut la fierté que je te porte3, dit-elle à Max. Elle est l’être mythique du fusionnel, l’en deçà et l’au-delà de l’histoire sociale.
Tandis que la Femme du Professeur occupe une position en tous points semblable mais en regard d’un autre homme, la femme de Max, Julia, entre, dans un premier temps, en concurrence avec la Mère pour accéder au même rôle. Place assignée par le besoin de l’homme, ce « repos du guerrier » met en lumière une part d’abnégation et de renoncement à soi-même : chacune de ces femmes n’existe qu’à travers un homme, par rapport à lui. Elles contribuent aussi à figer la figure du masculin puisque, pour elles, respectivement Max et le Professeur savent ce qu’elles ignorent, ce qui, donc, les dépasse, et agissent bien. Les quelques tentatives de Max pour secouer ce carcan ne suffiront pas à en relâcher l’étreinte. Mais lorsque celui-ci déchoit de son rôle, devient traître et perd ainsi son aura de virilité, ce déplacement entraîne Julia vers la fonction laissée vide. En tentant de sauver le Professeur, victime de la trahison de Max, elle endosse le combat renié par ce dernier. En ce sens, la scène où se raconte la traversée dans le bois enneigé prend une valeur métaphorique. Julia charge sur son dos le corps mort du Professeur pour le mener jusqu’à la frontière. Changeant de rôle, elle cristallise le transfert des pratiques et des points de vue culturellement construits du côté du masculin. Elle passe ainsi à l’extérieur (son geste est social et non plus privé), dans une visibilité publique et officielle (elle se fera arrêter) et acquiert la force physique et la volonté pour accomplir un acte dangereux, courageux, motivé par l’honneur4.
Neige en décembre met ainsi en scène des figures féminines que l’on pourrait croire antagonistes. Or, à bien lire, si la Mère affiche sa sensualité et les attributs physiques de sa féminité5 mais pour les neutraliser dans un gestus archaïque, il en va tout autrement du personnage de Julia. En elle, rien ne se signale de l’ordre du féminin. D’un bout à l’autre, ce personnage n’est constitué que d’emprunts : d’abord à la fonction ancestrale de refuge-repos, ensuite au rôle dominant et actif que l’usage commun attribue encore largement à l’homme. En somme, comme figure du féminin, ce personnage s’oblitère pour ne laisser à l’œuvre dans la pièce que la variante matriarcale la plus mythique. En laissant à l’endroit du féminin une place vide, la première pièce de Piemme circonscrit l’espace où revenir. Si elle ne relève pas exactement du mystère, de ce continent noir que la féminité suggéra dans l’imaginaire masculin, la question qui est ainsi ouverte a trait, mais souterrainement, à l’identité. Mais au cliché « qu’est-ce qu’une femme ? », l’auteur substitue une interrogation plus subtile qui touche au processus identitaire, à la construction d’une identité au féminin.
« Quand une femme se tait devant un verre, il ne faudrait pas trop vite penser d’elle… »6
Commerce gourmand présente deux femmes en crise, et surtout en creux, deux négatifs d’images qui cherchent à s’inverser. L’une, Anna S., ombre d’un mari enrichi et mort, entre en scène sous l’effet de l’alcool. Elle se met en lumière, prend la parole et prend corps au sens où elle reprend possession de son corps. J’ai parlé si fort, si haut que la famille en a rougi jusqu’aux cheveux. J’ai pris dans mon sac un petit cigare, je l’ai allumé devant tous. Quel scandale ! Je suce longuement le mégot, et à la façon dont je fais couler la fumée entre mes lèvres, ils comprennent que le plaisir ne m’a jamais prise en grippe.7
Pourtant, c’est essentiellement sur et par l’argent qu’elle construit son personnage de femme : tout en apparences, en jouissances de ce qui s’achète et de ce qui se vend. Liberté et identité limitées, Anna S., à l’instar d’une Bovary contemporaine, échoue à combler le clivage de son existence au féminin.
La fin de Neige en décembre concentrait l’attention sur le personnage de Julia que l’on voyait se glisser dans un rôle préexistant. Commerce gourmand dessine pour le personnage de Betsy une autre voie, moins parcourue de modèles. Dans un milieu social qui se délite, Betsy s’arrime à un projet de création artistique. Mais elle se heurte au marché imposé par Norden à qui elle demande de financer son film. Ainsi, à l’aube d’une naissance, au moment d’élaborer une autre représentation de soi, moins excentrée, ce personnage féminin est confronté à l’une des multiples formes par lesquelles s’exerce une domination masculine : Je te propose un marché dit le chasseur en posant calmement son fusil entre les deux yeux de la bête.8 Betsy accepte l’échange mais son geste n’entérine pas la domination, car elle retourne une situation de soumission en ruse et en stratégie. Là où Norden se maintient dans le rapport de forces et obéit à la pulsion du désir, Betsy déploie une pensée qui subordonne les moyens à la fin.
Les comportements féminin et masculin à la source de ces deux personnages laissent persister de manière sous-jacente les valeurs traditionnellement attribuées à chaque sexe : force, franchise, violence, dureté comme signes démonstratifs et reconnaissables de la virilité ; corps-objet (d’échange), résignation, ruse inscrits-écrits dans le sujet féminin9. Si par son travail artistique, Betsy s’émancipe partiellement de l’emprise masculine, l’ambiguïté de ses sentiments envers Norden la déchire entre deux hommes. Elle finit par partir avec Franck pour ne pas « voler » Norden à Anna. Par son choix, elle se réapproprie au féminin l’honneur qui caractérise le fonctionnement social dans l’ordre masculin. Pourtant, le personnage n’est pas construit comme une figure du féminin autonome. Ayant suivi Franck à New-York, elle meurt en mettant au monde un enfant de Norden. Cette acmé tragique transforme le personnage en figure expiatoire et restaure le mythe de la pureté au sein de la représentation du féminin. Avec COMMERCE GOURMAND, la figure féminine gagne, dans le théâtre de Piemme, une place centrale, mais elle reste stigmatisée par son histoire mythologique.
« … ils te demandent quelle femme j’étais, quelle femme j’étais vraiment ! Tu dirais quoi ? »10