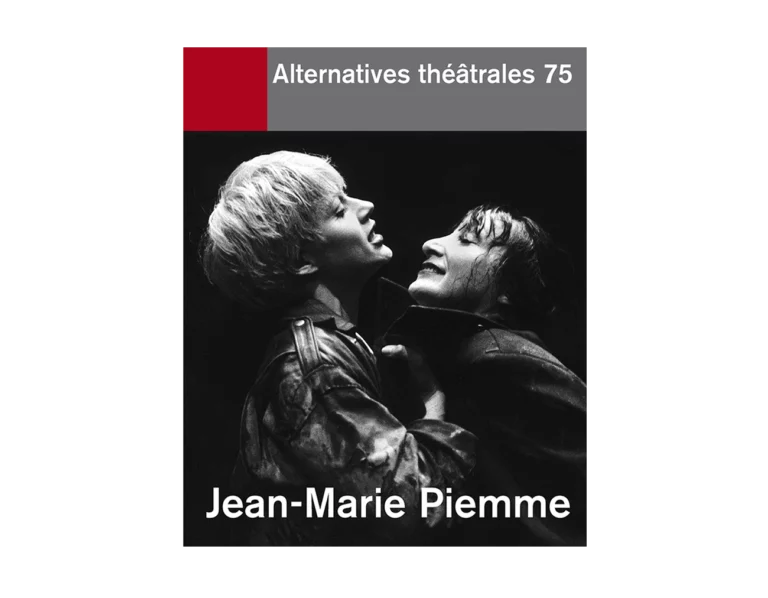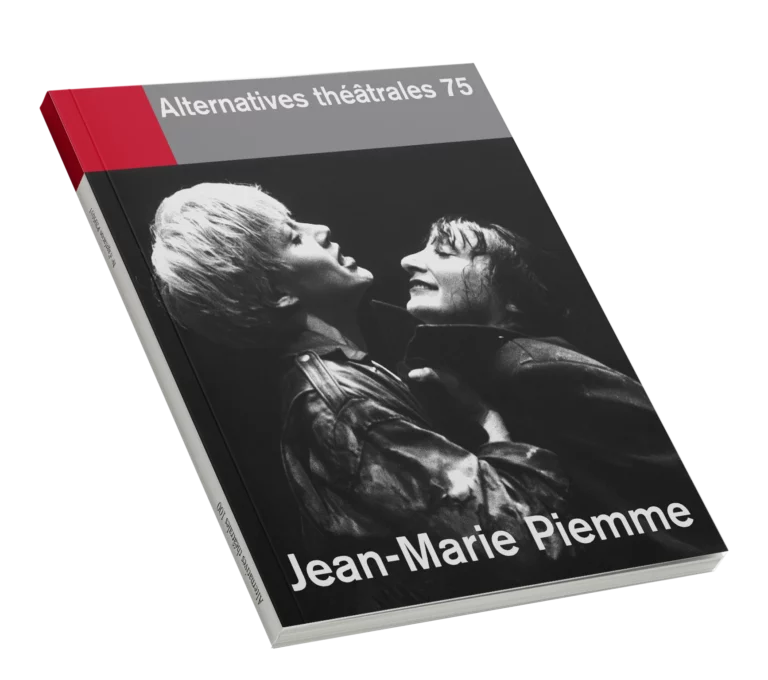27 juillet 2002
Du Théâtre de la Place au Festival d’Avignon
EN 1986, l’écriture s’impose à moi, une urgence tardive. J’ai presque 42 ans, il faut s’y mettre. Depuis, j’écris comme si j’avais engagé une course contre le temps. Fin 87, François Beukelaers crée Neige en décembre, ma première pièce, au Théâtre de la Place à Liège (direction Jacques Deck). Le moment est décisif. L’existence du texte sur scène est capitale, elle objective le désir, l’engagement dans l’écriture, elle vous met au centre de vous-même dans l’instant où elle vous livre aux autres. Être au pied du mur est une belle expression. À ce moment-là, j’en ai mesuré toute la finesse.
Plus tard, Philippe Sireuil annonce qu’il présentera cinq de mes pièces en cinq ans au Théâtre Varia. Ce sera chose faite en sept ans. Au moment de l’annonce, trois des pièces ne sont même pas écrites : c’est le plus généreux de l’affaire. Sireuil me lance une balle, je la reprends, je la renvoie. Mais sans l’emballement de Beukelaers, la bonne réception critique du spectacle, puis la formidable force de frappe qu’ont été le Théâtre Varia et Sireuil, qu’est-ce qui aurait été possible ? Je ne sais pas. En tout cas, il ne pourra pas être dit que j’ai écrit dans le désert.
L’autre soir en sortant de Les Forts, LES FAIBLES, à la Chartreuse de Villeneuve-lez-Avignon, je me disais que l’urgence d’écrire était intacte. Les mots des acteurs en faisaient résonner d’autres, pas encore écrits, ils me propulsaient vers ce qui reste à faire, oui, c’est bien ainsi que ça doit être, on écrit pour écrire davantage, écrire mieux, plus aigu, plus ample, plus proche de ce qui travaille en vous. Avignon correspond à un moment de visibilité sociale accrue, un moment où le mot « auteur » vous revient de l’extérieur, effet boomerang. Auteur, dit-on. Pas moi. Moi, je me pense comme celui qui écrit et qui est écrit, je suis charrié entre les deux états, je nage avec et contre les courants, c’est un trajet toujours non accompli, inachevable, aux frontières troubles, aux enjeux ambigus, un plaisir, un piège, le contraire en somme de ce qu’on peut entendre dans l’expression « alors, c’est vous l’auteur », vous l’auteur celui qui sait ce qu’il veut, vous l’auteur qui n’aurait qu’à pousser sur un bouton pour que ça sorte, vous l’auteur avec ce que ça suppose de maîtrise et d’emprise sur les choses. Je me souviens d’une rencontre publique de Jean Vilar avec un groupe de stagiaires dont j’étais, (in illo tempore, si loin, si loin ce temps-là!!), il parlait calmement, gravement, avec une proximité sans familiarité, j’avais l’impression de voir un équilibriste qui vous apprend à marcher sur un fil.
30 juillet 2002
Belgique entre rire et rage
Je n’arrive pas à prendre la Belgique comme un tout. Même aujourd’hui, elle ne constitue jamais pour moi une totalité. Ce sont des pièces assemblées, soudées pour certains de ses habitants par une histoire qui ne me touche que de très loin (la colonisation par exemple). Marx disait que l’histoire se répète toujours deux fois et que la seconde est la caricature de la première. Il est possible qu’une Belgique noble et belle, comme le dit l’hymne national, ait existé « avant ». Aujourd’hui, nous sommes en pleine deuxième phase. Caricature de royauté, caricature d’unité, caricature d’État, caricature de souveraineté. La politique n’y est plus que la gestion raisonnable de ce que les autres laissent à gérer. Le grand vent de la mondialisation rend les petits pays d’Europe plus bouffons encore que les grands. Mais les grands doivent être attentifs : à l’aune du monde, le non-devenir de l’État-Belgique est peut-être leur futur. On en voit déjà des signes. Européens, encore un effort pour être Belges. Cela dit, la situation a des vertus : elle pousse à l’humour, elle aiguise les pointes de l’ironie. Elle apprend à manier les registres conjugués de la farce et du tragique, deux belles catégories esthétiques du théâtre. Pour ceux que les contradictions enchantent, — c’est mon cas —, voilà donc un excellent lieu d’énonciation, un point de vue au sens littéral du terme. Je n’écris pas nécessairement sur la Belgique, mais j’écris toujours « de » la Belgique, à partir d’elle, accroché à son mouvement de comique effondrement.
2 août 2002
Personnages de pères, personnages de mères : l’impossible famille
La famille : peu d’impulsion d’écriture. Surtout quand elle est trop immédiatement donnée, trop immédiatement fixée, fermée, enfermante, coupée du monde. Une tonne de déjà vu me tombe alors sur le dos, je me sens écrasé, pris dans une voie qui ne conduit pas à l’invention. La famille réduite à elle-même, liée aux seules énergies du rapport intersubjectif tire volontiers sur le psychologique ou sur le métaphysique, des catégories qui ne m’intéressent pas.
Dans mes pièces, il y a quelques pères sans mères, quelques mères sans pères, la paire est rare, les veufs et les veuves fréquents, j’ai beaucoup de difficulté à concevoir le père « et » la mère, il y en a toujours un en trop, il faut que j’en liquide un, le nous familial dans ses joies ou dans ses haines ne m’aide pas, je ne convoite pas les secrets de naissance ou d’héritage, les écarts, les nébuleuses affectives, les déchirements de l’intime, les meurtres symboliques. J’aime les mères indignes, possessives, jouissives, provocatrices, les pères dominateurs, injustes, justiciables des coups qu’on leur porte. Les unes et les autres amènent avec eux une réactivité libératoire, utile à l’écriture, il y a du monstre dans chaque parent, une bête tapie dans l’amour, elle dort d’un œil, tout repos est dangereux : excellent matériau pour le théâtre ! Je suppose que chacun dans sa vie se découvre un jour orphelin, même si l’amour parental n’a pas manqué. Un jour dans le ravissement, un autre jour dans la terreur. Ce n’est pas le « famille je vous hais », ou la guerre des sexes qui m’intéresse (pour se battre il faut au moins être deux ou trois ou un groupe) mais les moments de dislocation, les moments où ça n’arrive plus à faire deux ou trois, ou un groupe, la désarticulation, le démembrement. Nous sommes dans un moment du monde où, pour nous, occidentaux, ça se dénoue. L’équation de l’ancienne citoyenneté se dénoue (qu’on pense à la transformation des sphères publiques et privées et de leurs rapports sous la pression du médiatique), les fils du passé se dénouent, la vieille civilisation se dénoue.
À bien des égards, 1953 semble être l’exception à tout cela, le père, la mère, l’enfant, le cercle familial sont là, rien ne se défait et s’il y a bien quelqu’un qui n’est pas orphelin, c’est le jeune Rodolphe. Après la guerre le monde s’est noué, s’est renoué, mais dans une nouvelle illusion, c’est cela que j’ai voulu raconter. Le surgissement de la petite bourgeoise dans l’illusion, regarder le nœud qui se forme à partir d’un point de dénouement déjà en cours. Dans le texte, chacun néanmoins prend la parole à son tour, il y a fragmentation des discours, c’est un théâtre-récit, un théâtre littéral, où les figures familiales sont explicitement parlées par le narrateur/enfant. 1953 n’est pas une pièce sur la famille, ou sur le père ou la mère, mais sur un moment de proximité existentielle datée, quelque chose qui nous est arrivé en ces temps-là, racontée par cet homme-là, je dirais une « pièce d’apprentissage » comme on dit « roman d’apprentissage ».
5 août 2002
Si un auteur est un nain sur les épaules d’un géant, comment apprendre et de qui ?
Nous sommes habités par les textes des autres : c’est une bonne chose. L’écriture est une dette infinie que chaque mot tracé abolit et relance. J’écris sur la page de ceux qui m’ont précédé. Avec eux, contre eux, à côté d’eux, en eux. Toute écriture est réécriture. Des auteurs qui m’importent l’ont affirmé très haut : Millier, Brecht, Büchner, par exemple. Trois auteurs, trois pôles du continent épique. Difficile de rester indifférent à toute l’intelligence qu’il y a là-dedans ; à l’aigu du regard qui découpe d’un même mouvement l’homme et la société ; au souci d’explorer finement les frontières et les formes du théâtre ; au plaisir tiré d’un usage théâtral de la langue ; à la jouissance des possibilités intellectuelles et sensibles de la scène.
Le plus difficile à entendre aujourd’hui est Brecht. Son temps n’est plus le nôtre. Ce qui ne veut pas dire que ses leçons soient inaudibles ou sans pertinence. Mais elles appellent des réajustements de fond. Les deux autres, malgré le siècle et demi qui les sépare, ont un point commun, proche de nous : ils parlent après une révolution qui a mal tourné. On peut lire La Mort de Danton et La Mission dans un même mouvement, dans la même logique d’après coup. L’avantage des réveils amers est de remettre en débat la question du tragique, que la foi optimiste du combattant a toujours tendance à refouler. Büchner et Müller contre Brecht. Contre la carte du Parti que La Mère tient pieusement entre ses mains, le « je ne vais pas me tourner les pouces jusqu’à ce qu’une situation (révolutionnaire) vienne à se présenter » de Müller. Ou « la Révolution est comme Saturne, elle dévore ses propres enfants » de Büchner. Nécessité de la révolution et certitude qu’elle tournera mal : il faut vivre avec ça. Contradiction entre la longue durée du temps historique et la brièveté de la vie humaine ; il faut vivre avec ça. Volonté de libérer l’Humanité avec ce que cela suppose de sacrifices, mais « toujours c’est un seul qui meurt » : il faut vivre avec ça. Le tragique entendu comme choix impossible entre des niveaux contradictoires du réel est au cœur de l’héritage müllérien. Là-dedans, aucune célébration d’un homme éternel, toujours égal à lui-même, pas de défaitisme, juste une façon de rappeler que les lendemains ne chantent jamais de la façon attendue. Commencer à écrire en 86 comme je l’ai fait, c’est commencer avec ce réajustement dans le dos, avec ce vent tragique qui ne cesse de souffler au fond de la phrase, même si parfois on ne l’entend que de très loin dans les situations quotidiennes et sous le registre du rire. « Ni plus ni moins moral que l’Histoire » écrit Büchner dans une lettre à propos du rapport de son écriture au monde. Ce qui ne signifie pas indifférence ou neutralité. Le choix du matériau, les orientations formelles, le type de développement donné au sujet, les modes de narration traduisent toujours un point de vue. J’écris un théâtre de l’immersion (sciemment au moins depuis Le Badge). Pour moi, il n’y a pas d’écriture « au-dessus », ni « devant » ni « de loin ». Il n’y a d’écriture que « dedans ». « Immergé ». Avec l’incomplétude que ce point de vue suppose, sa vision parcellaire, son fractionnement : Fabrice à Waterloo dans La Chartreuse de Parme. Dans la bataille. Ne voyant pas tout de la bataille, avec un savoir courbe, et la certitude que notre capacité d’illusion est grande, dangereuse, mais qu’elle est aussi une part de nous-mêmes. Nous sommes vivants par l’effet de l’erreur et de la vérité. Fabrice voudrait voir l’empereur et, lorsqu’il passe, ne le reconnaît pas ou le reconnaît trop tard : image de ce que nous sommes, jamais au bon endroit, jamais au bon moment pour tout dire, pour tout saisir, pour occuper la place du surplomb, pour tout restituer dans un geste de maîtrise.
11 août 2002
Et le verbe s’est fait chair de femme
Souvent, lorsque je commence une pièce, alors même que je ne sais pas encore de quoi elle va parler exactement, ce sont des morceaux de figures féminines qui montent à la conscience.
Il y a un plaisir particulier à l’écriture des figures féminines, elle met en activité un travail de l’imaginaire moins attendu, une zone où les parts d’ombre sont plus fortes, il est intéressant de se perdre à des endroits où l’on ne se perd pas d’habitude, on se rejoint à travers une différence radicalement autre, c’est un mélange d’observation et de fantasmes, de traits objectifs et de projection. En tous cas, ça vous revient dans la découverte et la surprise plus qu’avec les rôles d’hommes. Les rôles féminins sont bons vecteurs, ils matérialisent les impulsions, conduisent rapidement au cœur des choses, ils donnent corps à la prise de distance, à la réserve, à l’écart, à la cassure, à la résistance, à la dissidence, au désordre, si l’on veut bien prendre ce terme général dans son acception la plus large. Est désordre ce qui est dénoué, défait, délié. Pour autant, les figures féminines ne sont pas dans le nihilisme ou la destruction, elles veulent plutôt faire couple, groupe, communauté, mais à la faveur d’un autre mouvement, d’une autre vague. Tout cela sans profession de foi. Sans revendications. Souvent dans des conduites où brûle un certain feu, voire un excès d’engagement en soi-même. A coup sûr, le désir d’intensité est de leur côté. Ça n’en fait pas des héroïnes, avec ce que cela suppose de situations glorieuses ou d’unité psychologique. Elles ne proclament pas, elles n’affichent pas, elles ne réclament pas, simplement elles impulsent au navire des coups de barre qui les sortent du sillage où elles s’étaient mises, où la vie les avait mises. Elles ne revendiquent donc pas une positivité qui ferait défaut aux hommes. Elles n’incarnent pas un quelconque angélisme, elles sont, comme les rôles masculins, traversées d’affects et de discours, de désirs et de stratégies, de conséquences et d’inconséquences : contradictoires comme eux. Mais plus qu’eux, elles font grincer la mécanique humaine.
16 août 2002
Le cheminement erratique de l’écriture
Le texte ne doit pas trop « ressentir ». Il doit dire. Il est en cela proche parent du comédien. Le comédien en effet ne doit pas trop ressentir, il doit dire. Trop émotionné par ce qu’il joue, il ne nous communique plus l’émotion, il nous constitue seulement en voyeur de son hypersensibilité. Rien ne passe de lui à nous sinon son désir de faire apprécier le formidable investissement du personnage auquel il se livre. Je sue, je pleure, je suffoque, regardez dans quels états je me mets, semble-t-il dire, c’est la preuve que je suis un bon acteur, non ? Là où il devrait remplir sa fonction de passeur entre la pièce et le spectateur, là où il avait le devoir d’organiser un dire qui suscite intelligence et sensibilité dans le public, il s’interpose indûment, provoquant l’attention sur le narcissisme de son jeu.
Le raisonnement vaut pour le texte. Là où sa rhétorique exhibe trop l’émotion, le pathos, la violence, la provocation, il emprisonne. Je n’entends plus ce qu’on dit, mais ce qu’on veut dire. Du coup, je ne ressens plus rien, je ne pense plus rien. Là où l’intensité, l’intention du texte, son feu émotif, son geste, attirent explicitement l’attention, quelque chose m’écarte. Plus l’émotion est affichée, nommée, tartinée (dans les situations, dans les mots, par exemple), moins j’ai envie d’y participer. On pourrait dire aussi, là où la monstration cherche à m’absorber, je dis non. J’ai besoin d’une certaine incomplétude pour respirer, pour sentir, pour réfléchir. Comme spectateur, je veux qu’on me montre, et pas qu’on m’aspire. Et quand j’écris, je veux montrer, pas aspirer. Le « Un », l’homogène ne m’intéressent pas. Une écriture qui n’inclut pas sa propre porte de sortie me lasse vite. Dans une pelote tragique, il faut qu’on puisse aussi tirer un fil risible. Et trop de comique mène à l’écœurement si quelque chose ne vous prend pas à la gorge. L’usage de l’hétérogène (dans les niveaux de langue, dans leurs articulations, dans le choix des mots, dans le travail formel que tout cela requiert, dans l’accolement de registres a priori peu compatibles) permet la mise à distance du « trop ressenti » de l’écriture. Mais immédiatement, il faut prendre garde à l’erreur inverse. L’hétérogène active la théâtralité, et une surchauffe de théâtralité dans la langue amène rapidement à ce risque : le théâtre de la scène disparaît dans le théâtre de la langue. Ou, selon le point de vue, se magnifie dans le théâtre de la langue ! (Pour certains, là est même l’essence du théâtre, sa vérité.) Mais par tempérament, par formation, je préfère l’acte théâtral lorsqu’il prend le chemin de la foire plutôt que celui de la messe.
Montrer donc, avec le frein de l’ironie ou de l’humour par exemple, montrer en incluant dans le texte la possibilité de la prise de distance, en choisissant les composants de l’assemblage et la structure de celui-ci, donc pas montrer dans le mensonge du non-point de vue, et que le spectateur complète l’ébauche : lorsqu’il voit du sexe, qu’il y mette de l’amour si ça lui chante, ou le contraire, qu’il accole des sentiments aux gestes, qu’il nomme passion le désir, ou qu’il fixe la mesure dans laquelle l’issue de tel combat est une victoire. Là commence son empire. Proust : « Chaque lecteur est, quand il lit, le propre lecteur de soi-même. » Il n’y a pas de sens final, de sens canonique que le spectateur devrait retrouver. Dans sa confection, l’écriture est la germination d’éléments intellectuels et sensibles perçus dans le réel ; dans sa réception, elle donne lieu à une germination plurielle faite du voyage intime de chaque spectateur à partir de ce que l’écriture et la représentation lui donnent. Le plaisir est là, dans le mouvement infini de l’appropriation.
20 août 2002
Ouvrir un journal, rêver à la voix d’un acteur, établir un plan…
Comment s’écrit une œuvre ?