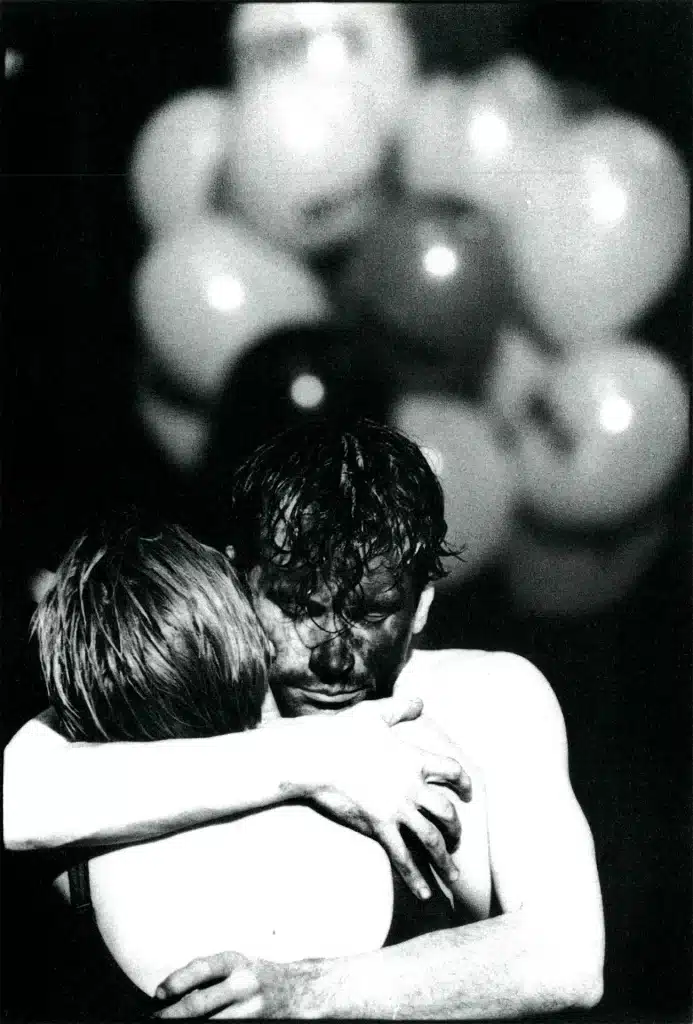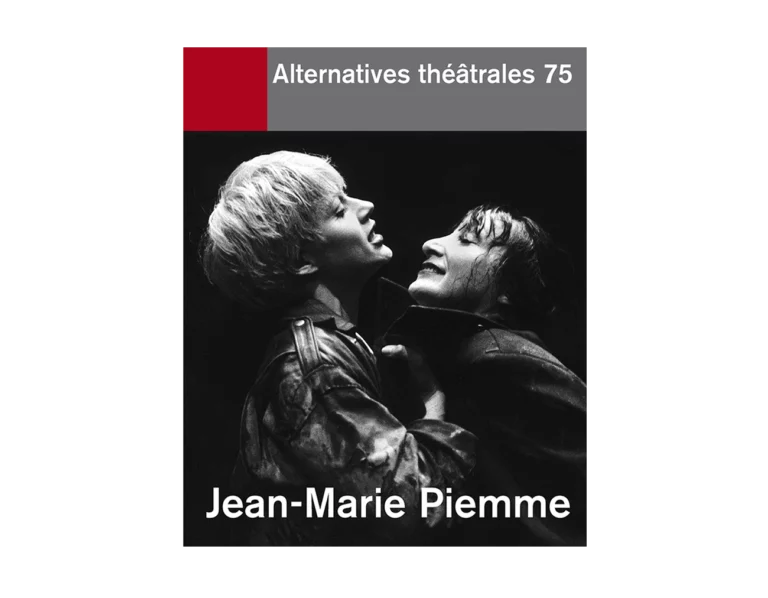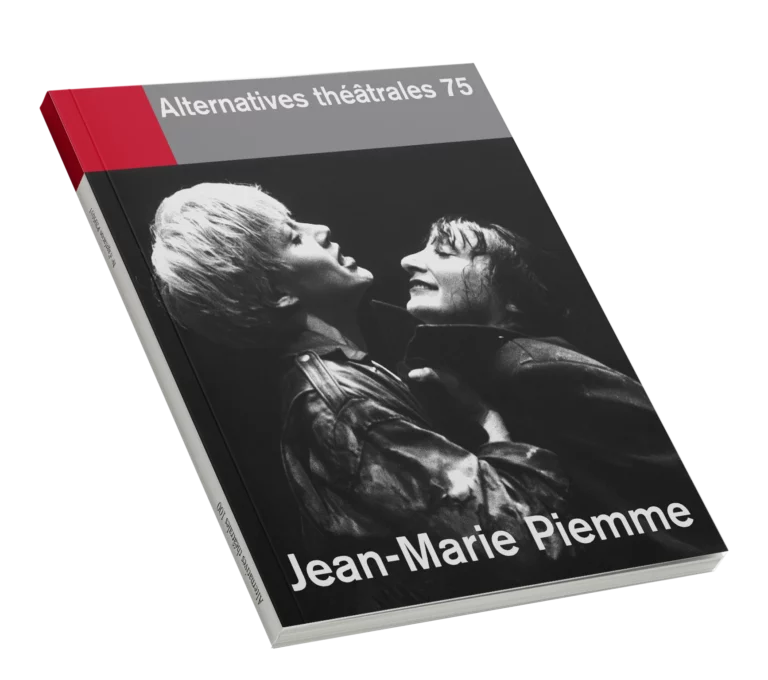LES SUJET de cette contribution au numéro consacré à l’auteur francophone sans doute le plus connu et le plus joué en Belgique néerlandophone est de tenter d’expliquer l’intérêt que suscite en Flandre le travail de Jean-Marie Piemme. J’ai occupé différentes fonctions qui m’ont permis de suivre le travail de Piemme au cours de ces dernières années. J’ai appris à connaître son travail comme critique, j’ai lu beaucoup de ses pièces comme dramaturge et j’ai été étroitement associé, il y a trois saisons, à la création néerlandophone de TORÉADORS, dans une ancienne usine, par la compagnie flamande Het Gevolg. J’ai pu suivre aussi cette production à l’occasion de sa reprise la saison suivante lors d’une tournée dans une série de théâtres en Flandre et aux Pays-Bas.
Avant d’aborder plus concrètement la position de Piemme dans le théâtre flamand, il me semble judicieux de dresser un tableau global des changements intervenus dans les relations communautaires et cela d’autant plus qu’il s’agit d’un auteur à connotation politique. C’est peut-être enfoncer une porte ouverte que de dire qu’il s’est creusé un abîme entre la Wallonie et la Flandre. L’évolution de la politique toujours plus poussée de fédéralisation de la Belgique a des causes historiques, sociologiques et économiques. L’art en général, et le théâtre en particulier, n’échappe pas à cette évolution. Je voudrais approfondir ce dernier point. J’e constate en Flandre une attention de plus en plus faible pour le théâtre francophone. On ne parle pas des productions dans les média, les compagnies ne sont que très rarement invitées par les théâtres et les festivals, et les collaborations entre compagnies au delà de la frontière linguistique sont rares.
La situation était pourtant tout autre il n’y a pas si longtemps. Voici quelques exemples qui permettent de clarifier mon propos. Dans les années septante, des acteurs francophones et néerlandophones réalisèrent ensemble Mistero Buffo qui connut un succès retentissant. Le spectacle fut joué dans les deux langues du pays, d’Avignon à Amsterdam et de Liège à Bruges. Lorsque je travaillais comme critique théâtral pour BRT 3, la chaîne culturelle de la radio flamande, suivre le travail théâtral des théâtres francophones allait de soi. On rencontrait souvent des collègues flamands aux premières du Théâtre National, de l’Atelier Sainte-Anne, du Varia, du Groupov mais aussi du Théâtre de la Place à Liège ou aux représentations du Théâtre Jean Vilar à Louvain-la-Neuve. On écrivait sur le théâtre francophone, il était suivi, il faisait partie du paysage théâtral. Cet intérêt a en grande partie disparu au cours de la dernière décennie. On constate plutôt aujourd’hui un intérêt inverse. Le travail de la nouvelle génération d’artistes des arts de la scène qui jouent un rôle international et éminent — je pense à Anne Teresa de Keersmaeker, Jan Fabre, Jan Lauwers, Wim Vandekeybus ou Alain Platel, est suivi aussi avec intérêt en Belgique francophone. La plupart de ces artistes ne travaillent pas à partir de purs textes de théâtre, et par là la barrière de la langue joue moins, mais le travail d’auteurs-metteurs en scène comme Arne Sierens ou Eric De Voider fait l’objet d’une suffisamment bonne attention pour que ceux-ci jouent aussi leur pièce en version française.
Mis à part le Kunstenfestivaldesarts qui doit plutôt être considéré comme un festival bicommunautaire, on peut affirmer que le théâtre francophone occupe en Flandre une place négligeable. L’absence d’un accord culturel entre la Flandre et la Wallonie fait qu’il est plus coûteux pour les organisateurs d’inviter des compagnies de l’autre partie du pays que d’inviter des groupes étrangers. C’est une première explication. La progression constante de l’abandon de la connaissance de la langue française au profit de l’anglais, surtout pour les jeunes générations, est une deuxième raison. En troisième lieu enfin, et il s’agit ici d’une dimension plus artistique, il y a une différence significative du traitement du texte et du style de jeu entre les deux cultures. Dans le théâtre francophone, le texte est encore traité souvent avec beaucoup de respect alors qu’en Flandre, celui-ci est devenu un élément plus flexible à l’intérieur du processus de création. À l’occasion de Toréadors, Jean-Marie Piemme déclara dans une interview au Standaard : « Je trouve la manière de jouer en Flandre beaucoup plus concrète. Mes textes offrent peut-être un contrepoids au code théâtral strict dans lequel le théâtre francophone se trouve encore souvent. » C’est peut-être là que se trouve la raison pour laquelle le théâtre de Jean-Marie Piemme fait l’objet d’intérêt en Flandre. Il est le seul auteur francophone dont les pièces sont inscrites régulièrement au répertoire des compagnies flamandes.
Fin 1993, Het gaat barsten (Ça va craquer) est créé par la compagnie malinoise Theater Teater. Toutes les conditions sont réunies pour une introduction optimale de Piemme et de son travail : la pièce est écrite suite à une commande de la compagnie, Frans Denissen en réalise une traduction forte et fluide et Philippe Sireuil, fidèle de l’œuvre de Piemme, fut engagé à la mise en scène. Suite à des incompatibilités artistiques entre acteurs et metteur en scène, Sireuil abandonna le projet un mois avant la première et le directeur artistique Jappe Claes reprit la mise en scène. Ceci confirme les difficultés dues aux différences dans le style de jeu dont j’ai parlé plus haut. Ça va craquer fut cependant une production importante. L’éminent critique flamand Wim Van Gansbeke compara le théâtre de Piemme à l’œuvre de Musil et le Theater Teater réalisa une adaptation de la vision personnelle de l’auteur : « Comme Musil, Piemme est fasciné par la langue. Ecrire pour le théâtre ne signifie pas faire du théâtre dans ma propre tête, essayer de penser une mise en scène imaginaire, mais créer dans le texte une trame pour la théâtralité, écrit-il. J’essaye de faire entendre la langue. Le théâtre est un des lieux étranges où la langue peut encore se faire entendre, loin de la communication fonctionnelle, des échanges de l’information et du bavardage médiatique. » (De Morgen) Cet équilibre entre texte dramatique et style de jeu fut en général relevé positivement dans la presse. Quelques exemples : « Des dialogues pointus et de l’humour se déploient dans un contexte juste. L’auteur cherche à assurer une balance précise entre action et récit. » (De Standaard) « Piemme ne pose pas le doigt sur une blessure. Il nous présente un kaléidoscope de la condition humaine contemporaine. C’est ainsi qu’est la vie à la fin du XXᵉ siècle. Tu regardes une bande de pauvres types, tu te regardes toi-même. Une expérience pitoyable mais en même temps comique. En cela il faut remercier tous les acteurs pour l’ironie subtile avec laquelle ils abordent leur rôle. Parce que c’est cela qui est sans doute le plus réjouissant dans cette représentation du Theater Teater : chacun y était excellent. Une manière de jouer profondément vécue et en même temps posée. » (Knack) « Quatre personnages suffisent à Piemme pour donner une image de la société toute entière. La langue aussi est fortement épurée. Ce qui est étrange, c’est que toute cette simplicité livre un résultat très riche. Pas un seul personnage n’est dessiné en noir et blanc, le décor suffit pour les sept scènes et la langue est d’une éloquence stupéfiante. » (Het Volk) Cette collaboration entre Piemme et le Theater Teater se poursuivit un an plus tard avec une nouvelle commande d’écriture.
Piemme travailla quatre monologues d’August Strindberg, intitulés « Théâtre de chambre » pour en faire une nouvelle pièce qui fut représentée sous le titre Toute une vie en une heure. Ou deux. Ce projet était de nature plus dramaturgique et fut surtout réalisé pour ses qualités de textes.
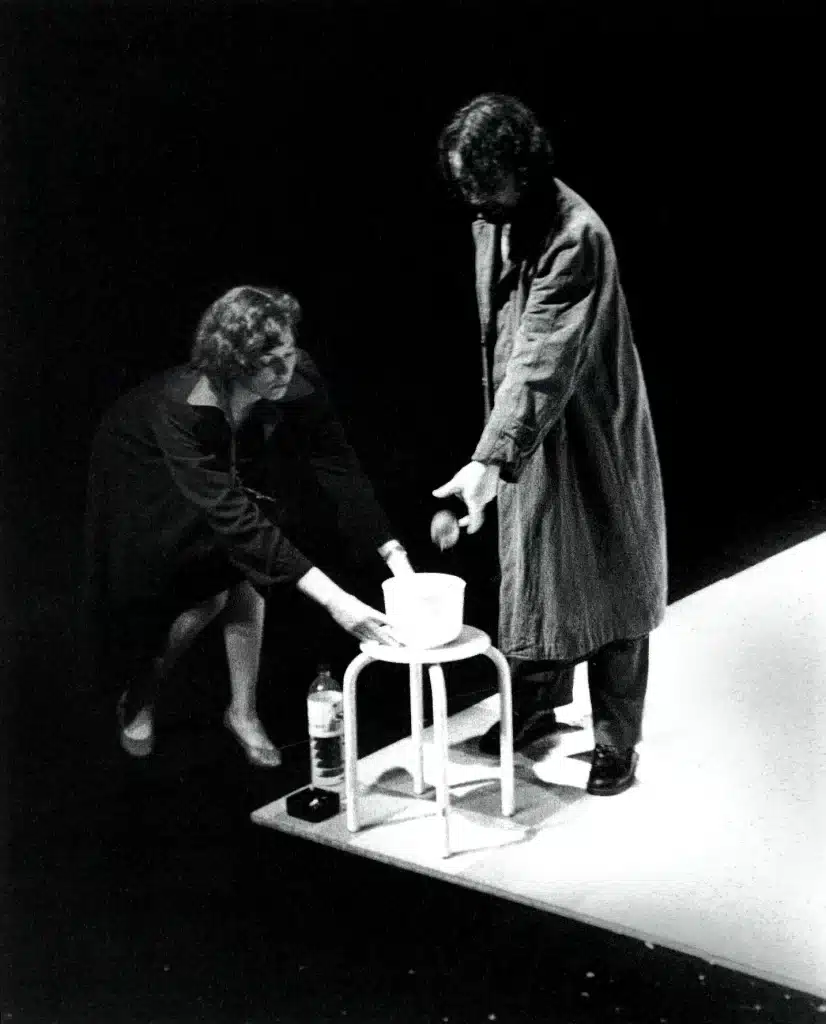
Début 1995, la compagnie Blauwe Maandag, la compagnie la plus importante à ce moment-là, programma Les Forts, LES FAIBLES. La traduction fut confiée à nouveau à Frans Denissen qui la réalisa d’une manière remarquable. Frans Denissen est un des meilleurs traducteurs belges. Cela s’est confirmé avec Zwak/STERK (Les Forts, LES faibles). Le texte français original, qui, selon le metteur en scène, aurait « résonné » de manière trop académique dans une version néerlandaise, a été transposé par Denissen dans un flamand dialectal. Ce qui rend la traduction forte, c’est que Denissen, à partir de cet idiome à première vue limité, laisse advenir toute une gamme de registres. Dans le dialecte, il évolue de la platitude au politique et de la bêtise à la pseudo¬ philosophie. Le metteur en scène est à nouveau Philippe Sireuil. Le processus de travail se déroula comme pour Ça va CRAQUER, de manière aussi difficile, mais cette fois-ci, l’équipe au complet atteignit la première.