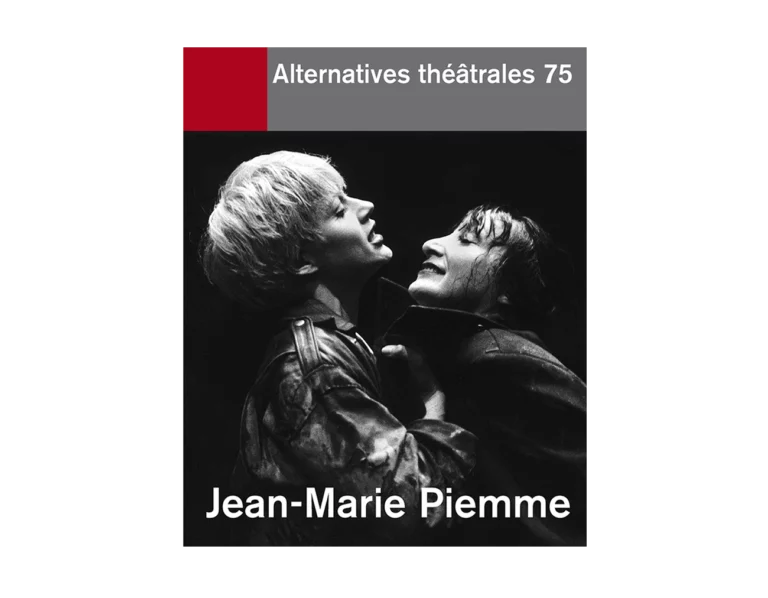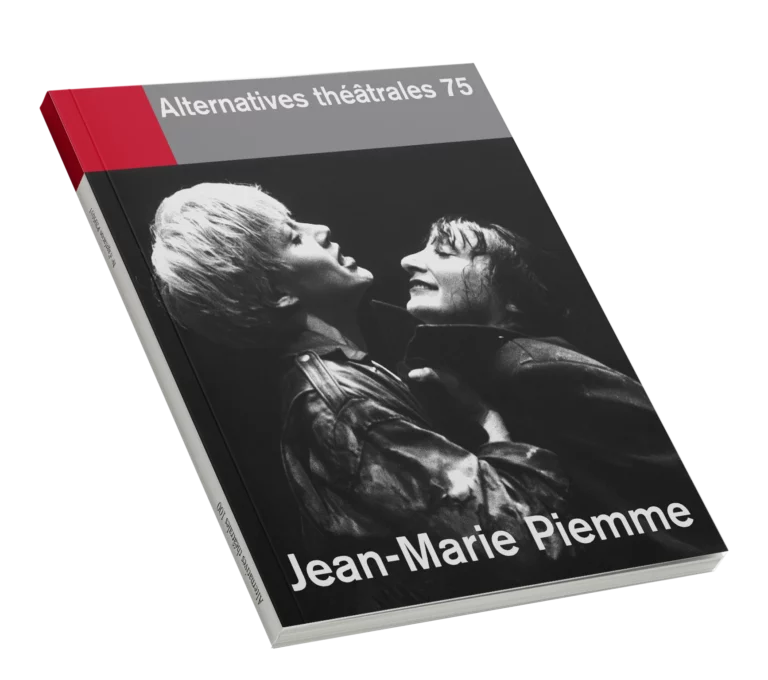COMMENT ÉCRIRE sur la Belgique, comment représenter la Belgique sur une scène, comment faire vivre un texte fait essentiellement d’allusions dissimulées à une réalité elle-même si mouvante ? C’est le pari tenté par Jean-Marie Piemme et Paul Pourveur qui ont écrit ensemble la pièce Les B@LGES. Le gant est ensuite relevé par les compagnies Dito’Dito et Transquinquennal qui forment ensemble le collectif bilingue DD’T. Réunis par des interrogations proches sur le statut de la représentation, ceux-ci centrent leur travail sur la réflexion et la discussion collégiales. De leurs multiples interrogations émerge alors un spectacle qui n’est que la partie visible de l’iceberg de leurs questionnements conjoints. La lente gestation de leur travail a pour eux autant d’importance que le résultat scénique final, et la matière, perpétuellement remise sur le métier, subit des mutations dont ils désirent conduire chaque piste à son terme. La remise en question étant essentielle dans leur démarche, chaque spectacle ne trouve sa forme aboutie que peu de temps avant la première. Dans cette optique et eu égard à la complexité du texte de Piemme et Pourveur, nous rendons compte ici d’une étape de cette gestation, mise en lumière parallèlement par les commentaires que les auteurs ont bien voulu nous donner sur leur écriture plurielle. L’interview des auteurs a été réalisée après celle des compagnies et sans elles, d’où la confrontation de points de vue qui peuvent diverger…
Théâtre National : Quelle fut exactement la genèse du projet Les B@lges ?
Jean-Marie Piemme : L’initiative émane de Philippe Sireuil, alors directeur du Théâtre Varia, qui nous a proposé, à Paul Pourveur et à moi-même, un projet d’écriture conjointe ayant pour thème la Belgique, qu’il mettrait en scène dans le cadre de Bruxelles 2000. Il s’agissait tout d’abord d’un feuilleton. Nous devions écrire sept ou huit épisodes d’une demi-heure, qui seraient présentés en rendez-vous réguliers à l’intérieur d’une soirée, dans un lieu ouvert, un chapiteau par exemple. Il y aurait eu toutes sortes d’attractions, dont une demi-heure de ce feuilleton sur la Belgique. Mais ces soirées nécessitaient une organisation et un soutien financier assez lourds et, de fil en aiguille, les sept épisodes ont été ramenés à trois, d’une heure et quart à peu près. Sur ces entrefaites, Philippe Sireuil a quitté le Varia pour le Théâtre Jean Vilar à Louvain-la-Neuve. Un tel projet ne cadrait plus avec ses nouvelles fonctions, et nous l’avons abandonné d’un commun accord. Cependant, nous avons continué à écrire le texte — nous étions encore payés par le Varia — mais nous n’avions plus de metteur en scène. Les compagnies Dito’Dito et Transquinquennal ont eu vent du projet et ont demandé à lire la pièce. Ils ont eu envie de la monter, mais nous ont demandé de resserrer le texte pour pouvoir le jouer en une seule soirée, ce qui a donné lieu à une première version continue.
T. N.: C’est la première fois que vous vous pliez tous deux à cet exercice de co-écriture. Comment avez-vous procédé ?
Paul Pourveur : Nous avons d’abord beaucoup parlé. Ce qui a fait émerger un contexte, des thèmes… Au bout d’un moment, nous avions défini un canevas concernant les grandes lignes narratives et les personnages ; nous avons commencé à écrire, chacun de notre côté. Nous nous envoyions les textes et chacun réagissait en retravaillant certaines parties, en continuant des scènes… Cela s’est fait d’une façon très naturelle, sans heurts ni disputes.
J.-M. P.: Le travail s’est fait par couches successives, qui se superposaient sur une trame très basique : le vague profil des personnages, la baraque de boxe, une sorte de saga familiale…
T. N.: Au fil des différentes versions du texte, on a pourtant l’impression d’assister à un travail d’élagage référentiel. Comme si vous vous étiez appliqués à brouiller les pistes qui rendaient les allusions à la Belgique reconnaissables.
J.-M. P.: C’est vrai. D’ailleurs, quand on a cherché le titre, on a décidé de remplacer le « e » de Belges par l’@, de façon à produire quelque chose de reconnaissable, mais d’imprononçable… Comme une référence, mais impossible, faussée. De façon assez systématique, on a effectivement cherché à faire le contraire d’une pièce à clef. Nous préférions élaborer une métaphore large qui colle vaguement à un esprit des choses sans que l’on puisse reconnaître formellement des événements ou des personnages particuliers.
T. N.: Quels étaient les thèmes qui vous étaient communs parmi ceux que vous avez brassés avant de passer à l’écriture et sur lesquels vous avez arrêté votre projet ?
P. P.: Le thème de la disparition est très vite devenu le fil rouge. Au gré des différentes versions, c’est ce thème qui a pris le pas sur le reste, et qui nous a semblé essentiel à aborder. Il évoque bien entendu les affaires d’enfants disparus dans le pays, mais aussi une forme de disparition identitaire, voire de disparition du sens, de délitement interne qui nous semble être l’expression d’un certain malaise, d’une certaine réalité qui nous est propre. Nous avons écrit la pièce dans une période assez trouble pour la Belgique. Il y a eu la marche blanche qui diffusait des « plus jamais ça », un vent d’utopie soufflait, une reconstruction unitaire complètement virtuelle qui renvoyait irrésistiblement à l’artifice que fut la création de la Belgique en 1830. Personnellement, je me sens plutôt bien dans cette réalité artificielle, cette non-identité. Si on est défini comme Flamand, Wallon, ça a une connotation politique, mais « Belge », ça ne veut pas dire grand-chose, et ça donne une liberté…
J.-M. P.: Ce côté artificiel, je le sens aussi très fort : ce pays n’existe pas pour moi. Je n’ai aucun attachement particulier à l’État-nation « Belgique », mais bien à ce qu’elle est et aux communautés telles qu’elles sont. Des choses tiennent ensemble pour des raisons de bricolage historique, politique, mais sans aucune dynamique interne de développement, de légitimité. C’est un pays de farces et attrapes en fait : il y a toujours des surprises, c’est excellent pour la fiction ! Des choses incroyables s’y produisent souvent, ce qui entraîne le rire et une forme caractéristique d’autodérision. Vu sous l’angle de la mondialisation, il est probable que les pays qui nous entourent seront amenés à devenir comme la Belgique, à croire et hurler qu’ils sont indépendants, alors qu’ils le sont de moins en moins…
T. N.: Votre fiction pratique une sorte de piratage de la narration par de longs monologues, par un aspect schématique des personnages qui semblent en perte de densité…
J.-M. P.: Nous ne voulions pas écrire une pièce à personnages — ce que nous aurions peut-être fait si nous avions continué le projet de feuilleton. Nous n’avions pas le souci de construire des caractères au sens plein du terme, mais plutôt des figures vaguement évocatrices. Plutôt que des gens, la Belgique, pour nous, c’était le bulletin météo, la circulation, une façon de ne pas s’en faire, de ne pas voir, de composer avec les choses. On voulait faire transparaître ces sortes de lignes de conduite, et ne pas tomber dans le détail, pour éviter le folklore, la pièce à thèse, le cliché automatique. D’où notre choix de rester dans l’allusion, et non dans des affirmations fixées une fois pour toutes.
T. N.: Et le fin mot de la pièce, cet homme et cette femme face à face et tous deux « enceints », serait-ce comme une note d’espoir, l’espoir que quelque chose pourrait naître de cette aberration historique, génétique ?
J.-M. P.: Ce n’est ni optimiste ni pessimiste, c’est plutôt une ouverture vers quelque chose, une sorte d’avenir mutant sur lequel nous n’avons pas vraiment d’avis. A aucun prix nous n’avons voulu nous ériger en pythies, et dire ce que la Belgique serait dans vingt ans. La disparition successive des personnages est conduite à son terme, seuls deux d’entre eux restent, porteurs d’une forme d’avenir, mais sont-ce des monstres qui en sortiront ? Là, nous, on s’arrête !
T. N.: Si ce sont ces deux personnages — elle sans papiers, lui génétiquement hybride, et tous deux venus de l’extérieur — qui constituent une possibilité d’avenir pour la Belgique — et plus largement pour les sociétés humaines —, cela induit quand même des perspectives ouvertes au changement, au dépassement des limites et des clivages nationalistes, biologiques, culturels…
J.-M. P.: Vue sous cet angle, c’est vrai que la fin pourrait être optimiste. Il est évident que la Belgique est un pays de contraste, de croisement, de métissage et que cette dimension « multiculturelle » est une richesse.
P. P.: L’absence d’identité implique certainement la possibilité de faire davantage de choix identitaires individuels. C’est donc assez libérateur de ne pas être fixé. Mais le personnage de Jim aborde aussi la question d’un siècle où la génétique serait bien plus déterminante que des histoires de baraque de boxe.
T. N.: Les compagnies travaillent ce thème de la disparition dans une optique assez grave. Nous sommes alors loin de la joyeuse métaphore sur la Belgique telle que vous l’annonciez au début.
J.-M. P.: Cela vient peut-être de notre écriture. Nous avons tous deux tendance à écrire des choses graves de façon relativement légère. De cette tonalité commune vient peut-être aussi notre bonne entente dans l’écriture. Mais il n’est pas étonnant que, sous cette apparente légèreté, Dito’Dito et Transquinquennal découvrent cette gravité. Nous ne voulions pas faire une pantalonnade, un « sketch sur la Belgique ». La thématique de la disparition, d’un pays qui se délite, ce n’est effectivement pas riant, mais j’aime bien le recul de l’ironie, de la distance, que la chose qui fasse mal devienne un objet plaisant où l’humour puisse affleurer.
T. N.: Les compagnies ont pu porter un regard sur le texte, et faire leurs remarques. Dans quel sens allaient-elles ?
P. P.: Ils voulaient surtout raccourcir le texte. Cette version était encore celle de Bruxelles 2000, en trois épisodes donc, et comportait des redites, pour les besoins de compréhension des spectateurs. Beaucoup de remarques visaient aussi à clarifier des choses. Mais les deux compagnies n’ont pas vraiment le même rapport au texte. Les remarques venaient surtout de Transquinquennal… Les Flamands laissent peut-être plus la place aux auteurs, il y a moins de remise en question. Le texte est sacré pour eux, il n’est pas un prétexte à la représentation. Peu de metteurs en scène se mettent entre le texte et le spectateur. S’ils le font, ils réécrivent le texte, comme le fait Jan Decorte par exemple sur des pièces de Shakespeare.
J.-M. P.: J’aime bien la démarche des troupes flamandes, en effet assez respectueuses du texte sans pour autant en être prisonnières. Pour ma pièce Toréadors, par exemple, créée par la compagnie Het Gevolg, la mise en scène d’Ignace Cornelissen a très bien respecté l’esprit du texte tout en prenant des options fortes, puissantes. Il y a, du côté flamand, une certaine façon de faire un théâtre très direct, très adressé au public, avec une désinvolture intelligente certainement préférable à un faux respect.
Entretien avec les compagnies Dito’ Dito et Transquinquennal (DD’T), en cours de création du spectacle Les B@lges.
Pour cette première rencontre (le 1ᵉʳ octobre 2002), nous nous rendons dans les studios du Kaaitheater rue Notre-Dame du Sommeil où répètent les compagnies… Nous nous installons autour d’une grande table où se déroule pour l’instant l’essentiel du travail. L’entretien se passe surtout à évoquer le parcours commun de DD’T. Le travail sur le texte vient de commencer, et peu de pistes se dégagent encore. Une seconde rencontre aura lieu, un peu plus tard, pour approfondir les lignes dramaturgiques qui se profilent.
T. N.: Comment aborder cette saga des B@LGES, difficile à comprendre à la lecture et renvoyant à une réalité plutôt impalpable ?
DD’T : — La pièce fonctionne toujours par références indirectes, il n’y a pas de clefs pour comprendre les personnages dans une réalité concrète. Celui-là n’est pas De Haan, ou X, ou Y, et il n’y a pas non plus de distinction Flamand/Wallon. Nous y voyons plutôt des modes de fonctionnement évocateurs.
DD’T : — Ce n’est pas une comédie, et ça dépasse complètement le côté folklorique. Il y a cet aspect éclaté, mystérieux, complexe, qui nous parle de la Belgique. Mais ça nous parle plus généralement d’aujourd’hui, de la globalisation, de la Belgique dans cette globalisation, à travers la lorgnette belge, ce qui donne un ton assez drôle. Beaucoup de l’humour de la pièce fonctionne d’ailleurs sur cette absence de repères et sur des confusions. À l’intérieur même de la pièce, on distingue plusieurs niveaux de réalité et de lecture. Il y a une trame narrative ; comme la pièce était d’abord écrite sous forme de feuilleton, cette trame avait quelque chose de presque simpliste, ce qui amène aussi une forme d’humour d’ailleurs. Mais le fil de la narration est occulté de façon récurrente par des réflexions, des monologues en surimpression qui contredisent le déroulement de l’intrigue et la complexifient. Il s’agit donc de faire la clarté sur beaucoup d’aspects qui à la lecture restent obscurs. Les rapports et les filiations entre les personnages, par exemple. Pourtant, la pièce raconte autre chose que ces relations familiales. À nous de rendre cela absolument lisible, pour la compréhension du spectateur.
DD’T : — Pour notre travail d’ensemble, à deux compagnies, c’est une interpellation sur la représentation. Il y a tant de niveaux de jeu, de langue, de discours… Nous ne voulons pas que la représentation se perde dans ces labyrinthes. Il y a le regard que nous posons sur le texte, qui fait donc référence à notre réalité à nous, et puis il y a l’interprétation que nous voulons en faire, et ces deux axes doivent être mis en scène, presque à parts égales.
T. N.: À ce niveau-ci, les auteurs n’interviennent plus du tout ?
DD’T : Non, à part pour quelques petites questions, plutôt de l’ordre du détail.
T. N.: Et vous jouez plusieurs rôles ?
DD’T : Oui, il y a ça aussi ! Nous allons d’ailleurs commencer, dès maintenant, à faire des filages (NDLR : répétition de la pièce dans sa totalité), pour que la structure interne de la pièce apparaisse de façon plus limpide. Nous allons faire cela devant des spectateurs tout à fait extérieurs, pour voir ce qui se dégage. Après avoir trouvé une certaine fluidité dans la fable, on pourra intégrer les autres niveaux de compréhension.
T. N.: Vous travaillez le texte dans les deux langues ?
DD’T : Non, pour l’instant nous nous centrons sur le texte français. C’est la première fois d’ailleurs que nous commençons par le français, mais comme nous avons plus de temps pour la création en flamand, et que ça demande plus de travail pour les comédiens francophones, on se centrera sur le texte néerlandais par la suite.
T. N.: Avez-vous déjà des pistes dramaturgiques plus précises ? Et des précisions sur les décors, les costumes ?
DD’T : Nous avons déjà quelque pistes, mais rien de définitif. C’est aussi une part de la difficulté d’une démarche comme la nôtre, qui reste longtemps « en chantier », susceptible de variations, même dans une phase très avancée du travail. Mais il y a le temps de production : les décors et les costumes doivent être réalisés alors que la forme est encore très mouvante pour nous et qu’il est difficile de figer un élément. L’idéal serait d’avoir un costumier et un scénographe dans l’équipe, qui fasse le trajet avec nous.