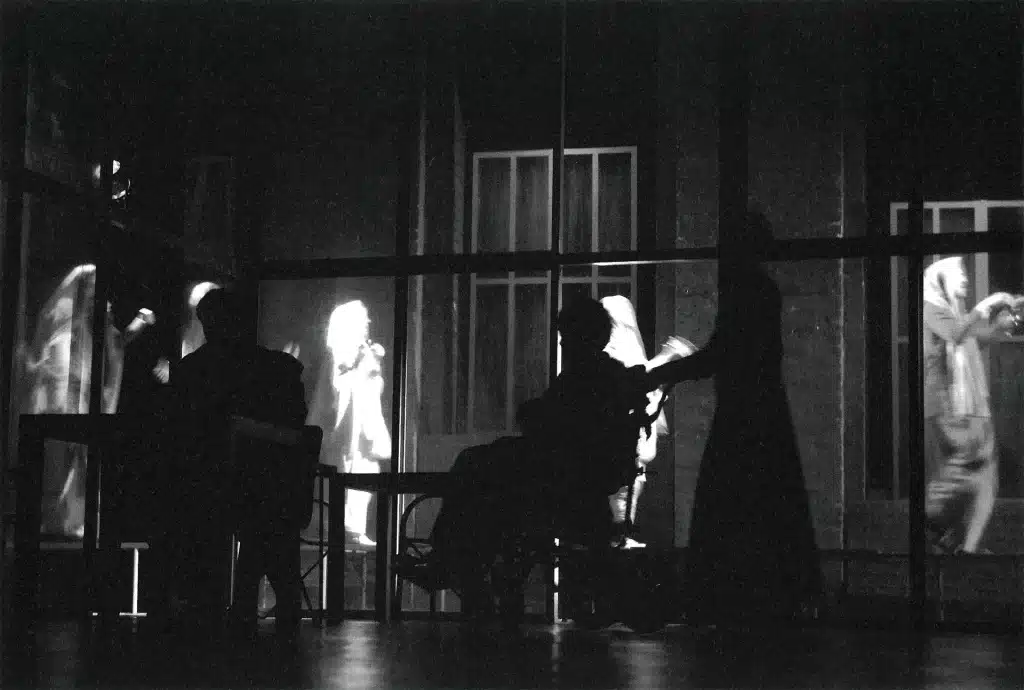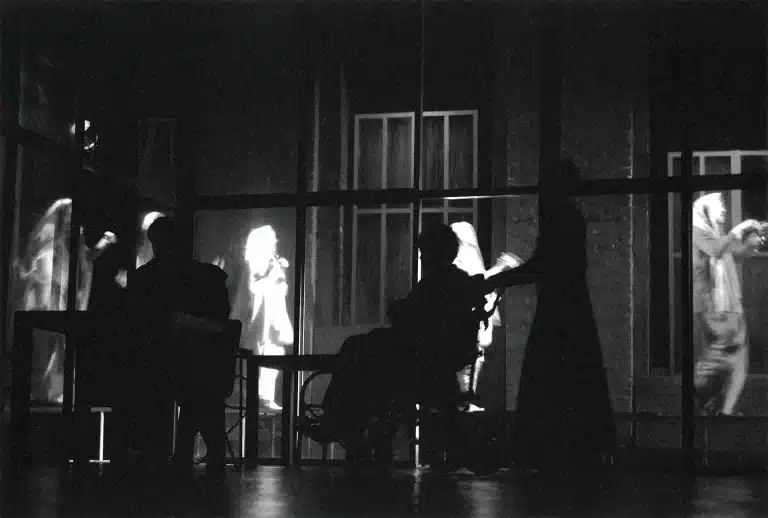Marek Fiedor fait partie des meilleurs metteurs en scène d’une génération qui, depuis quelques saisons, a atteint sa maturité créatrice et donne le ton à la vie théâtrale en Pologne.
Il a à son actif 21 spectacles dont quatre préparés en dehors des scènes permanentes. Très lié au Théâtre Stary de Cracovie, dans les années 1993 – 2000, il a travaillé aussi dans d’autres centres dramatiques plus petits comme Torun et Opole. Il prépare actuellement sa première mise en scène à Varsovie.
Né en 1962, il a grandi dans les villes de province du sud-est de la Pologne. Entre 1981 et 1986, c’est-à-dire durant l’état de guerre instauré par les autorités communistes pour étouffer le mouvement Solidarnosc, il a étudié le théâtre à l’Université Jagellone de Cracovie. Sa génération a connu le marasme et la sensation du provisoire. Elle devait résoudre le dilemme : rester au pays ou émigrer en Occident, participer à la vie publique au prix de compromission, trahir ses idéaux ou s’engager dans une lutte politique clandestine ? Beaucoup ont alors tenté de s’isoler des pressions sociales dans un asile esthétique ou spirituel. À l’issue de ses études universitaires, Fiedor a fait toutes sortes de travaux durant deux ans. Il a notamment organisé une session d’études consacrée à l’œuvre de Jerzy Grotowski. Il repoussait ainsi toute décision finale qui l’engagerait dans l’âge adulte.
En 1988, il a commencé des études au département de mise en scène à l’École supérieure de théâtre de Cracovie où il a rencontré Krystian Lupa. Il fut son assistant lors de la réalisation de la version étudiante, en février 1990, des Esquisses de L’Homme sans qualités de Robert Musil et co-créateur d’une partie du spectacle intitulée Du côté de Agathe. Plus de dix ans après, à Poznan en 2001, il a créé dans un spectacle à deux acteurs, Le Royaume millénaire, sa propre version de la rencontre d’Agathe et d’Ulrich après la mort du père. Au son d’une musique de Bach, le frère et la sœur parvenaient à un rapprochement amoureux et, par là, à l’incarnation du mythe de Platon sur les deux êtres au sexe opposé aspirant à l’unité.
Avant même que Lupa n’ait présenté Les Somnambules, il s’est intéressé à la prose de Hermann Broch et a préparé ensuite l’adaptation des Innocents à Opole, en 2000. Dans le personnage d’André, habitant une maison remplie de femmes qui doivent lui assurer une sécurité maternelle, Fiedor s’est concentré sur la peur de l’âge adulte et la fuite devant les responsabilités qui s’achèvent par le suicide. Il a repris en effet de Lupa son intérêt pour le processus de formation de la personnalité, traité à partir des notions de la psychologie des profondeurs.
Les rêves et les fantasmes, manifestations de l’inconscient des personnages, jouent en général un rôle important dans les spectacles de Fiedor. C’est pourquoi il souhaitait réaliser La Montagne magique de Thomas Mann, qui visualise la cristallisation de la personnalité de Hans Castorp.
Il a monté La Mouette de Tchekhov (Wroclaw 1995) en donnant une facture réaliste au drame : de courts épisodes, joués sous différentes variantes, ont été isolés par des instants de pénombre. Il s’est concentré sur les relations complexes entre les personnages et les moments d’émotion intense.
Dans Ozenek (La Demande en mariage) de Nicolas Gogol (Torun 1997), renonçant aux conventions de la comédie de mœurs, il a transposé l’intrigue dans un scénario contemporain et en a extrait les complexes, les freins ou les angoisses des personnages liés à l’initiation sexuelle et au mariage. Dans l’épilogue, le grassouillet et maladroit Podkolesin, malgré le rapprochement réussi avec Agafia, fuit par la fenêtre. Il a décidé de rejeter le rôle du mari et refusé de participer à la vie commune ; tout comme Oblomov qui se prélassait dans son lit, dans le roman d’Ivan Gontcharov. L’intérieur dévasté dans lequel se déroulait Ozenek, les fenêtres et les portes qui s’ouvraient toutes seules, le lustre qui se brisait, les cendriers qui tombaient des tables, rappelaient la mystérieuse maison dans Stalker d’Andrei Tarkovski.
Résolvant en effet « les mystères des liens complexes, les secrets des tensions émotionnelles », Fiedor se réfère aux réalisations du cinéma européen. À l’école, il exploitait les scénarios de films : il a réalisé une étude sur les motifs de La Nuit de Michelangelo Antonioni et un spectacle montrant Persona d’Ingmar Bergman du point de vue d’Alma. La Trahison d’Harold Pinter (Cracovie 1993) avait une construction cinématographique, formée de courtes séquences soumises au rythme d’une introspection. Les rencontres d’Emma, de Jerry et de Robert, montées dans l’ordre chronologique inverse, précédées du déclic d’un appareil photo et colorées en rouge dans les parties sombres, devenaient des sortes de photos émergeant lentement du passé.
Fiedor consacre beaucoup d’attention à la formation de l’artiste comme cas particulier du processus d’individualisation. Ce thème est apparu dans La Mouette, avec Constantin et Nina qui rappelaient des créateurs contemporains. Nina récitait une œuvre de Constantin, debout, pieds nus sur un carrelage de verre sur lequel s’écoulait de l’eau. Auparavant, Fiedor a montré un groupe d’amis qui envisageaient de se consacrer à l’art et au travail intellectuel dans le spectacle Bungo 622 (Cracovie 1992) basé sur les thèmes du premier roman de Stanislaw Ignacy Witkiewicz, Les 622 chutes de Bungo. Le peintre et écrivain Bungo (dont les traits caractéristiques proches de Witkiewicz sont accentués grâce à l’introduction dans le scénario de ses lettres à l’ethnologue Bronislaw Malinowski), Edgar Navermore, Brummel de Buffadero-Bluff et Tymbeusz mènent de fiévreuses discussions sur les principes à adopter pour atteindre la plénitude artistique.
Le spectacle Tryptyk Wyspianski (Poznan 1998 et Cracovie 2000) s’inspirait de la vie du peintre et poète symboliste Stanislaw Wyspianski à Cracovie et durant son séjour à Paris. Les plaisirs de la jeunesse, sa liaison avec un modèle français, ses séjours à l’hôpital se croisaient avec les scènes de ses drames artistiques Méléager, Achilleis et Protesilas i Laodomia, exprimant l’obsession de la mort. Les spectateurs étaient placés sur la scène où l’on avait reconstitué l’intérieur de l’atelier de Wyspianski tandis que les fragments de ses tragédies étaient joués dans la salle du théâtre.
Dans Paternoster de Helmut Kajzar (Torun 1998), le metteur en scène de théâtre Joseph, tel le fils prodigue, revenait en rêve à la demeure familiale à Kocierzyce Wielkie, chez un père sévère et une mère pleine de sollicitude. On aboutissait à la confrontation des valeurs traditionnelles avec les buts illusoires que se donne l’art. Fiedor a placé le drame dans la scénographie d’un aéroport avec une grande piste de décollage et a mis ainsi en lumière le vacillement de l’identité du protagoniste. Il a donné à Joseph les traits de Kajzar, metteur en scène et écrivain mort dans la force de l’âge, en lui faisant dire des fragments de ses essais sur le théâtre ou de ses entretiens dans la presse.
Dans le personnage éponyme de Baal de Bertolt Brecht (Lódz 2002), il a incarné surtout un poète révolté et montré ses rencontres avec les lecteurs, les éditeurs et les critiques. En donnant le rôle principal à plusieurs acteurs et en présentant dans des séquences séparées les liens érotiques de ce marginal avec des femmes et des hommes, ses protestations politiques ou ses rapports avec la religion, Fiedor cherchait à présenter, en accord avec le sous-titre du spectacle, « sept aspects de la vision baalesque du monde ».