DAVID BERNADAS : En tant qu’artiste, comment définissez-vous la notion de risque ?
Christian Rizzo : Il y a cette phrase que j’attribue, peut-être à tort, à Claes Oldenburg lors d’un entretien avec Isamu Nogushi : « un seul risque me préoccupe, celui de ne pas être compris. » L’enjeu du risque est éminemment personnel : en mettant en forme une vision, l’artiste prend le risque d’être confronté à une incompréhension totale, d’être mis face à ses propres maladresses.
D. B.: Le risque est-il présent dans votre recherche ?
C. R.: Parce que je choisis de servir mon propos plutôt que d’énoncer une proposition formatée, je prends le risque d’être en contradiction avec des critères d’appréciation qui pourraient constituer une norme. Prendre un risque, c’est aussi certainement accepter que quelque chose m’échappe puisque chaque spectateur, lorsqu’il pénètre dans une salle de théâtre, attaque les enjeux de la représentation avec sa propre singularité.
D. B.: Les projets présentés aujourd’hui sur les scènes européennes vous semblent-ils formatés ?
C. R.: Ceux qui affirment leur singularité existent mais ils sont peut-être encore trop rares… Le fait de développer des projets basés sur des grilles de lecture normalisées, correspondant à une époque et à un territoire, représente pour moi le danger d’ériger un « académisme » dans les arts contemporains. Je crains aussi que des projets extra-européens ou non-occidentaux emboîtent le pas à ces critères, simplement pour répondre à des besoins de diffusion.
D. B.: Comment intégrer le risque à votre pratique ?
C. R.: Il s’agit de mettre en péril mon regard sur mon propre travail. Cela peut passer par une série de questions : comment observer ? Comment partager les enjeux du travail avec de nouveaux collaborateurs ? Comment m’attaquer à une forme que j’ai moi-même du mal à définir ?
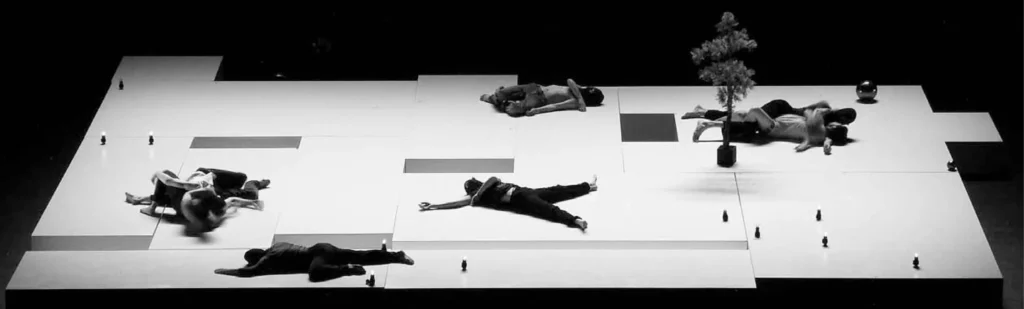
D. B.: Dans cette démarche, de quoi ou de qui vous libérez-vous ?
C. R.: Cela me permet d’être beaucoup plus complexe qu’une simple image et de ne pas produire ma propre norme. C’est aussi une aventure collective qui me permet de me libérer d’une marque de fabrique. Il s’agit d’être ensemble pour accéder au vivant, pour entrer en friction avec le public. Je préfère risquer le mépris plutôt que d’être confronté à l’indifférence et s’il faut passer par le conflit, je suis prêt à l’accepter. L’objet à réaliser est à chaque fois vivant et réactivé : le risque existe à la fois sur le plateau et dans la salle, pendant la représentation, et surtout après…
D. B.: À propos du conflit, quelle est votre position vis-à-vis de l’institution qui vous finance ?
C. R.: Je pense qu’on gagne à considérer que l’institution nous est extérieure mais qu’il s’agit bel et bien d’une entité dans laquelle nous sommes inclus. Nous travaillons donc ensemble, à côté d’autres artistes, à l’intérieur de ce système complexe.
D. B.: Le risque est-il inscrit d’emblée dans l’élaboration, et donc dans la production d’un spectacle ?
C. R.: Dans chaque production, il y a par essence un enjeu financier qui est notamment répercuté sur le temps de travail. Des questions budgétaires m’ont toujours conduit à reconsidérer un projet, à faire des choix. La notion de risque est donc aussi liée à chaque projet : de l’un à l’autre, je veux rester au plus près du désir qui l’a fait naître et lui donner une forme sans me laisser interférer par ce qui est déjà en place.
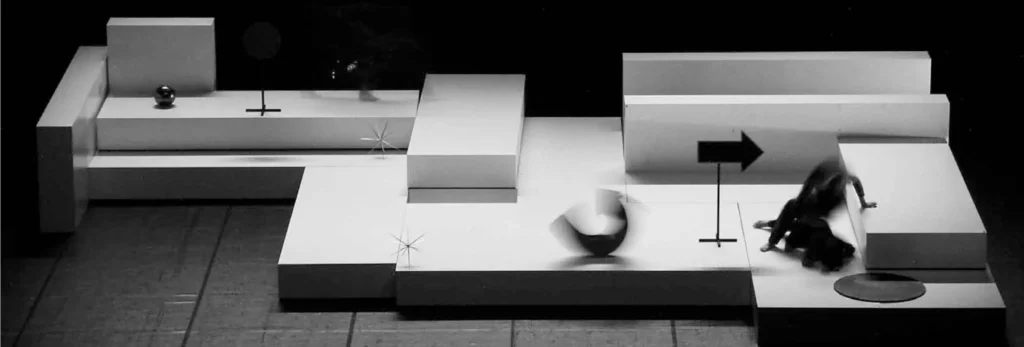
D. B.: Est-ce que le désir dont vous parlez est à rapprocher d’une pulsion ?
C. R.: Non, je parle d’une sensation qui a besoin d’un objet formel pour se comprendre. Le processus de fabrication me met face à un manque : prendre un risque, c’est essayer d’être au plus proche de mon désir, de la représentation que je me fais moi-même de ce manque.
D. B.: Par la prise de risque, que pensez-vous briser, que pensez-vous atteindre ?
C. R.: Je cherche à réinventer constamment : que rien ne soit fixe, que tout soit en mouvement… Je parle d’une capacité à réinventer le monde : le monde n’est pas, il est à inventer au quotidien pour pouvoir le comprendre ! Il s’agit donc de briser les habitudes de regard qui sont faites sans choix. « Prendre des risques », « être en révolte»… J’intègre ces deux notions en estimant que le monde n’est pas et qu’il doit s’inventer.
D. B.: Le renouvellement de la forme doit-il passer par la prise de risque ?
C. R.: Le risque fait pour moi partie de la donne. J’ai toujours cette image du funambule pour qui le déséquilibre et la chute font partie intégrante du travail, au quotidien : les formes mises en jeu dans un théâtre ne doivent pas s’inscrire, nous devons les amener à se renouveler.
D. B.: Quelle différence faites-vous entre risque et provocation ?
C. R.: Il y a une attente de résultat dans la provocation, alors que la prise de risque correspond à quelque chose de plus mouvant, qui n’est pas adressé. Le risque n’est pas toujours visible, il peut se lire en sous-texte, notamment dans la forme et surtout lorsqu’il correspond à quelque chose d’intime.
D. B. : Quelle place occupe selon vous Artaud par rapport à cette problématique du risque ?
C. R. : Artaud, c’est une vie d’artiste poussée à son paroxysme. Mis à l’écart, affamé, empêché dans son travail. C’est la version extrême de l’artiste qui assume, ou pas – je ne sais pas à quel point il a été capable d’interroger sa pratique d’artiste –, le risque d’être totalement déplacé. Il a sans doute accepté d’être incompris pour continuer à réinventer le monde…







