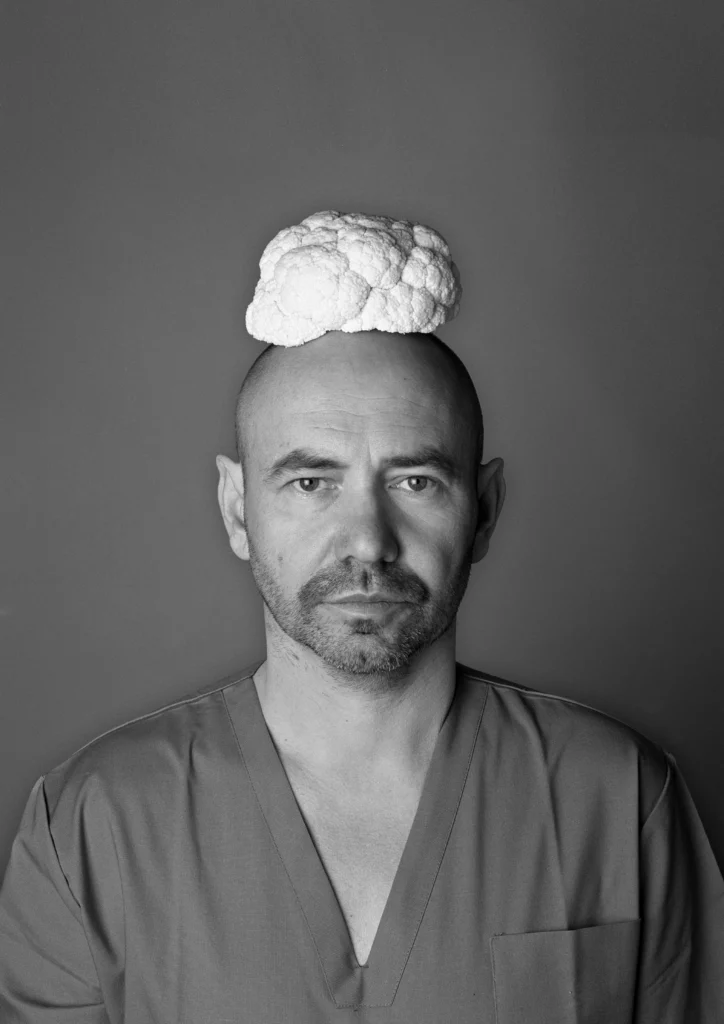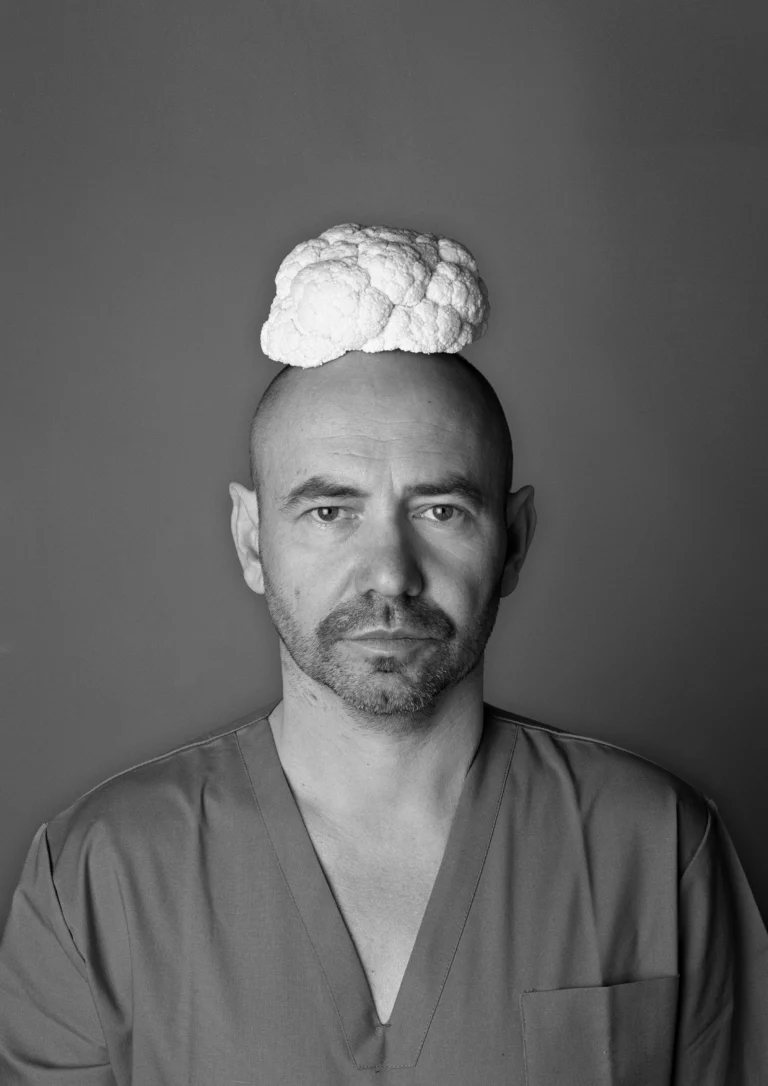IL Y A DIX ANS, Jan Fabre écrivait le monologue L’EMPEREUR DE LA PERTE (1994). Ce solo, l’un des textes les plus riches de Jan Fabre jusqu’alors, fut porté à la scène de façon magistrale par l’acteur flamand Dirk Roofthooft.
L’EMPEREUR DE LA PERTE s’avère un plaidoyer pour l’imperfection, la beauté de perdre, le désir toujours récurrent de recommencer, de tout oublier « sauf le refus ». Un éloge, donc, de la résilience, de la résistance. Que cet empereur de la perte soit un alter ego de Jan Fabre qui, par l’entremise de son personnage, nous fait part de sa conception du rôle de l’artiste dans la société, est l’évidence même. Le personnage s’adresse directement au public et lui demande de manifester de la compréhension pour ses incessants « exercices » et ses petits échecs. Au fur et à mesure, le personnage se transforme en un ange, porté par la soif de transcender, de s’élever au-dessus de la médiocrité, de dépasser les contradictions, de trouver la voie vers le « rêve insoluble », le « plaisir suprême », « la perfection ». Ou encore : par le désir de « l’autre côté du temps », l’un des thèmes récurrents de Fabre, comme le prouve la chorégraphie du même nom DA UN’ ALTRA FACCIA DEL TEMPO (1993).
Depuis, Fabre s’est plus d’une fois identifié à ce personnage : son autoportrait en bronze, L’HOMME QUI DONNE DU FEU porte pour sous-titre L’EMPEREUR DE LA PERTE : l’artiste qui, comme Prométhée, transmet aux autres le feu qu’il s’est procuré, leur permettant ainsi de s’émanciper.
Dix ans plus tard, Jan Fabre écrit un nouveau monologue qui forme un diptyque avec L’EMPEREUR DE LA PERTE et porte un titre tout aussi éloquent : LE ROI DU PLAGIAT. Comme l’empereur, ce roi du plagiat s’adresse frontalement au public dans le but de le séduire : d’une façon désarmante, il lui demande de le respecter, de l’estimer, de l’accepter. Ce personnage s’exerce lui aussi, tant bien que mal, « il essaie » « il répète ». Que répète-t-il donc ?
Devant nous se tient un ange qui veut devenir homme, qui veut « renoncer à son immortalité » et être entendu par un tribunal composé de « singes bavards » – car c’est ainsi qu’il voit les humains – pour se justifier, se défendre, être admis au rang de l’humanité. Pour ce faire, il a dû avant tout apprendre à « parler avec les mots des autres », à plagier.
L’EMPEREUR DE LA PERTE disait déjà de l’authenticité qu’elle était « pauvre ». Dans LE ROI DU PLAGIAT, la terreur de l’authenticité, vue comme un véritable fondamentalisme créatif, est radicalement rejetée. Ce texte, encore plus riche que le précédent, peut être lu à plusieurs niveaux : la chute de l’ange, la genèse de l’homme, la réflexion sur l’imitation en général et concrètement, sur l’imitation dans l’art, et enfin, l’éloge de l’intertextualité. Au travers des mots qu’exprime ce roi du plagiat, Fabre propose une vision mûrement réfléchie de l’authenticité qui, d’emblée, réitère le credo artistique de son œuvre. Réitère, en effet : le thème du plagiat, de la copie et de la falsification se rencontre fréquemment dans l’œuvre de Fabre ; il suffit de penser à la thématique analogue de FALSIFICATION TELLE QUELLE, INFALSIFIÉE, dont le texte date de 1992.
Dans LE ROI DU PLAGIAT, la genèse de l’homme est clairement associée à sa capacité d’imitation. L’homme ne se crée jamais à partir de rien, mais à l’exemple d’autres humains. L’homme est par définition « culture », et non « nature originelle ». Le désir de l’ange de devenir humain découle du fait que les hommes peuvent prendre des risques, subir des échecs, perdre la partie, mais aussi désirer et jouir, au contraire de l’ange qui est au-dessus de tout. L’ange veut devenir humain pour comprendre les hommes : une aspiration dont le thème a été interprété de façon légendaire dans le film LES AILES DU DÉSIR de Wim Wenders.
Le texte reflète également le conflit entre l’original et l’imitation dans le domaine de l’art : le combat entre l’art en tant que creatio ex nihilo (romantisme et modernisme) et l’art en tant que culture mimétique (renaissance et post-modernisme). L’ange qui veut devenir homme dans la pièce en question est l’ange qui abjure la pensée d’originalité et défend le chaos socioculturel de la littérature et de l’art comme l’art de l’imparfait, l’art humain par excellence. Que l’on pense à ce que disait Valéry : « ce qui est fini, n’a pas été fait ».
L’art est le processus mimétique à jamais inabouti qui ne tient en rien du credo de la perfection utopique. Le roi du plagiat est le défenseur de la culture humaine. Il s’insurge contre la terreur de l’originalité, de la pureté et du fondamentalisme créatif. L’intertextualité et le plagiat sont des qualités humanistes : l’échange de connaissances, de textes, de phrases, de mots, depuis le premier dessin rupestre jusqu’à la copie, le prêt et l’emprunt actuels.
Le désir profond de l’ange de devenir homme n’implique en aucun cas une image idéalisée de l’homme. Il s’agit au contraire de l’amour que suscite l’homme dans son difficile exercice d’équilibre entre l’ange et le diable en lui-même. « Il est temps de devenir humain et de comprendre que nous sommes des monstres ». Des monstres dans le sens de Frankenstein : l’homme qui se crée, qui se clone. Le roi du plagiat emprunte d’ailleurs – dans son processus d’humanisation – des parties de la matière grise d’Einstein, de Gertrude Stein, de Wittgenstein et de Frankenstein, les quatre « Stein » auxquels le scientifique John Brockman a consacré un livre dans les années 80.
Ces deux monologues sont particulièrement intéressants parce qu’ils sont conçus comme deux manifestes sur l’art et la position de l’artiste dans le monde : l’empereur de la perte est l’artiste-clown qui ose dire non au système et aspire désespérément à faire mieux ; le roi du plagiat est l’artiste-charlatan, qui défend l’imitation comme un instrument de beauté et de fragilité pour se créer, lui et son art.