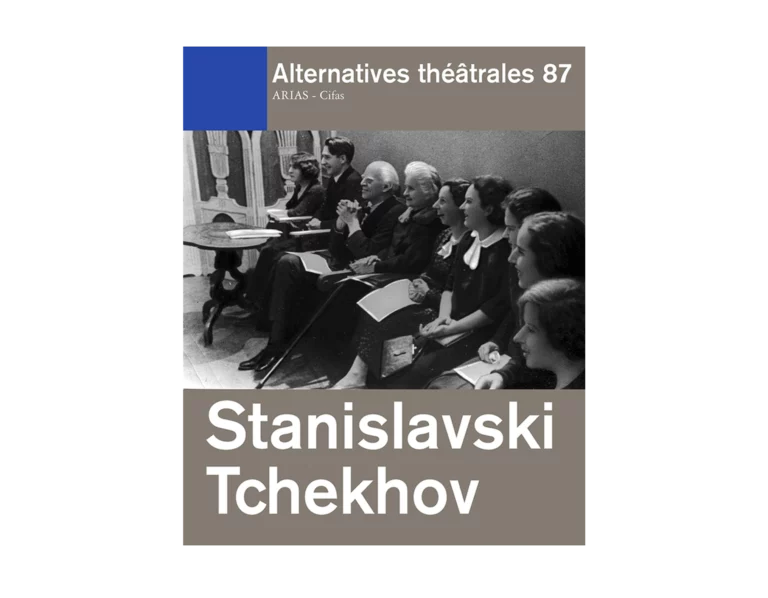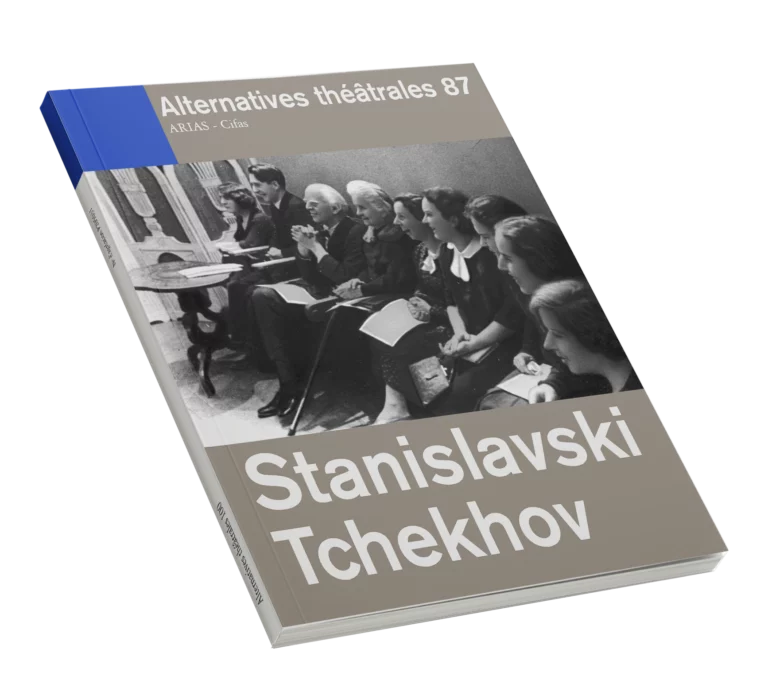MON COLLÈGUE Anatoli Smelianski commençait souvent ses conférences par la phrase : « Stanislavski est un mythe ». Cette boutade contient une grande part de vérité. À la mort de Stanislavski, en 1938, à peine une centaine de personnes en Russie comprenait le Système. La première partie du TRAVAIL DE L’ACTEUR SUR LUI-MÊME parut deux semaines après sa disparition. Quant à la « méthode des actions physiques », Stanislavski n’en parle dans aucun de ses écrits. Les meilleurs témoignages à ce sujet nous viennent de ceux gui ont travaillé avec lui dans le Studio d’opéra dramatique entre 1935 et 1938.
Mon propos est de montrer qu’il y a bien eu continuité entre le travail de ce dernier Studio, en réalité le cinquième créé par Stanislavski, et celui du premier Studio fondé en 1912.
Débuts du « Système », naissance du premier Studio
Les origines du premier Studio remontent à 1905, aux débuts du conflit gui oppose Stanislavski à Nemirovitch-Dantchenko, co-fondateur du Théâtre d’Art (MKhAT). À ce moment-là, Stanislavski, convaincu que le théâtre sombre dans un naturalisme stérile, qu’ il qualifiera plus tard de « poison théâtral », finance une troupe de jeunes comédiens dirigés par Meyerhold que Nemirovitch-Dantchenko détestait. Meyerhold revenait à Moscou après trois années de travail et de recherche en province et débordait d’idées. Il conçoit l’idée d’un théâtre expérimental, un« Studio », terme qu’il invente. Stanislavski l’accueille avec enthousiasme. Nemirovitch, par contre, est outré par les nouvelles méthodes préconisées, notamment l’improvisation. L’idée que l’on puisse improviser sur un texte dramatique est pour lui blasphématoire.
Défenseur d’un théâtre du verbe, il considère la scène comme « la servante de la littérature » et la mise en scène comme l’illustration d’une analyse littéraire préalable minutieuse. Conservateur de tempérament, il croit que le Théâtre d’Art a trouvé la bonne voie : la sienne, qu’il essaie d’imposer depuis le début.
Pour Stanislavski, au contraire, le théâtre devient de plus en plus un art indépendant, synthétisant plusieurs éléments, dont le texte. Contrairement à Nemirovitch, Stanislavski vit dans un état d’insatisfaction permanente. C’est ce gui le rapproche de Meyerhold car malgré leurs différences, tous deux sont des hommes de théâtre et non des littéraires. Si nous étudions les plans de mise en scène de LA MOUETTE, d’ONCLE VANJA, des TROIS SŒURS, de LA CERISAIE, nous n’y trouvons pas la moindre analyse textuelle ou psychologique. Stanislavski indique ou même dicte ce que les comédiens doivent faire, rien de plus.
L’année suivante, 1906, voit la naissance du « Système » dont les origines remontent à 1889 quand, dans son cahier de notes, Stanislavski se demande s’il n’existe pas une « grammaire » du jeu du comédien, une structure, des procédés gui permettraient de représenter la vérité humaine tout en respectant les principales conventions scéniques.
Ces deux éléments perturbateurs, Meyerhold et le « Système », créent entre Stanislavski et Nemirovitch un véritable état de guerre gui culmine en 1907. En témoigne un échange de lettres dont le ton est parfois d’une extrême violence 1. De collègues fidèles, Stanislavski et Nemirovitch-Dantchenko sont devenus des frères ennemis ; ils essaient de résoudre leurs différends mais sans succès. En 1908, Stanislavski démissionne du conseil d’administration et laisse les pleins pouvoirs administratifs à son adversaire. Mais il exige le droit de monter une pièce de son choix chaque saison, selon sa nouvelle méthode, dans une liberté artistique absolue.
Nemirovitch redoute le départ définitif de Stanislavski : celui-ci parti, le théâtre disparaîtrait aussitôt. Aussi joue-t-il double jeu. Il déclare en 1910 que le « Système » deviendra la méthode de travail officielle de la troupe, tout en faisant tout son possible pour le saboter. Notons que la « vieille garde » du MKhAT, les comédiens fondateurs de la troupe, y compris l’épouse de Stanislavski, Lilina, éprouvaient de sérieuses réserves à l’égard du « Système ».
Après les succès remportés, pourquoi tout risquer en se lançant dans l’inconnu ? La terminologie dont Stanislavski se sert en 1908 – 1909, mélange hétéroclite d’expressions tirées de la psychologie (une discipline scientifique nouvelle en ce début de siècle) et du yoga, n’arrange guère les choses. La notion de ce que nous appelons aujourd’hui la communication non-verbale — transmission muette de la pensée — paraissait une aberration. Gogol, pourtant, en avait déjà parlé.
Stanislavski met tous ses espoirs dans les jeunes. Mais il se voit précisément exclu de l’école du MKhAT sous prétexte qu’il « y sème la confusion ». Cette exclusion n’est jamais déclarée ouvertement. On trouve tout simplement des prétextes pour l’empêcher d’y faire cours. Face à une situation qu’il qualifie de « malhonnête », Stanislavski réagit comme il en a l’habitude : en prenant une décision radicale. Le souvenir du Studio de Meyerhold lui revient à l’esprit. Quoique ce Studio ait été un échec, il a manifesté une volonté d’ouverture, de recherche, de création, de renouvellement, de rajeunissement. Stanislavski fonde le premier Studio, en marge de la maison mère dont il s’éloigne de plus en plus afin de se consacrer le plus possible à ses élèves. Parmi eux se trouvent Evgueni Vakhtangov, Richard Boleslavski et Mikhaïl Tchekhov.
Le programme d’entraînement du comédien, tel que nous le connaissons d’après LE TRAVAIL DE L’ACTEUR SUR LUI-MÊME, existe déjà. On voit aussi déjà nettement se dessiner les origines de la « méthode des actions physiques », généralement associée à la période des années 1930. Ce qui est faux : pour des raisons politiques et idéologiques, afin de mettre Stanislavski au Panthéon de l’art soviétique, les autorités ont propagé la notion d’une « rupture » entre un Stanislavski bourgeois, idéaliste et un « nouveau » Stanislavski, matérialiste.
Trois documents cependant nous prouvent que les bases du « Système » et de la « méthode des actions physiques » sont jetées dès 1914 :
- Les notes des huit conférences données par Vakh tangov au premier Studio en 1914 ;
- un article de Mikhaïl Tchekhov paru en 1919 ;
- une monographie de Vladimir Volkenstein publiée en 1922.
Les conférences de Vakhtangov présentent l’essentiel de la formation du comédien telle qu’elle sera exposée par Stanislavski dans la première partie du TRAVAIL DE L’ACTEUR SUR LUI-MÊME :
- décontraction musculaire (svoboda mychts)
- concentration (sosredototchennost)
- vérité, naïveté, justification (vera, naivnost, opravdanie)
- cercle de l’attention (kroug vnimania)
- tâche (zadatcha )