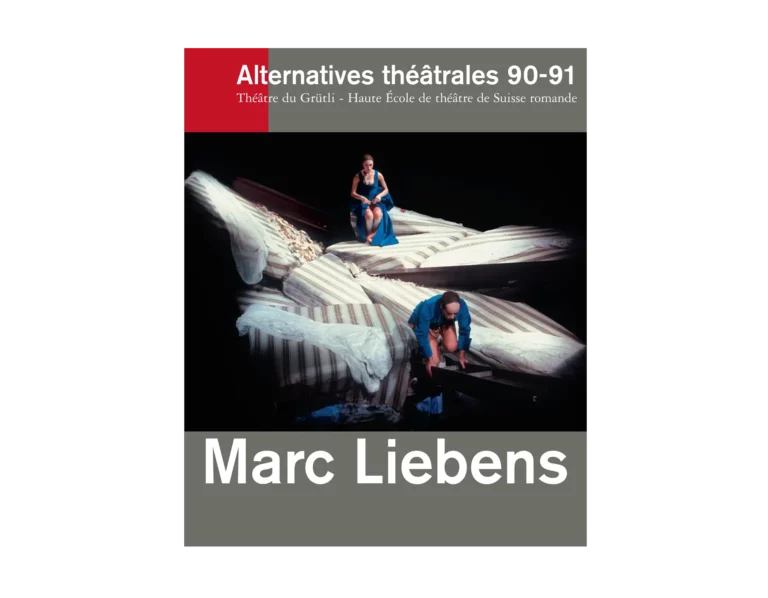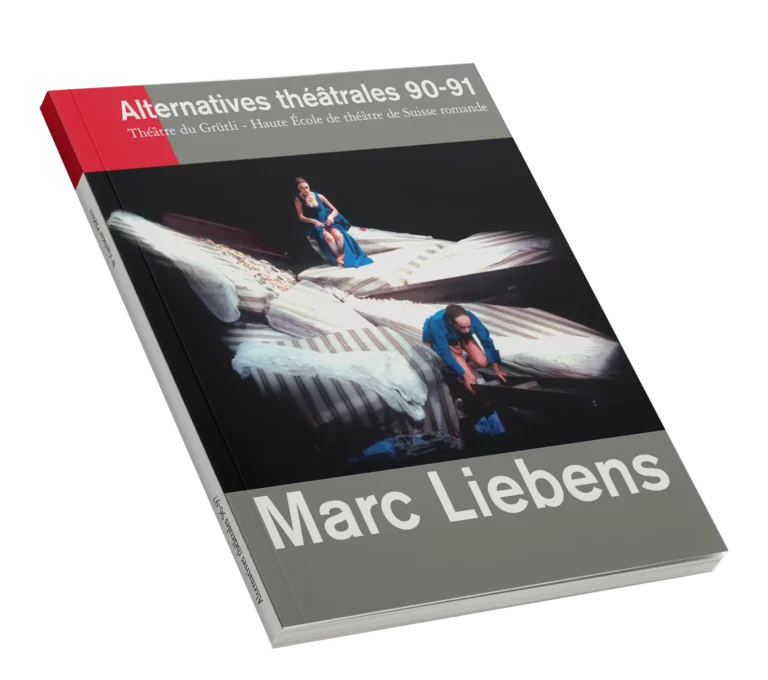Il faut du travail, encore du travail. Il faut une école.
Alexandre Taïrov
L’enseignement de l’acteur n’a jamais changé, il faut lui rendre cette justice. Il est aussi déplorable sous tous les régimes, dans toutes les écoles.
Charles Dullin
Mais l’école, l’école, il nous faut une école.
Jacques Copeau
La récente fondation de la Haute École de théâtre de Suisse romande par les sept cantons de langue française est une décision proprement historique. Cette institution mobilise la volonté politique et les moyens financiers de cantons qui, pour la première fois, se sont unis pour se doter d’un outil de formation à vocation régionale, nationale et internationale.
Sise à Prilly, commune industrielle limitrophe de Lausanne, cette école a pris place dans les locaux d’une ancienne manufacture, d’où son nom. Idéalement située, entre le Jura et le lac Léman, à bonne distance de Genève, ouverte sur la France et la Suisse romande, proche de la Suisse allemande et du Tessin, la Manufacture occupe une position privilégiée géographiquement et spirituellement.
Le canton de Vaud, à l’image de la Suisse romande dans son ensemble, s’est distingué pour avoir vu séjourner plusieurs figures marquantes de la scène artistique et intellectuelle européenne, de Gogol au couple Pitoëff en passant par Dostoïevski, Strindberg, Stravinsky, Chaplin ou Walter Benjamin… Alliant la culture du vin à la splendeur du paysage, cette région offre, sans pourtant que ses habitants en soient toujours conscients, un climat social et intellectuel propice à la réflexion et au travail.
En quatre ans, Yves Beaunesne et son équipe ont su construire de toutes pièces une école active et solide, ouverte à des élèves suisses et étrangers, en cela conforme à la pluralité des origines et des influences constituant cette « province qui n’en est pas une », selon la pertinente expression de Charles-Ferdinand Ramuz.
Des jeunes gens à l’expérience variable et d’âges très différents ont commencé à se diriger vers Lausanne, en provenance de Neuchâtel, Fribourg, Genève, mais aussi de Grenoble, Bruxelles ou Poitiers. Pour les accueillir, des professeurs, tous fortement engagés dans la scène contemporaine, se partagent des tâches fixes propres à la formation de base (Robert Bouvier, Denis Maillefer, Marc Liebens, Philippe Morand, Michèle Millner, Heidi Kipfer, Philippe Saire, Marco Berrettini, notamment), alors que des intervenants multiples sont appelés à assurer le renouvellement régulier des points de vue et des pratiques. Ont enseigné ou vont bientôt s’y atteler : Benno Besson, Claude Régy, Omar Porras, Émilie Valentin, Oskar Gomez Mata, Denis Marleau, Jaco Van Dormael, Isabelle Pousseur, André Steiger, Madeleine Marion, Lilo Baur, Jean-Louis Benoît, Claire Lasne, Pierre Débauché, Cécile Garcia-Fogel, Jean-Yves Ruf, notamment.
Lorsqu’en hiver 2002, Yves Beaunesne m’a proposé de réfléchir à une formule de cours alliant « théorie et pratique » dans la perspective d’un enseignement pragmatique de l’histoire du théâtre, nous sommes vite arrivés à l’idée de « sorties organisées » suivies d’un « retour avec bilan ».
Sortir de l’école / rentrer à l’école, c’est dans ce double mouvement d’ouverture et de repli que nous nous sommes efforcés — avec Sandrine Kuster, qui a accepté de me rejoindre dans cette fragile initiation — de mettre sur pied un cours itinérant, à la manière d’une dramaturgie appliquée. C’est ainsi que chaque nouvelle promotion (A, B et, à présent, C) a été invitée, durant une année, à se rendre au spectacle (théâtre, danse, opéra, performance…) et à s’exercer à l’analyse critique, au-delà des réactions spontanées et bien souvent faiblement argumentées.
Loin de l’école (ou la fièvre du vendredi soir) est à prendre au pied de la lettre. La première année, nous sortions le vendredi soir, et le samedi matin nous reprenions le fil de la discussion engagée la veille, à chaud. Par la suite, ce rendez-vous rituel de fin de semaine a cédé la place à des allées et venues moins systématiques. Mais la fièvre n’est pas retombée… En s’éloignant physiquement de l’école, les élèves se retrouvent, en groupe, non seulement face à des spectacles différents mais aussi dans des villes et des théâtres divers, loin de Lausanne : Monthey, Annecy, Genève, Chambéry, Thonon… Le déplacement physique est aussi mental.
Faire sortir les élèves de l’école pour les conduire au théâtre est un geste minimal, voire un service minimum. C’est à la fois volontariste et peut même sembler aller de soi. C’est précisément ce qui caractérise notre démarche : travailler sur les lieux communs, les réflexes conditionnés, les jugements hâtifs et expéditifs, tentant de dépasser ainsi le sempiternel « j’aime / j’aime pas » pour se forger un regard et une posture structurée. Exercice d’observation et d’attention à ce qui est autre, qui ne correspond pas à ce que l’on croit savoir.
Notre mission consiste à dégager, dans la multitude, les possibilités et le hasard des programmations, les quelques soirées susceptibles de leur faire prendre connaissance de démarches vers lesquelles ils ne se tourneraient pas toujours d’eux-mêmes.
Aller au spectacle ensemble, éprouver séparément, mais dans la proximité des autres, le jeu d’un comédien, le style d’un texte, la dynamique d’une distribution, la scénographie, les lumières, le son, la mise en scène, sont des composantes qui appellent en retour une réception concrète et de préférence partageable.
Sortir pour mieux nourrir, apprécier, comprendre, contester ce que les travaux et les jours de l’école représentent : mettre les enseignements en perspective.