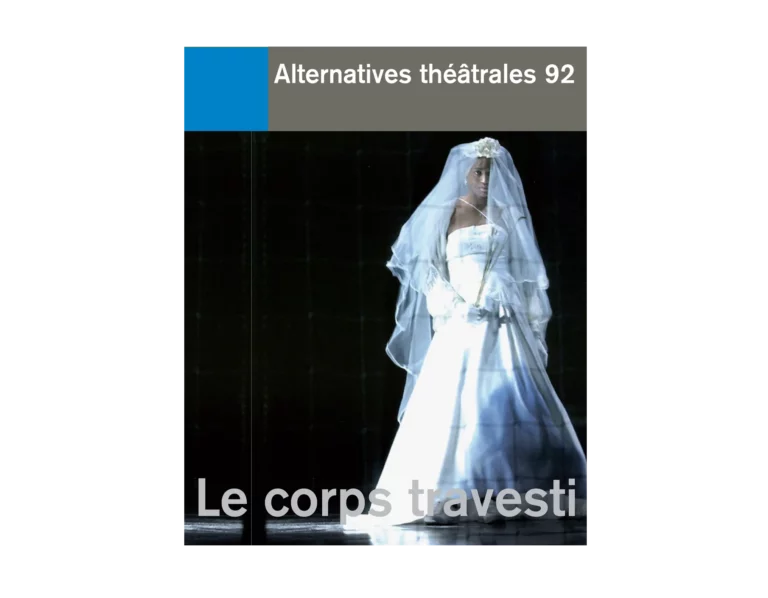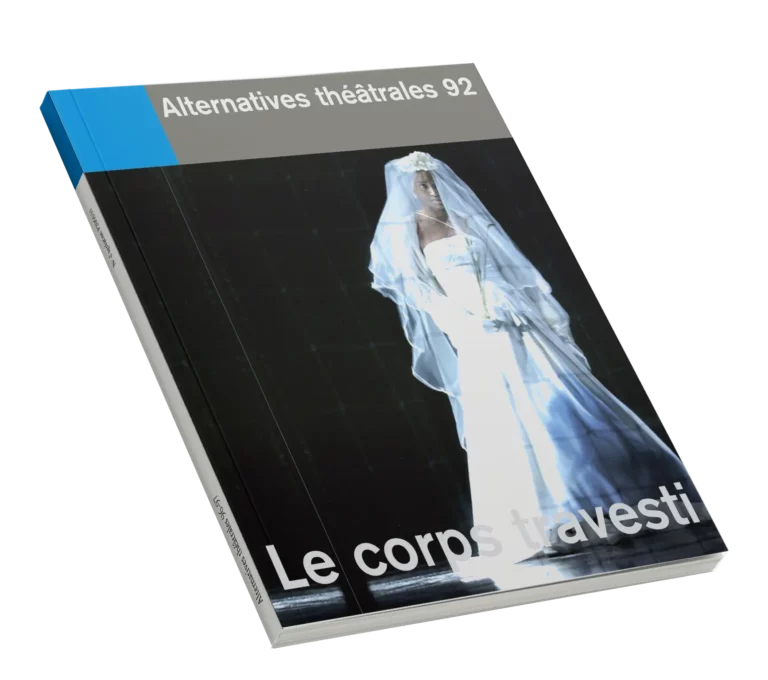LA PLUS ETONNANTE certitude que nous ayons sur notre état, et qui n’est jamais qu’une construction, est que l’humanité soit divisée, naturellement différenciée en hommes et en femmes. C’est pourquoi la perturbation théâtrale s’est intéressée à cette différenciation principielle, pour qu’on en doute, et qu’elle a évidemment pris pour premier instrument de réflexion, le protocole du travestissement que nous avons précédemment décrit.
On ne s’attardera pas ici sur ce qui va de soi : les comédiens élisabéthains, tous mâles, les jeunes garçons jouant les tragédies des collèges jésuites, les jeunes filles de Saint-Cyr figurant la passion racinienne. Certes, il y avait bien convention de travestissement, donc acceptation par le public, mais, en amont, les textes de Shakespeare et de Marlowe, et en aval les réactions du public et la méfiance de Mme de Maintenon, montrent que cette convention n’allait pas sans malaise ni intérêt, ni perturbation. On s’en tiendra ici à deux références venues du XVIIe siècle français, qui peuvent paraître étonnantes et qui, pourtant, révèlent le doute que le théâtre peut figurer en matière d’hésitation sur la nature supposée de la différenciation sexuelle : le premier exemple portera sur le jeu qui consiste à reprendre le travestissement conventionnel des bergers et des bergères de la pastorale pour ne l’appliquer qu’à des hommes, et le second exemple portera sur le travestissement d’une femme habillée en homme et qui, dans l’intrigue elle-même, épouse une femme au point qu’elles consomment le mariage durant la nuit. On le verra, travestissement au sens de l’époque (déguisement) et au sens moderne (changement de sexe) donnera lieu à une mise en scène de l’hésitation sur la valeur et sur la réalité de la division amoureuse entre hommes et femmes.
Qu’est-ce qu’une pastorale à la fin du XVIe siècle et au début du XVIIe siècle ? Une histoire de bergers et de bergères dont l’amour, traversé par des obstacles, finit par triompher grâce à la postulation d’un monde harmonieux possible, ou utopique, qui permet de sortir de l’Histoire terrible des temps présents : un berger A aime une bergère B, qui aime un berger C qui lui-même aimé par une bergère D, jusqu’à ce tout se retourne et s’accorde après tous les obstacles et les péripéties que les fables bocagères se plaisent à représenter. La pastorale est ainsi une sorte de retraite et de refuge, hors de l’histoire, à la fois pour les mélancoliques et pour les amoureux, une manière de proposer une harmonie au monde, de représenter un Âge d’Or idéalement rétabli, malgré le sang répandu au dehors, et malgré l’humeur noire des protagonistes du dedans. Il y a donc, dans ces pastorales, des comédiens et des comédiennes travestis en bergers de convention, qui représentent des garçons et des filles à la recherche du bonheur. Mais que se passe-t-il lorsque les comédiennes-bergères disparaissent, ou plutôt lorsque le texte propose qu’elles soient des hommes ? C’est le cas du BEAU BERGER de Jacques de Fonteny, « pastourelle » écrite, et probablement jouée, en 1587, à l’Hôtel de Bourgogne 1.
Dans le déroulement d’une journée, du lever du soleil à la tombée de la nuit, sur plusieurs lieux peu éloignés et tous pris dans le cadre du bocage, une fable à la linéarité vague réunit des bergers. Deux bergers – paysans-mâles se réveillent, devisent, se racontent des anecdotes, lisent et déclament des poèmes, puis sont attaqués par des satyres. Deux bergers-héros-amants les rejoignent, et l’un des deux part avec eux au combat tandis que l’autre reste seul. La troupe des bergers s’étoffe et les satyres sont sur le point d’être défaits lorsqu’une Ombre pénitente apparaît, évoque avec regret la paix de l’Âge d’Or et demande qu’on arrête les combats. On pourrait s’arrêter là, mais Chrisophile, le berger-héros combattant, raconte qu’il a reçu d’une main sanglante une énigme qu’il faut maintenant déchiffrer . Pour ce faire, les bergers vont voir un étonnant sorcier qui affirme qu’il en donnera la solution le lendemain. Enfin, malgré la frustration de Chrisophile, la troupe rentre célébrer la victoire, le berger ‑héros combattant retrouve son amant Chrisalde – le berger — héros non-combattant -, et la pièce se termine. Les deux bergers — héros, unis le matin, séparés le midi par les actions (la bataille, la quête du sens de l’énigme), se retrouvent le soir, et c’est donc dans l’attente de la résolution des énigmes que nous quittons les beaux bergers, sur une scène finale de baiser d’homme à homme, juste avant la nuit qui va les unir et, peut-être, porter conseil.
L’ensemble de la pièce représente une affaire d’hommes : aucun rôle féminin ne s’insère dans cette fable sylvestre, contrairement aux modèles italiens et au début de tradition française, contrairement aux habitudes de travestissement en bergers et bergères. Car cette fois, le travestissement pastoral ne s’applique qu’à des hommes, ce qui ne peut que surprendre. Aucun berger n’aimera donc sa bergère et conséquemment, comme il est forcément question d’amour, il faudra bien que les bergers s’aiment entre eux.