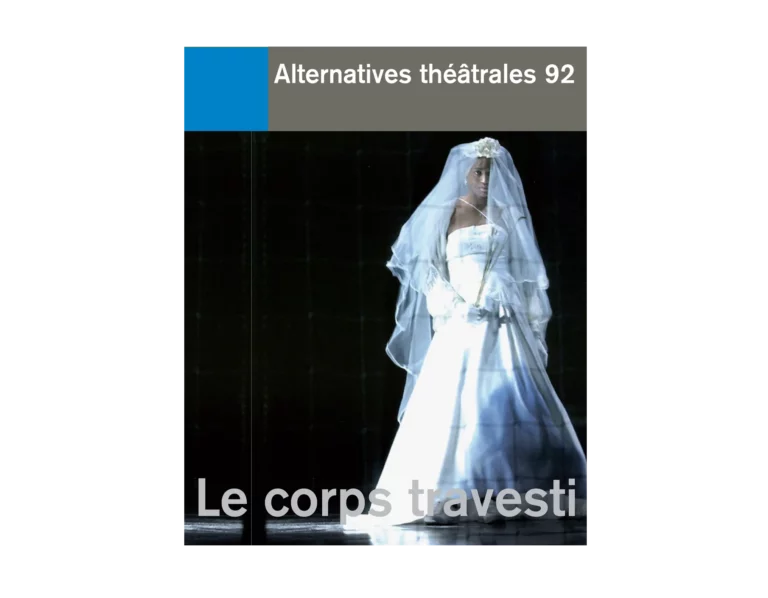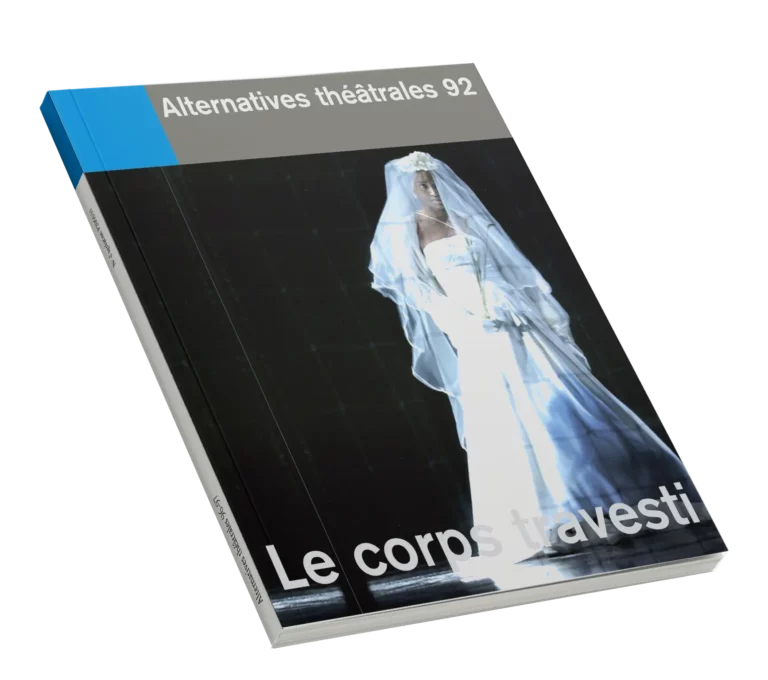LE TRAVESTISSEMENT est probablement l’une des clés les plus fécondes pour saisir ce qui se passe sur un plateau de théâtre. Dans la figure du corps travesti, se noue de manière grossie et concentrée tout ce qui a lieu dans le jeu d’un acteur. Le travestissement peut même se lire comme une leçon d’art dramatique accélérée. C’est d’ailleurs à la lettre ce qui se donne à voir dans cette scène des ILLUSIONS COMIQUES, déjà anthologique, où l’acteur fétiche d’Olivier Py, Michel Fau, incarne le rôle de « Tante Geneviève » qui vient prendre son cours de théâtre… avec l’acteur Michel Fau. Ce dernier se fait remplacer par Monsieur Girard, qui lui donne une phrase de tragédie (« Même les dieux ne peuvent défaire ce qui a été »), qu’elle doit interpréter d’une vingtaine de manières, à chaque fois lancée par une didascalie, dite par Monsieur Girard : « absente à elle même, boudeuse, soudain lyrique, cherchant sa casquette, avec une fausse désinvolture, avec une ironie méchante, définitive, avec un fol espoir, pour cacher qu’elle a fait un petit pet, séductrice, en regardant s’il y a des critiques dans la salle, l’air de rien tout en continuant de jouer la situation, comme si c’était un oubli, consciente que ça n’est pas drôle, avec une sincérité qui ne peut être feinte, retenant sa colère, ne retenant pas sa colère, à bout, parodiant les tragédiennes, pleine de sous-entendus, signifiant qu’il n’y a pas de quoi en faire un drame, comme si c’était le titre d’un recueil cochon, en regrettant d’avoir pris du lapin à la moutarde à midi à la cantine, jouant faux, jouant juste, avec une amertume déguisée sous une folle superficialité, n’y comprenant rien, ésotérique, fantastique, élastique, philosophe, sentencieuse, licencieuse, vicieuse, avec un soupçon d’agacement, à l’enterrement de la voisine, sortie de ses gonds, furieuse, hébétée, manifestant qu’elle l’a déjà dit cent fois. (Monsieur Girard l’applaudit.)»1
Et on applaudit Tante Geneviève/Michel Fau avec lui, tant l’exercice est vertigineusement réussi. Car derrière le travestissement de l’acteur en femme, c’est l’essence de l’acteur qui apparaît dans cette scène. Et c’est au fond cela qu’Olivier Py ne cesse de vouloir faire apparaître en jouant du travestissement dans son théâtre : montrer l’acteur dans le plein exercice de son art d’acteur. Or cette exposition de l’acteur, selon Py, passe par l’exposition de l’acteur à son propre féminin – son devenir femme, que Valère Novarina nommait pour sa part « invagination de l’acteur ». Dans les deux cas, l’acteur se révèle quand il passe à l’autre sexe. Mais la question du sexe n’est pas centrale, elle est juste un moyen pour faire apparaître une connaissance de l’humain. La quête d’Olivier Py est donc essentiellement métaphysique : sa quête du travestissement n’est pas un engagement politique, mais plutôt la recherche d’un savoir sur l’humanité. Le masque est là pour faire voir nos vérités. Même si, bien sûr, la difficulté de notre société à regarder ces masques révèle un nœud politique, qu’il nous faudra bien trancher. Beaucoup de nos contemporains n’aiment pas qu’on leur montre qu’ils ne sont pas qu’un seul, mais masques multiples, et fols absolus. Et c’est pourtant cela que peut le théâtre, jusqu’au vertige, quand il se donne à nous, sous toutes ses formes. Chez Olivier Py, la manière de prendre le travestissement n’est pas essentiellement revendicative. Il ne s’agit pas de faire apparaître des figures basses dans le monde noble du théâtre – il s’agit au contraire de montrer que le théâtre a toujours été façonné par le monde trouble de ceux qui deviennent un autre. Le corps travesti est donc une encyclopédie instantanée de notre essence mimétique. Un viatique pour notre humanité partagée ?
Bruno Tackels : En ce nouveau siècle, on peut dire que vous êtes le premier poète dramatique à avoir redonné au travestissement une place centrale dans l’espace du théâtre. Vous avez au fond déplacé cette figure populaire, qui provient du cabaret, en lui octroyant dans votre théâtre une place décisive et sérieuse. Mais du même coup vous avez réussi à rendre populaire une certaine forme de lyrisme au théâtre. Comment en êtes-vous venu à explorer le corps du travestissement ?
Olivier Py : La chose essentielle qui m’a amené à la question du travestissement, c’est de découvrir que le travestissement est le seul endroit où l’on se permet encore le masque. Ce n’est pas d’abord une question de genres. C’est un endroit où l’on a droit au masque. C’est pour cela qu’il est précieux aujourd’hui, non parce qu’il ferait la révolution sexuelle dans son corps, mais parce qu’il apporte du carnaval. Alors que le carnaval s’est trouvé totalement dévalué, par contre, on a vu monter en puissance le phénomène des Gay Pride. La Gay Pride nous intéresse, parce qu’elle ramène du masque. C’est la grande trouvaille de Jean Genet quand il dit : « Divine ne voulait pas être femme, elle voulait être fausse. »
B. T.: Qu’est-ce que vous entendez par masque ?
O. P.: Le masque met en scène un simulacre qui permet d’accéder à la vérité. Sans masque, il n’y a pas d’accès à la vérité. En l’absence du masque, il n’y a que la norme érigée en masque suprême.
B. T.: Et ce masque produit donc toutes sortes de théâtres. On a le sentiment que sur votre plateau, le travestissement permet d’embrasser toutes les formes de théâtre, de la satire à la tragédie.
O. P.: Absolument. J’envisage le travestissement comme un acte strictement théâtral, et pas du tout comme une revendication de la révolution sexuelle. Je redoute toujours de voir cet aspect de mon travail érigé en emblème d’une quelconque lutte politique. La question sexuelle ne m’intéresse pas, il n’y a que la mort qui m’intéresse. Dans le cas de Michel Fau, on se trouve devant un cas assez unique. On a affaire à l’un des plus grands acteurs de sa génération, qui s’est illustré principalement dans des rôles de dame. C’est totalement absent du théâtre moderne, il faut remonter à l’époque baroque ou aller vers le théâtre extrême-oriental pour trouver des équivalents. Ce que j’ai fini par comprendre dans le jeu de Michel Fau, c’est qu’il nous amène, par son propre masque, à démasquer tous les autres masques sociaux. Par son travestissement, il montre que nous vivons dans une société entièrement masquée, et qui l’ignore – comme dans le DON JUAN de Montherlant, qui finit avec un masque qui lui colle à la peau. Mais ce n’est pas une affaire de genres. Dans LES VAINQUEURS, le personnage principal devient femme, mais ce n’est pas une affaire sexuelle : il passe d’un masque à un autre, et non d’un genre à un autre.

Quand Michel Fau sur scène adopte un code de jeu baroque, éventuellement le public rit parce qu’il est surpris de voir arriver une convention dont il n’a pas l’habitude, non pas qu’elle lui serait étrangère, c’est parce qu’il la reconnaît comme une connaissance de l’humain qu’on lui a interdite, qu’il a perdue, et qu’il retrouve par l’éclat de rire. Par l’éclat de rire, il dit : « Ah, mais oui, c’est vrai, c’est ça l’homme : la télévision m’avait fait oublier que c’était ça, la vérité. » Il rit parce qu’il est démasqué, et se retrouve en empathie avec cet état de folie. Et ce qui est incroyable, c’est que quand tu joues, Michel, le masque normatif, le masque naturel, le masque du sans masque, le public rit aussi. Ce qui montre bien qu’il est moins bête que ne le croient les médiateurs culturels ou les professeurs d’art dramatique. En voyant le jeu qu’on joue à la télévision, le jeu de la télévision qui mime prétendument la vie, les spectateurs, eux, savent que c’est un jeu, qui peut être démasqué comme une autre convention. Ils le savent, puisqu’ils rient quand Michel parodie le jeu naturel.
Michel Fau : Effectivement, aussi étrange que cela puisse paraître, ce qui fait le plus rire, c’est quand je parodie le jeu naturaliste. C’est assez vertigineux. Ils reconnaissent le code de jeu, et ils rient parce qu’ils savent que c’est un code de jeu.
O. P.: Et alors là, on peut dire qu’ils regardent la télévision ! Ils regardent la télévision pour ce qu’elle est. Par le théâtre. Contrairement au phénomène qui consiste à mettre une vidéo sur le plateau, soi-disant pour faire un discours critique sur la télévision et les grands médias. Cela ne marche pas, c’est l’eau et l’huile. Et forcément, les gens regardent la télévision. Cela ne produit aucun discours critique sur la télévision, puisque le problème n’est pas du tout un problème de contenu, mais de média.
B. T. : Ce que vous dites du masque rejoint les thèses de Judith Butler, quand elle écrit que le genre n’est pas le sexe, et qu’il est une pure construction sociale. Pendant des décennies de lutte de la gauche pour la libération sexuelle des corps, on a pensé que tout cela était fondé sur un clivage des genres. Et elle montre qu’on s’est complètement trompé, parce qu’en voulant libérer les corps et la sexualité, on a maintenu en l’état une domination d’un genre par un autre, alors que cette distinction des genres est une construction. Quand Michel Fau se travestit sur le plateau, passant par ses différents masques, selon votre formule, il y a bien une mise à l’épreuve des genres – qui montre magistralement qu’ils ne sont pas figés, ni hiérarchisés.
O. P.: Il se les réapproprie, et du coup, il n’en est plus esclave.
M. F.: C’est sans doute pour cette raison que ce travestissement n’est pas très courant en ce moment sur les plateaux.
O. P.: Mais c’est interdit partout ! Même à l’opéra, le costume est interdit. Au théâtre, le costume est interdit, le maquillage est interdit. Ce qu’il faut endosser, c’est le costume du quotidien. Personne n’ose travailler avec le costume d’époque, parce que c’est un travestissement, et qu’il amène du théâtre.
B. T.: Cela me fait penser à cette anecdote de Talma, qui arrive sur scène sans sa perruque. Le public s’esclaffe, Talma s’avance au bord du plateau en lançant : « Vous n’avez pas tout vu », et il relève son costume, en montrant qu’il est nu en dessous.
O. P.: Cela veut dire que Talma faisait croire au naturel. Son jeu était naturel, il était en fait révolutionnaire, son jeu était de gauche ! Il voulait donc démasquer le pouvoir. En France, le pouvoir se fonde toujours sur du théâtre.
B. T.: Ce qui est intéressant dans son geste, c’est qu’il montre que le masque n’est pas là où l’on croit. Le travestissement n’est pas là où l’on croit, il se redouble dans un jeu qu’on ne soupçonnait pas.
O. P.: Ce qui me trouble depuis des années, c’est que Lacan dit deux fois « ça n’existe pas ». Il dit : « la femme n’existe pas », et « l’acte sexuel n’existe pas ». Pourquoi n’a‑t-on pas médité ces propositions plus avant ? Ce qui importe ce n’est pas le sexe, mais la libido. Bien sûr que tout le monde a le droit de faire ce qu’il veut avec son corps. La seule chose qui importe, c’est de savoir si le théâtre que nous faisons crée du désir – pas du sexe. Quand j’ai opposé naïvement, ou trop rapidement (j’étais chronologiquement le premier à écrire une tribune sur cette prétendue « querelle du Festival 2005 », dans le TGV, alors que le Festival n’était pas fini) un théâtre du texte à un théâtre de l’image, c’était un peu rapide. Ce qui se joue en fait, c’est l’opposition de la pulsion à la métaphore. L’inquiétant, c’est qu’on voit se développer un théâtre qui ne veut plus de métaphores, qui veut du réel, en refusant donc toute libido, pour privilégier le seul pulsionnel. Ce théâtre nous fait croire que notre désir est objectif, puisqu’il postule un objet réel, en face de lui. C’est un théâtre qui nous empêche de savoir que nous sommes un tissu de songes. Au fond, il renoue avec la croyance bourgeoise, mais par un mode qu’on ne pouvait pas imaginer : le mode de la subversion ! C’est une opération assez incroyable. Une voiture qui tombe en vrai sur un plateau depuis les cintres2, c’est le contraire de la métaphore. Un corps qui souffre, qui a froid, nu, recouvert de vrai sang3, c’est le contraire de la métaphore, c’est nous faire croire que nous sommes autre chose que des songes.
B. T.: Et le travestissement, ce serait alors une ré- appropriation de la métaphore ?
O. P.: Parmi d’autres. L’important, ce n’est pas de se réapproprier la liberté des corps, comme dans le théâtre de Copi. L’important, c’est de se réapproprier le théâtre.
B. T.: Le travestissement n’est donc pas une affaire de corps féminins, mais l’enjeu serait plutôt dans une éthique de la transmission. Dans LES ILLUSIONS COMIQUES, Michel Fau, l’acteur, qui enseigne à « Tante Geneviève » (rôle joué par Michel Fau lui-même) un art du théâtre qu’il tient de sa mère, qui le tient de sa grand-mère, qui elle-même le tient de Michèle Morgan.
O. P.: Actrice naturelle, s’il en est.
M. F.: Ce qui est extraordinaire, c’est qu’on m’a proposé des rôles de femmes, parce qu’on m’a vu jouer des rôles de femmes dans les spectacles d’Olivier Py. Mais s’il n’avait pas eu, lui, cette idée, personne n’y aurait pensé. Parce que je n’ai pas l’air spécialement féminin. Je joue maintenant un rôle de travesti pour la télévision, et quand je suis arrivé sur le tournage, la production s’est étonnée, en se demandant ce que je pouvais avoir de féminin. Cela me fait comprendre qu’Olivier m’a proposé ces rôles en sachant que cela produirait du théâtre, et pas d’abord du féminin. Je rêverais de jouer un jeune homme, ou un petit garçon, mais personne ne me propose. Sauf s’il venait quelqu’un d’assez fou, comme Olivier, pour me dire : « Je t’imagine dans un rôle de petit garçon ou de jeune homme, et je vais t’écrire ce rôle. »
O. P.: Ce serait passionnant, mais cela suppose que tu montres la convention du jeune premier : comment le jeune premier se déguise en jeune premier, comment il rentre dans la folie qui consiste à croire qu’il est un jeune premier. Le masque qui colle à la peau.
M. F.: Quand j’ai joué Madame Irma dans LE BALCON de Jean Genet, un vieux Monsieur m’a dit : « on ne se pose pas du tout la question de savoir pourquoi vous jouez Madame Irma, c’est comme quand on allait voir Sarah Bernhardt, jamais ne se posait la question de savoir pourquoi elle jouait Hamlet. Et à soixante ans, elle a joué l’Aiglon, qui est le rôle d’un jeune homme maladif, sans que cela ne pose aucun problème théâtral. Moi aussi, j’aimerais jouer le rôle de ce jeune homme maladif. »