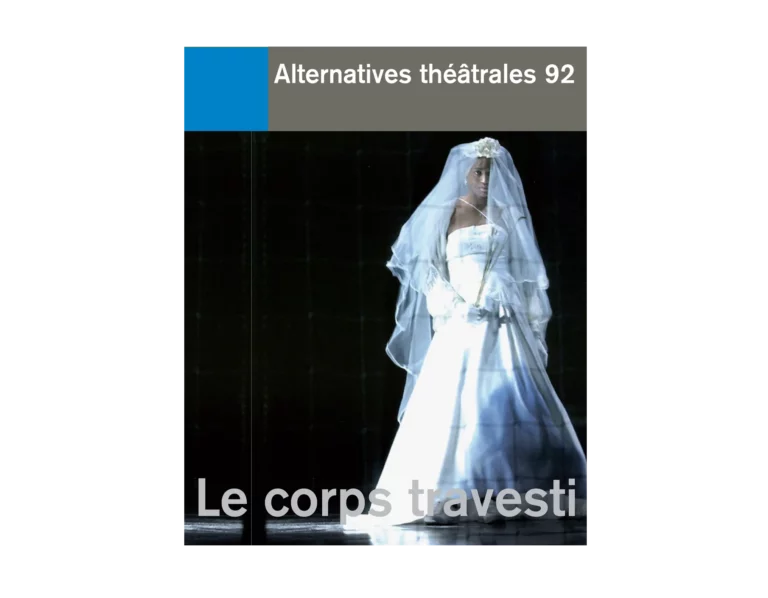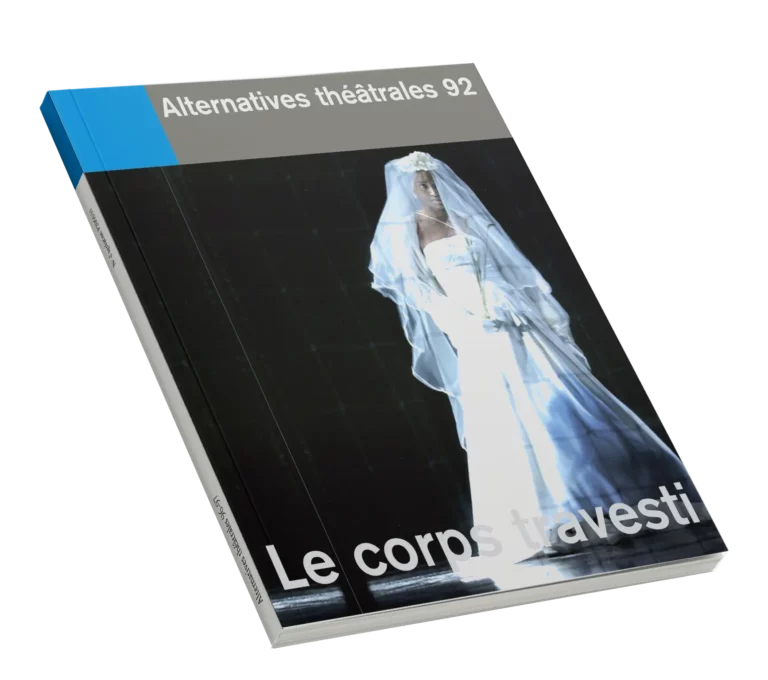À L’HEURE du « tous en jean », quel sens revêt le mot déguisement : à l’ère de l’homme unidimensionnel, comment s’habiller à sa guise ? L’art du costume, à la scène, s’ajuste à l’évolution des codes vestimentaires, à la ville. On entend régulièrement parler d’uniforme et d’uniformisation, de loi des genres et/ou d’indifférenciation sexuelle. Le journal Libération, qui consacrait récemment un dossier à la moustache1, en constatait le retour en grâce depuis environ six mais. Selon le psychanalyste Serge Hefez, cette tendance traduirait pour les hommes le besoin de ré-exprimer leur virilité, une façon de re-sexualiser les relations entre hommes et femmes : « Après-guerre, les femmes ont appris avec Simone de Beauvoir qu’on ne naissait pas femme, qu’on le devenait. Aujourd’hui, les hommes apprennent qu’ils ne naissent pas hommes mais le deviennent. »
Sur la piste d’Huppert, nous réfléchirons au travestissement féminin ; et au fil d’ORLANDO, de QUARTETT et de LA FAUSSE SUIVANTE, au devenir homme de la femme au théâtre.
Un déplacement par le vêtement
D’abord deux mots à propos du personnage d’Orlando2 interprété par Isabelle Huppert. Le personnage haut en couleurs que Virginia Woolf fit naître en 1500, est un fort bel et jeune noble élisabéthain, qui traverse les siècles et les sexes, au cours d’un spirituel voyage littéraire, et au gré de la passion de l’écrivaine pour Vita — la femme aimée de Woolf, la vraie femme3 qu’elle ne pensait pas être. Sous la baguette de Wilson, Isabelle Huppert traverse aussi les époques, les catégories sociales et identitaires. Dans LA FAUSSE SUIVANTE4, une jeune femme se déguise en chevalier pour vérifier ce que son futur mari vaut. Trompé par l’habit, le fourbe Lélio dévoile avec forfanterie toute son ignominie. Comme souvent dans le théâtre de Marivaux, le travestissement sert à déguiser le sexe autant que la condition sociale. Isabelle Huppert interprète la Comtesse doublement dupée par Lélio et par le chevalier (en l’occurrence une Sandrine Kiberlain très attirante sous son déguisement de courtisan), chargé de la séduire. Enfin dans QUARTETT 5, librement inspiré des LIAISONS DANGEREUSES de Choderlos de Laclos, il est question des rapports entre les sexes tels qu’Heiner Müller les envisage, avec son lot de jeux de séduction, de massacre et de libertinage. La Merteuil et Valmont tantôt inversent leur rôle, tantôt endossent ceux d’autres personnages. Selon Isabelle Huppert, « dans un effet de glissement, il s’invente un théâtre imaginaire entre Merteuil et Valmont. On est dans le cru jusqu’à la blessure… Une gigantesque mascarade, affublée de tous les oripeaux de la séduction, donc du mensonge et de la folie. » 6
À quoi servent vraiment ces modifications d’apparence ? Qu’ils se traduisent par un changement complet de costumes et d’attitudes, ou bien qu’ils se résument à l’utilisation d’un simple accessoire, ils en disent long sur les variations 7 intérieures ? « Souvent femme varie, bien fol qui s’y fie. » En dépit de sa misogynie, le proverbe est intéressant. « Sur la piste d’Huppert », — en référence à Lacan, ça s’entend -, à travers les trois rôles suscités mais pas seulement, nous observerons les moyens de la métamorphose de la Dame : déguisement sur scène, jeux des apparences et loi de l’apparat, selon Robert Wilson ; et croiserons nécessairement les questions soulevées par le jeu des identités et la loi des genres 8.
Le devenir homme de la femme au théâtre n’est pas une question d’actualité. L’histoire du travestissement au masculin comme au féminin est ancienne. Dans le DICTIONNAIRE CULTUREL EN LANGUE FRANAISE 9, le mot « travesti » se décline en deux points : l’un concerne l’homme habillé en femme de manière ostensible, qui manifeste les caractères sociaux de la féminité (maquillage, etc.), et présente des caractères sexuels secondaires féminins (naturels ou provoqués). Sont rappelés pour exemple les travestis de boîte de nuit et il est fait référence aux drag queens ; l’autre concerne les acteurs ou actrices travestis, qui sont revêtus de l’habit de l’autre sexe, d’une autre condition, d’un autre âge, c’est-à-dire costumés, déguisés. Travestir, c’est donc se transformer en revêtant d’un aspect mensonger… La notion oscille entre costumer (pour un bal, une fête, un spectacle), et falsifier (les faits, la vérité). Le terme « travestissement », qui vient du latin trans et vetire, c’est-à-dire par-delà et vêtir, renvoie à trois notions apparemment contradictoires mais qu’il convient de maintenir serrées : l’idée du beau, l’approche psychiatrique et l’idée de déformation, de parodie, à caractère scandaleux 10. À propos des acteurs et actrices, LE DICTIONNAIRE ENCYCLOPEDIQUE DU THEATRE 11 est plus précis. On n’y trouve pas le terme « travestissement », qui renvoie à l’occurrence du « déguisement ». Selon Georges Forestier 12, il s’agit du changement d’identité d’un personnage (étymologiquement, sortir de sa « guise »), c’est-à-dire de sa manière d’être, qui peut s’accompagner d’un changement de costume et/ou d’un masque et, par-delà, d’un changement de sexe ou de condition sociale. Qu’il s’agisse de dédoublement, d’usurpation… avec ou sans intervention magique, l’idée est d’imiter pour changer et tromper.
De ce parcours rapide à travers les définitions, on retiendra que l’acteur et l’actrice se déguisent pour opérer un déplacement – en soi et dans le spectateur –, un déplacement par le vêtement, une variation, pour susciter du rire, de l’étonnement, du plaisir, du désir, du scandaleux. Le déplacement par le vêtement s’effectue à des degrés divers. Pour prendre des exemples chatoyants, drag queens et drag kings 13 se vêtent et se maquillent de façon délibérément ostentatoire.
Or, il est des façons de suggérer le changement d’identité de manière très stylisée, par un simple accessoire. Et quand bien même Judith Butler a raison d’affirmer que l’identité de genre n’est pas une construction que l’on se met comme on s’habille le matin, qu’il n’y a pas d’armoire à identité sexuelle où l’on choisit délibérément de quel sexe on sera ce jour-là, qu’il ne faut pas réduire le genre à l’habillement…, on va ici s’intéresser aux codes vestimentaires sur scène. Jouer avec l’idée selon laquelle l’habit fait le moine le temps d’une représentation. On va parler chiffons : de ceux que portent les femmes pour jouer (à) l’homme au théâtre. On va s’amuser avec Orlando à penser : « Les vêtements peuvent sembler de vaines bagatelles mais, disent certains philosophes, leur fonction la plus importante n’est pas de nous tenir chaud. Ils changent notre vision du monde et la vision que le monde a de nous. » 14 S’amuser à croire, avec lui, avec elle… qu’ils nous portent, et non l’inverse, « qu’ils forment notre cœur, notre intelligence et notre vocabulaire à leur guise. » 15
Le vocabulaire de la femme celée
Le vocabulaire de la transformation, « à la guise » des hommes, est généralement visible et lisible. L’«appareillage » du féminin voisine avec le burlesque : une robe, une perruque, des bijoux, du maquillage. De l’ordre de l’exhibition. À l’inverse, pour paraître au masculin, la femme doit celer, retrancher ce qui fait ordinairement les atouts de sa féminité : couvrir ses cheveux, bander sa poitrine, cacher son sexe « faible », généralement en portant la culotte. Ainsi Orlando, qui connaît les avantages dus au port de la jupe vaporeuse, ne déteste pas sauter dans un pantalon pour aller s’encanailler. Il paraît que le mot pantalon vient du personnage de la commedia dell’arte, Pantalone. Sur scène, la femme en pantalon avance masquée pour tenter de faire éclater la vérité. Dans le roman de Woolf, Orlando se sent surtout plus à son aise pour aller jouer de l’épée dans les bas-fonds londoniens16. Dans l’ORLANDO de Wilson, Isabelle Huppert porte des pantalons turcs, larges, précieux, pas spécialement masculins, qui siéraient aux deux sexes. « En voyant Isabelle dans ORLANDO au début, on songe plutôt à un jeune acteur élisabéthain. Et cependant cette piste ne suffit pas. Parce qu’on la sait femme et qu’on ne peut l’oublier, et qu’il n’est pas d’androgynat qui ne le cède à la féminité », suggère à juste titre François Regnault dans ses TROIS VUES SUR LE MONT HUPPERT. 17
Homme, femme, neutre ? Dans le roman de Woolf, l’ambivalence est de mise. Et sur la scène de Robert Wilson aussi. La différenciation sexuelle s’opère par le truchement du vêtement : Orlando-Huppert porte alternativement les habits des deux sexes, qui n’ont de constants que leur matière sublime. Perfection de l’étoffe, symbolique des couleurs, magnificence des tenues. À l’intérieur de tout un appareil scénique caractérisé par une sorte d’élégance sophistiquée, on ne plaisante pas avec les déguisements.
Pour jouer au duel amoureux dans QUARTETT, Isabelle Huppert porte également un costume somptueux. Une longue robe bleu dur, à la ligne parfaite et à la traîne longue et pesante. Pour le haut du corps, un bustier ajusté, une manche longue d’un côté, et de l’autre une épaule dénudée. Le tout donne une impression de majesté. Sur cette scène épurée, Isabelle Huppert ainsi qu’Ariel Garcia Valdès d’ailleurs, apparaissent comme des figures découpées. Valmont Valdès en costume rouge diable porte parfois des talons aiguilles. La Merteuil quant à elle n’utilise aucun des codes vestimentaires attribué au masculin. Le déplacement vers l’autre sexe s’opère par un simple détail, la chaussure de Valdès et la « grosse voix » d’Huppert. Par un procédé d’amplification, sa voix tire vers les basses. On dirait qu’elle gronde ou miaule comme un animal mâle 18.
Chez Mattias Langhoff qui a aussi mis en scène QUARTETT à l’automne 2006, la Merteuil et Valmont, interprétés respectivement par Muriel Mayette et François Chattot, changent et même échangent leurs vêtements. Sur la scène de Robert Wilson, inutile de tourner sa veste. Sur l’échelle du travestissement, la déformation vocale est la plus minimaliste (la plus proche du neutre, et donc de l’androgyne, selon Roland Barthes), à mille lieux du port ultra-voyant de la moustache. Je pense ici à la fine moustache et au petit bouc dessiné par Marcel Duchamp sur une reproduction de LA JOCONDE de Léonard Vinci à Paris, en 1919, et sous-titré « LHOOQ », qui forment, prononcées l’une après l’autre, une plaisanterie très osée sur LA JOCONDE. Pascal Le Brun-Cordier, dans LA JOCONDE JUSQU’A CENT, article très intéressant qu’il consacre à la provocation dadaïste, s’interroge sur la Mona Lisa moustachue : femme travestie en homme, ainsi que l’indiquerait sa pilosité faciale, ou homme travesti en femme, comme pourraient le suggérer ses vêtements…
Dans l’univers wilsonien, Isabelle Huppert se contente dans ORLANDO de changer de coiffure : cheveux plus courts et plaqués en arrière, à la mode garçonne, ou bien coiffure plus travaillée accompagnée de quelques mèches bouclées. La chevelure est révélatrice de l’appartenance sexuelle. C’est également frappant dans LA FAUSSE SUIVANTE. Rappelons qu’étonnamment, pendant un long moment, Lélio et la comtesse ne reconnaissent pas la femme qui habite le chevalier Kiberlain. Isabelle Huppert interprète une émouvante comtesse qui succombe aux charmes troubles de celle qu’elle croit être un homme. Sous l’œil de la caméra de Benoît Jacquot, ce n’est que quand Sandrine Kiberlain retire son couvre-chef et dévoile sa longue chevelure blonde que le masque du masculin tombe définitivement.
Un déguisement, juste pour faire beau ?
Qu’il s’agisse d’ORLANDO, de la FAUSSE SUIVANTE ou de la plupart des personnages de travestis féminins, on constate qu’elles ne s’habillent pas a priori en homme pour être beaux. C’est plutôt parce qu’elles sont animées d’un désir de justice que les femmes prennent l’habit masculin. Parce que dans leur peau de vierge, de mère ou d’épouse, elles savent bien que leur voix ne sera ni entendue ni crédible. Cette idée selon laquelle les femmes seraient intrinsèquement dénuées du sens de la justice a couru (court?), hélas, depuis fort longtemps. Le psychanalyste Jean-François de Sauverzac 19 rappelle quelques propos édifiants. Selon Kant dans ses OBSERVATIONS SUR LE SENTIMENT DU BEAU ET DU SUBLIME, « Les femmes évitent le mal, non parce que le mal est injuste, mais parce qu’il est laid»… Selon Freud, qui reprend le verdict kantien : « Le fait qu’il faille reconnaître à la femme peu de sens de la justice est sans doute lié à la prédominance de l’envie dans sa vie psychique. » Et Dolto d’avaliser la sentence en évoquant la quasi-absence de sur-moi chez la femme… Kant explicite : « S’il se trouve une femme qui agit moralement, c’est par accident et non par volonté », ou bien encore : « J’ai peine à croire que le beau sexe soit fait pour les principes. » J.-F. de Sauverzac en conclut que ce faisant, « Kant enferme les femmes dans le prédicat qui leur conviendrait par nature et les assigne à ne pouvoir en sortir : la beauté. »
Au regard de ce clivage entre hommes et femmes, on peut formuler l’hypothèse que le travestissement féminin a une finalité essentielle : offrir sur un plateau, le temps d’une représentation, un espace de parole « au masculin ». Les personnages de femmes déguisées en homme semblent d’abord être portés par un honorable désir de justice et d’expression. Ce qui ne les empêche pas d’être désirables dans leurs tenues de garçon. Le costume d’homme est source de libération – comme si on pensait mieux en pantalon –, autant qu’il attise la curiosité : « Mais êtes-vous sûre de ne pas être une femme ? », demande avec délice Orlando à l’homme aimé ? De la scène de « masque » dans ORLANDO à ENTRE LES ACTES, on sait bien que Virginia Woolf aime le théâtre de Shakespeare, notamment les déguisements et l’illusion. Il paraît qu’à l’époque victorienne, on demandait à des actrices travesties de jouer des rôles de jeunes premiers en bas résille. Considérées comme dangereusement érotiques, elles n’eurent plus le droit d’interpréter des rôles masculins, à part dans le théâtre shakespearien. Leur inquiétante beauté dérangeait la morale. Il en est de même pour les premières actrices du kabuki qui furent finalement entièrement remplacées par des hommes.

Le déguisement sur scène ne serait donc pas juste beau. Les fins du travestissement féminin hésiteraient entre érotisme et justice… Qu’en est-il dans le théâtre contemporain ? On a du mal à imaginer dans les romans ou les dramaturgies d’aujourd’hui des personnages comme Mademoiselle de Maupin qui était capable, dans la vraie vie, de s’habiller en homme pour aller enlever sa dulcinée dans un couvent – avant de le brûler.
On comprend qu’en son temps, elle ait inspiré Théophile Gautier. Mais maintenant ? Rappelons que dans sa POETIQUE, Aristote considère les intrigues à reconnaissance (donc à déguisement) comme les plus belles : elles permettent de créer des complications dans l’intrigue, de susciter des quiproquos, d’aboutir à des coups de théâtre au moment de la révélation de l’identité. Aujourd’hui donc, on imagine mal une demoiselle de Maupin en complet-veston partir mettre le feu à un couvent, ou une femme se déguiser en homme pour s’introduire au Parlement. Le port du pantalon et le droit d’expression lui sont officiellement accordés. Cela expliquerait pourquoi les personnages de travestis féminins, écrits comme tels dans des textes dramatiques ou romanesques, aient apparemment déserté les œuvres contemporaines. C’est sans doute dommage pour les intrigues à reconnaissance (et donc à déguisement), dommage pour le plaisir du retournement, sur les scènes de théâtre. C’est peut-être bon signe, sur la scène du monde, pour la Pensée et le féminin 20.
- Cécile Daumas, « Tentations, barbe et moustache, retour en grâce », Libération,12 janvier 2007. ↩︎
- ORLANDO, d’après le roman éponyme de Virginia Woolf, mis en scène par Robert Wilson à l’Odéon Théâtre de l’Europe, 1993. ↩︎
- ORLANDO de Virginia Woolf (préface de Pierre Nordon), Éditions Le Livre de Poche, 1993. ↩︎
- LA FAUSSE SUIVANTE d’après la pièce de Marivaux, film réalisé par Benoît Jacquot en 2000. ↩︎
- QUARTETT de Heiner Müller, mise en scène de Robert Wilson à l’Odéon Théâtre de l’Europe, 2006. ↩︎
- Isabelle Huppert dans un entretien avec Patrick Sourd, Magazine Rendez-vous, no 5, oct.-nov. 2006. ↩︎
- Dans le domaine musical : « Varier un thème, c’est le transformer sans en altérer l’essentiel ». ↩︎
- En référence à Judith Butler, TROUBLE DANS LE GENRE, POUR UN FÉMINISMEDE LA SUBVERSION, La Découverte, 2005. ↩︎
- Alain Rey (sous la direction de), DICTIONNAIRE CULTUREL EN LANGUE FRANÇAISE, Le Robert, 2005, p. 1568. ↩︎
- Ces définitions s’appliquent au travestissement en général. Ici, on s’intéresse tout particulièrement au travestissement théâtral. Mais sans perdre de vue que les travestis qui travaillent en dehors des scènes de théâtres (drag queens, artistes de cabaret ou prostitués) jouent aussi avec et sur la scène du monde. Pour Pascal Le Brun Cordier (dans son article « Drag queen » écrit pour le dictionnaire Larousse des Cultures Gays et Lesbiennes, dirigé par Didier Eribon), les drag queens « personnages travestis créés et joués par des hommes réalisent une spectaculaire traversée des genres (…). Excessivement théâtrales, elles transforment toutes leurs apparitions en performance. » ↩︎
- Michel Corvin (sous la direction de), DICTIONNAIRE ENCYCLOPEDIQUE DU THÉÂTRE, Larousse-Bordas,1998, p. 479. ↩︎
- Georges Forestier est notamment l’auteur d’une ESTHETIQUE DE L’IDENTITÉ DANS LE THÉÂTRE FRANÇAIS(1550 – 1680), Éditions Droz, Genève, 1988. ↩︎
- Si les drag queens sont des personnages créés et joués par des hommes, les drag kings le sont par des femmes. Si les unes et les autres s’inscrivent dans la longue histoire du travestissement, elles n’en sont pas moins politiques et participent à leur manière au mouvement queer. À ce sujet, lire la Revue du Collège international de philosophie intitulée « Queer : repenser les identités », sous la direction de Robert Harvey et Pascal Le Brun-Cordier, Rue Descartes, no 40, 2003. ↩︎
- ORLANDO de Virginia Woolf, ibid, p. 183. ↩︎
- ORLANDO, ibid, p. 184. ↩︎
- C’est aussi beaucoup plus facile pour faire du vélo. À ce propos, l’historienne Laure Murat, auteure de La Loi du genre, une histoire culturelle du troisième sexe (Éditions Fayard), souligne en effet l’importance d’une histoire du vêtement et notamment du pantalon. Un arrêté préfectoral de 1800 interdisant aux femmes de s’habiller en homme, sauf quand elles sont à côté de leur vélo, serait tombé en désuétude mais pas abrogé… Consulter par ailleurs Les Dessous de la féminité (Éditions Assouline), où l’historien Farid Chenoune, spécialiste de l’histoire de la mode et des codes vestimentaires, analyse l’évolution des dessous chics mais décrypte également le destin du pantalon de femme et la révolution du tailleur-pantalon d’Yves Saint Laurent. ↩︎
- François Regnault, Théâtre-Solstices, Écrits sur le théâtre, Vol. 2, Actes Sud, CNSAD, 2002. ↩︎
- À ce sujet, un ami musicien me signale que la tessiture des voix d’hommes et de femmes se rapproche, donc que leur écart se réduit de manière sensible depuis quelques décennies. ↩︎
- Jean-François de Sauverzac, LE DÉSIR SANS FOI NI LOI, LECTURE DE LACAN, Éditions Aubier, 2000. ↩︎
- Jean-François de Sauverzac, « Note liminaire », dans Wladimir Granoff, LA PENSÉE ET LE FÉMININ, Éditions Flammarion, 2004. ↩︎