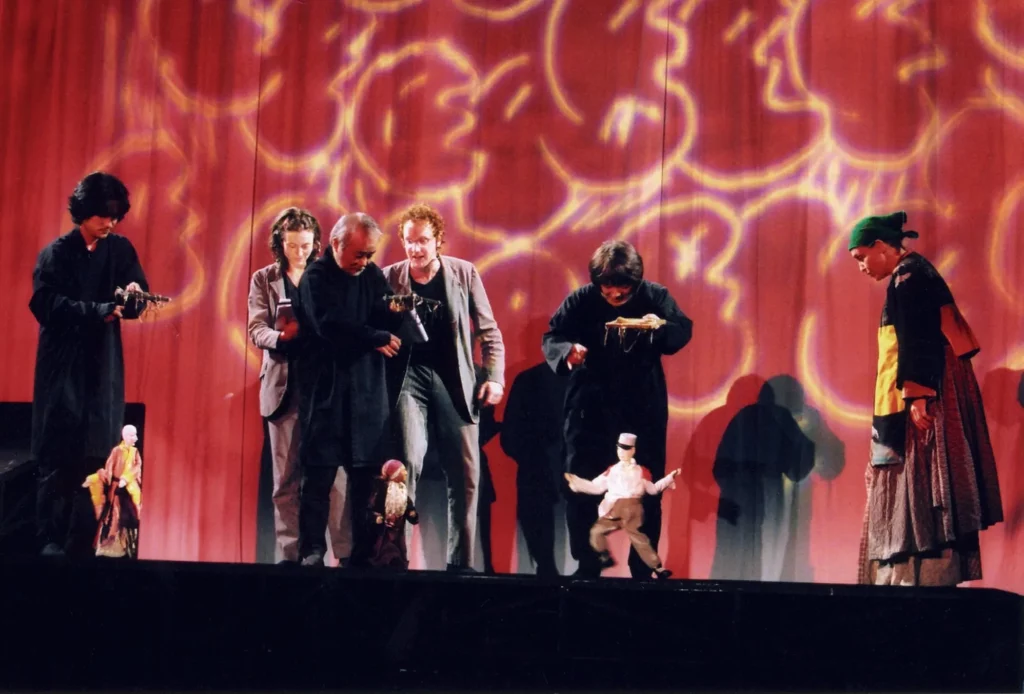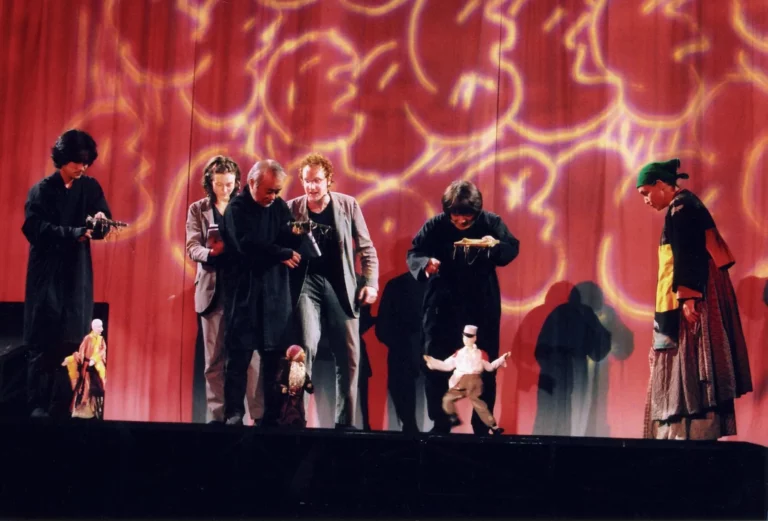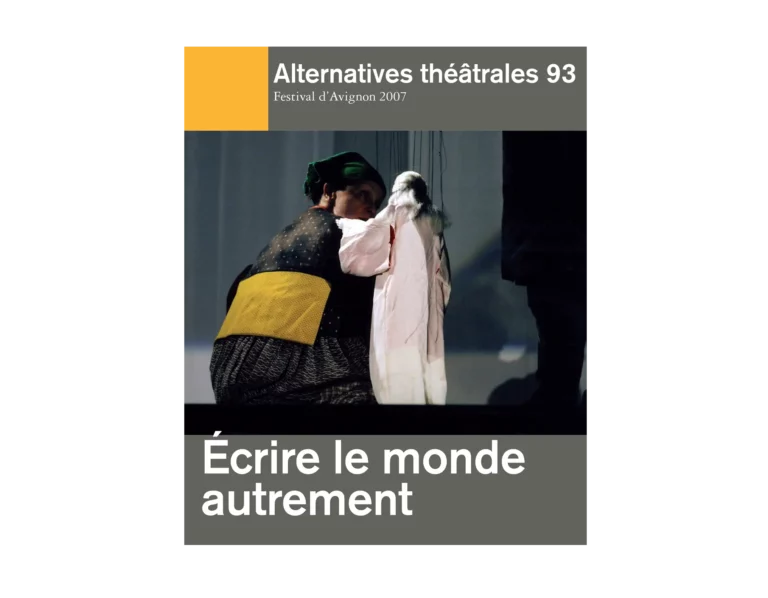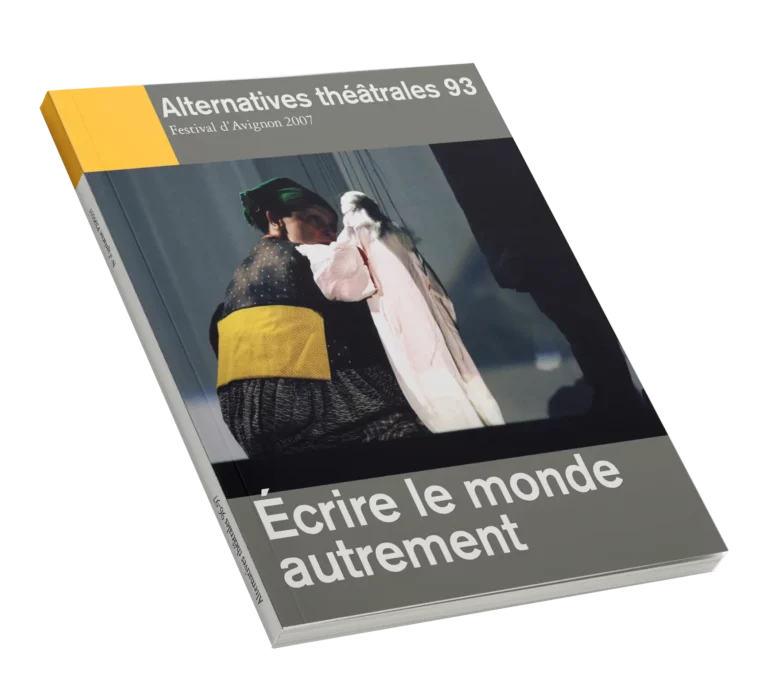EN 1996, à trente ans, je me trouvais pour quelques mois à Aubusson, dans la Creuse, à la suite d’un licenciement dans le secteur financier. Frédéric Fisbach est venu travailler L’ANNONCE FAITE À MARIE de Paul Claudel. J’ai intégré le groupe d’amateurs avec lesquels il expérimentait différentes formes en amont des répétitions, et qui devait prendre en charge le prologue du spectacle et la scène des paysans (acte 3 scène 1). J’étais depuis longtemps un spectateur assidu de théâtre, d’opéra et de cirque (je voyais fréquemment plusieurs fois le même spectacle). C’était la première fois que je jouais devant un public. Je vivais l’accompagnement des acteurs « professionnels », la constitution d’un groupe solidaire et en partie responsable du bon cheminement du regard du spectateur, la participation concrète à la mise au point d’un véritable spectacle (véritable en cela que ses spectateurs venaient voir un spectacle « professionnel » ). Cette expérience a été déterminante. C’était l’ouverture d’un dialogue artistique avec Frédéric, qui n’a pas cessé depuis. D’une façon non volontaire, Frédéric pense la transmission et l’échange à chaque étape du processus de création. C’est ce qui a rendu cette rencontre possible. Dès sa sortie du Conservatoire, il a travaillé quotidiennement avec des amateurs, en tant qu’acteur permanent de la Compagnie Nordey en résidence au Théâtre Gérard Philipe de Saint-Denis de 1991 à 1993, puis au Théâtre Nanterre-Amandiers de 1994 à 1997. Pour lui, ce ne sont pas les amateurs qui défrichent et labourent, pour que l’acteur vienne ensuite semer ses graines merveilleuses, à la manière des doublures ou des figurants. C’est un travail commun, une interrogation collective. La lecture personnelle d’un texte, en éprouvant le contact avec d’autres, se complète, se formule, s’enrichit. Lors de l’ébauche d’une dramaturgie, les réactions et suggestions sont bienvenues. Les questions artistiques s’invitent dans la cité, les rapports se trans- forment. Les ateliers amateurs travaillent profondément les participants.
En répétitions, en période d’improvisation, d’essai, de recherche, un groupe d’interprètes se soude. Chacun apprend la distance, l’imaginaire, le corps des autres. Les spontanéités s’accordent, des chemins s’empruntent, on éprouve, on s’approprie le texte, l’univers, les choix. Des pistes peuvent être suivies très (trop) tôt. Un exemple : le 5 avril 2007 au Studio-Théâtre de Vitry, nous1 étions dans la deuxième semaine de répétition des FEUILLETS D’HYPNOS de René Char. Nous commencions à nous engager dans des voies. Un groupe d’amateurs participant à l’atelier du jeudi2 est venu travailler le soir avec nous. Nous étions tous en lecture du dernier quart du recueil. Certains feuillets leur ont été confiés, avec quelques principes larges.
Leur présence nous faisait évoluer dans un espace totalement transformé. Du plateau, certaines de leurs propositions ont d’abord été ressenties comme trop franches, trop pittoresques, trop narratives, en un mot : faibles. Une intrusion dans un espace peureusement rendu familier en quelques jours à quelques-uns. Progressivement, ces propositions ont révélé leur pertinence. Et recadré mon travail d’acteur qui est d’éliminer tout garde-fou qui, s’il n’est pas patiemment débusqué, empêche les sauts dans l’inconnu. Car ce moment de recherche, par ses pièges, engendre chez la plupart des interprètes des réflexes de protection, même ténus, indécelables immédiatement. Solidifier très vite, pour se rassurer. Car c’est difficile de s’avouer non spécialiste de la matière qu’on aborde. D’autant plus quand il s’agit d’un projet comme FEUILLETS D’HYPNOS, qui est un texte multiforme écrit pour le papier. Sa forme scénique, qui inclut la présence d’un groupe d’amateurs pour ancrer la représentation dans son territoire naturel et pour donner une voix aux anonymes auxquels René Char rend hommage, s’invente par un long chemin, des décisions lentes, après de nombreuses « répétitions ». Les amateurs partagent une expérimentation d’acteurs de la façon la plus directe et construisent une réflexion à partir d’une problématique concrète de mise en scène. Par leur imaginaire, par leur implication, ils contribuent très directement à l’élaboration du spectacle. Ils peuvent être utiles pour les interprètes en contribuant à la lucidité de leur travail. Car leur désir de théâtre est dans une forme première ( hors contingence professionnelle ) et ils représentent un maillon entre la scène et la salle.