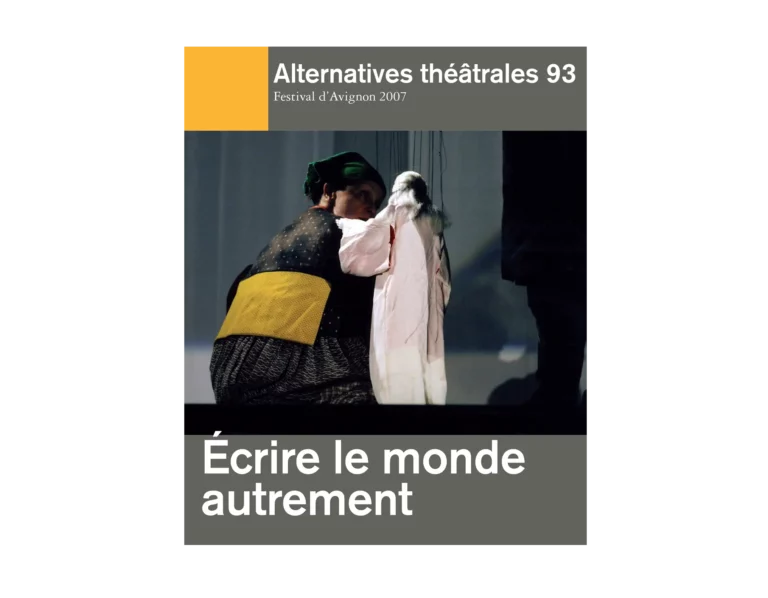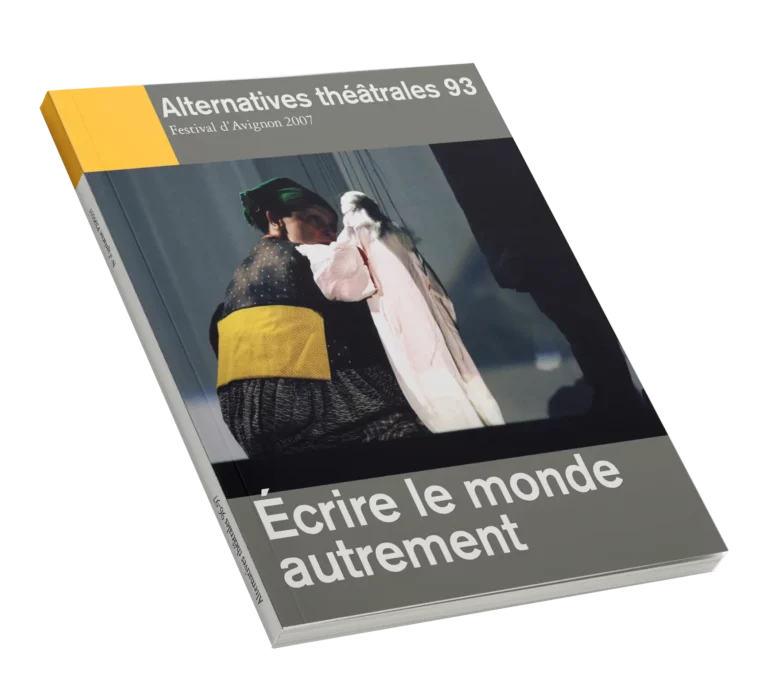MATHIEU BAUER : TENDRE JEUDI serait d’une certaine manière une suite possible à RIEN NE VA PLUS : à la fin de ce spectacle qu’on avait créé il y trois ans, un metteur en scène, qui avait joué et perdu toute sa subvention à Las Vegas, partait sur la route avec une belle étrangère ; celle-ci lui demandait : « Où est-ce qu’on va ? », et il répondait : « On va tout droit ». Cela finissait un peu en queue de poisson… En lisant TENDRE JEUDI, un été, par hasard, je me suis dit que si ce metteur en scène looser devait arriver quelque part, c’était forcément rue de la Sardine : du fait de l’espèce de mélancolie qui baigne tout le roman, du système D qui y règne en permanence et qui fait qu’on y vit au jour le jour. Il n’y a pas de futur, pas de projection, c’est le lieu de l’écoute, du regard, de la tendresse – c’est cela que j’avais envie de traiter. TENDRE JEUDI rejoint également mon goût pour une écriture assez cinématographique et populaire. C’est quelque chose de plus sentimental pour moi, lié à l’enfance, et que l’on trouvait déjà dans L’EXERCICE A ÉTÉ PROFITABLE, MONSIEUR, le spectacle qu’on avait fait d’après les textes de Serge Daney : mon amour pour un certain cinéma populaire, avec ses figures caractéristiques, ses seconds rôles… TENDRE JEUDI est truffé de personnages secondaires, de petites anecdotes, de petits fragments d’histoires, qui nous racontent des choses sur les uns et sur les autres ; des figures qui n’apparaîtront pas sur scène mais qu’on évoque – comme si on convoquait des seconds rôles du cinéma américain.
Christophe Triau : C’est toute une petite communauté qu’il s’agit ainsi de représenter ?
M. B. : Autour de la figure centrale de Doc s’arti- culent un tas de personnages qui vivent en communauté, avec tout ce que cela implique : la solidarité, l’écoute, l’entraide… Plus encore, ce qui me touche particuliè- rement, c’est que ces personnages ne se jugent pas les uns les autres. Que tu sois pute ou clochard, ou flic (même le flic est sympathique!), il n’y a pas de jugement : on ne considère pas l’autre en fonction de ce qu’il représente, mais pour sa capacité à dialoguer, à écouter. Cela se joue aussi dans la manière dont les autres personnages s’emparent de l’histoire d’amour de Doc et Suzy, cette histoire d’amour qui n’arrive pas
à se faire, pour spéculer dessus : raconter des histoires absolument invraisemblables, faire des horoscopes faussés… Grosso modo, ce serait d’ailleurs plutôt Mac ( le chef de la bande ) la figure centrale : c’est lui qui a la plus grande capacité à inventer des histoires, à raconter des bobards.
C. T. : Cette petite communauté, on pourrait la mettre en rapport avec la manière dont travaille la compagnie Sentimental Bourreau, que tu diriges ?