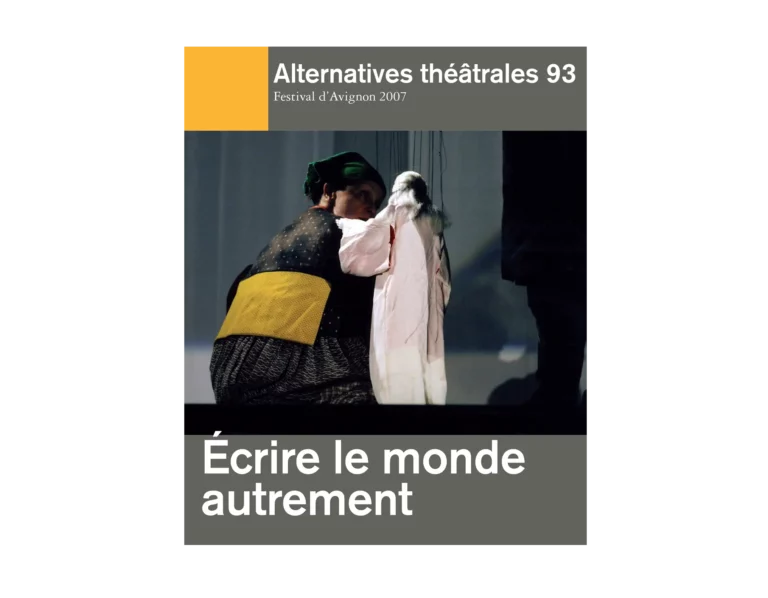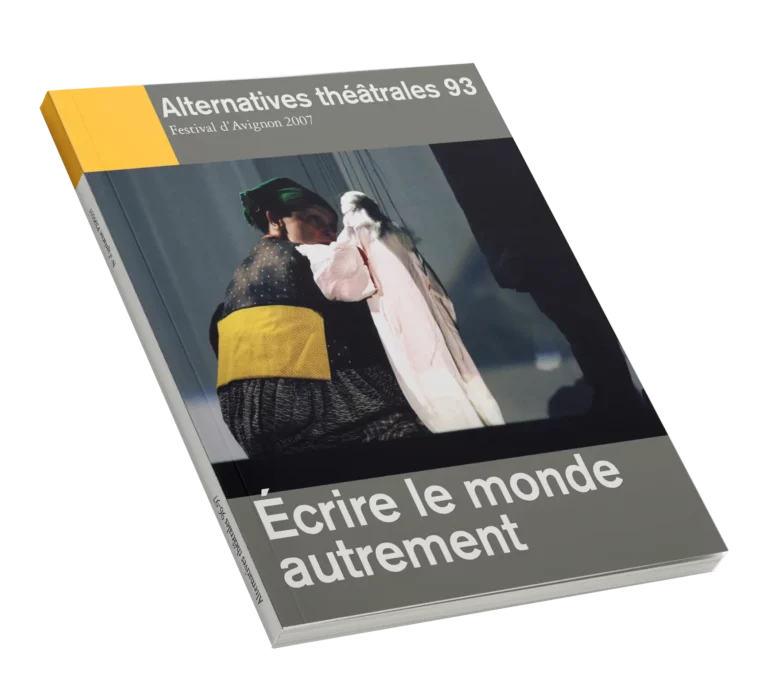TANIA MOGUILEVSKAIA : Tu as déjà réalisé quatre mises en scène1 des pièces du jeune auteur russe Ivan Viripaev. Qu’est-ce qui t’intéresse en particulier dans ses textes ?
Galin Stoev : Lorsqu’il y a six ans, j’ai lu en russe sa première pièce, LES RÊVES, j’ai ressenti quelque chose de très fort. Je n’avais pas la moindre idée de comment on pouvait la mettre en scène ! Mais pendant la lecture, le spectacle s’était pour ainsi dire déroulé au creux de mon ventre et d’une façon très énergétique. Ce qui m’a plu dans OXYGÈNE, c’est l’adresse directe au spectateur, cette manière de déverser un flot de mots dans la salle. Et aussi le choix de la forme « concert » qu’il propose : dix chants avec couplets et refrains. Il y a également la musicalité particulière de cette parole et le développement du sujet qui ne suit pas une logique linéaire, mais une logique du déploiement musical. GENÈSE No 2 m’a paru encore plus intéressant parce qu’encore plus composite. Ici, Viripaev part d’un texte écrit par la patiente d’un hôpital psychiatrique. Avec son autorisation, il compose une œuvre qui, outre la pièce originale d’Antonina Velikanova, comprend des extraits de leur correspondance, des commentaires sur ce texte et quelques « couplets comiques » signés Viripaev.
Ce qui m’a interpellé dans chacun de ces textes, c’est le type particulier de communication qu’ils instaurent au niveau théâtral. Cette écriture a ébranlé mes propres limites de compréhension. Si l’on aborde ces textes de manière simplement littérale, on sera probablement frappé, voire choqué, par la radicalité de certaines options idéologiques. Mais je me tiens à distance du caractère un peu messianique de cette écriture. Ce qui m’intéresse davantage, c’est la situation de jeu proposée : « Je monte sur scène et je vais pousser les gens à penser activement, à prendre position, à faire des choix» ; c’est cela qui m’intéresse, beaucoup plus que de délivrer des messages préfabriqués. À la lecture, les textes de Viripaev sont pour ainsi dire incompréhensibles, mais ils sont porteurs d’une remarquable vitalité ou, plus précisément, d’une théâtralité vitale : ils sont fondamentalement destinés à être joués plutôt que lus. C’est là un trait caractéristique de sa dramaturgie ; le lecteur ne peut être que confus et perdu dans ce jeu infini de contradictions. Et cela vient du fait que la lecture est par définition une occupation solitaire, dans laquelle il manque a priori un autre à qui s’opposer concrètement. La représentation théâtrale, à l’inverse, propose une interaction et une confrontation avec quelqu’un « ici et maintenant» ; c’est uniquement à travers le jeu théâtral que l’on peut partager l’énergie des phrases et en percevoir corporellement le sens. Ces textes m’interpellent aussi par leur côté inachevé, ou par une sorte de manque qu’ils portent et par le sens qui n’arrête pas de s’enfuir.
T. M. : Comment travailles-tu avec les acteurs ? Dans GENÈSE No 2, chacun des trois interprètes2 semble disposer d’une grande liberté. Mais en même temps, on se demande si cette facilité, cette aisance qu’ils ont à changer de statut n’est pas l’une des choses les plus difficiles à atteindre. Lorsque par exemple, ils entrent dans la peau du personnage, et en ressortent aussitôt pour aller s’asseoir ou se balader en fond de scène…
G. S. : C’est justement parce que la structure du texte de GENÈSE No 2 est résolument ouverte que tout devient possible. Il y a une grande liberté et c’est précisément cela qui nous a posé le plus de problème. Face à ce texte, nous avions l’impression d’être dans une sorte de « palais des glaces ». Et cela nous a tous, dans un premier temps, conduit à un blocage complet. Petit à petit, j’ai compris que la liberté était à construire à l’intérieur d’une structure bien articulée, et que c’était la seule voie qui pouvait nous protéger de l’apparente anarchie. À mon sens, le plus important dans ce processus c’était la question du statut de l’acteur dans la représentation. J’ai commencé par une idée simple : l’acteur ne doit pas jouer le personnage mais jouer « du personnage », de la même façon qu’un musicien joue « de son instrument ». Le plus important, ce n’est pas le musicien ni l’instrument, mais la musique que nous entendons, qui naît de la relation subtile qui se construit entre le musicien et son instrument. Appliqué au jeu théâtral,
ce principe nous fait comprendre que l’acteur ne doit pas jouer le personnage, mais bien plutôt entrer en relation avec ce personnage, pour faire entendre un thème. Très concrètement, au début, nous nous sommes accordé une longue période d’improvisations très libres, pendant lesquelles chacun des comédiens est parti à la recherche de « son propre idiot intérieur » : il s’agissait pour chacun de s’inventer un alter ego et de lui laisser faire tout le travail de répétition ! Ce travail, très drôle, nous a aussi permis de manipuler de façon très fluide, et en gardant une saine distance, la matière relative à la schizophrénie.