UNE FÊTE dont les éléments sont disparates, elle n’est la célébration de rien ».1 Ainsi Genet décrit-il LES PARAVENTS dans une lettre à Roger Blin, le premier metteur en scène français à avoir mis en scène la pièce en 1966. Avec sa structure éclatée en seize tableaux explosés en myriade de vignettes, sa distribution foisonnante de quatre-vingt-seize personnages, ses quatre niveaux de lieux scéniques qui renvoient le récit du bord de la route au bordel, de la plantation à la prison, son langage débordant de métaphores et de musicalité, ses intrigues diffuses reflétant une famille qui s’abaisse volontairement dans la misère, une insurrection anti-coloniale, et une prostituée qui cultive sa beauté au-delà de sa sexualité…, LES PARAVENTS est un monstre bariolé qui n’a été porté à la scène que peu de fois depuis sa publication en 1961. Dans les années soixante, ce kaléidoscope délirant d’images, de couleurs et de sons ne diminua pas la charge politique de la pièce. Même si Genet ne spécifie pas le pays de référence de cette histoire d’un pouvoir colonial qui perd le contrôle de son territoire arabe, la référence à l’Algérie était évidente, et provoqua en 1966 des émeutes devant le Théâtre de l’Odéon. Plus de quarante ans après la fin de la Guerre d’Algérie, cette pièce porte-t-elle toujours un poids politique ? Ou n’est-elle devenue rien de plus qu’un carnaval coloré de scènes et de sons ? La mise en scène de Frédéric Fisbach, créée en 2002 et reprise pour le Festival d’Avignon en 2007, démontre que LES PARAVENTS « n’est la célébration de rien » sauf de ses « éléments disparates » – jeu, image, son – mais que cette célébration d’informations démultipliées peut néanmoins permettre une lecture, ou des lectures politiques.
Pour Fisbach, la déflagration poétique des PARAVENTS est politique en elle-même. Lors d’un entretien, il explique : « Aujourd’hui, les médias de masse véhiculent un mode de narration et de représentation qui suit un strict régime de communication et de consommation. » L’industrie des médias et du divertissement présente la réalité à travers le réalisme, puisque ce style de représentation coïncide au degré le plus haut avec la réalité du spectateur, s’adaptant ainsi à la consommation immédiate. Dans l’un de ses premiers textes sur le théâtre, Genet rejette le vraisemblable et la psychologie du théâtre naturaliste « au profit de signes aussi éloignés que possible de ce qu’ils doivent d’abord signifier »2. En changeant le titre LES MÈRES pour LES PARAVENTS, Genet met en exergue le mode de représentation de sa pièce. Fisbach reste fidèle à cette interrogation constante sur les différentes manières de représenter et de raconter le monde. Il ajoute : « J’essaie de réfléchir à comment représenter autrement pour que l’autre puisse mettre en doute les modes de représentation majoritaires. » La fête jubilatoire de marionnettes, de comédiens, de dessins, de films, de voix et de sons qu’il rassemble sur scène renforce l’éclatement poétique de Genet, et conteste les modes de représentation dominants.
Fisbach n’a pas tenté d’aplanir les fragments hétéroclites et contradictoires des PARAVENTS. Au contraire, chaque élément de sa mise en scène désavoue le concept du récit et du personnage trop rapidement reconnaissables. La « Famille des Orties » est incarnée par un trio hasardeux : Saïd par un danseur italien ( Giuseppe Molino), sa femme Leïla par un homme de grande taille ( Benoit Résillot ) et sa mère par une comédienne ( Laurence Mayor ) d’un dynamisme et d’un athlétisme caractéristiques plutôt d’une jeune femme que d’une mère âgée. La nature atypique, presque grotesque, de cette famille, résiste de cette manière à la mimèsis. Edward Gordon Craig parle de l’über-marionnette, qui cherche des formes au-delà de la réalité, au lieu de la copier. Pour Genet, ce sont surtout les marionnettes elles-mêmes qui permettent un rejet du mimétisme. Ici, Fisbach suit Genet à la lettre, en faisant jouer tous les autres personnages par des marionnettes de ningyo joruri japonais – le théâtre de la compagnie Youkiza, fondée en 1634, ressemble au bunraku d’Osaka, à la différence que ses marionnettes sont à fil, et qu’elles s’ouvrent plus sur le répertoire contemporain. Plus que tout, ce sont les marionnettes qui atteignent le summum de théâtralité, illustrée pour Genet par l’Eucharistie : quand « une simple pastille blanche » incarne « Dieu lui-même »3. Lorsque la Mère étrangle Pierre, le militaire français, en l’aidant à remettre son barda, la comédienne arrache la tête de la poupée. Quand la Mère gémit « petit soldat de France… qu’est-ce qu’on fait de ces trucs-là ? » en essayant de démêler les fils de la marionnette qu’elle porte « comme on traîne un gibier abattu », le texte de Genet sert à signaler la dualité humain/jouet, comme la dualité Dieu / pain. Pierre étant ainsi à la fois humain et jouet, il réalise la théâtralité alchimique dont rêve Genet. Les trois films projetés durant le spectacle mettent également sur le même plan plusieurs niveaux de représentation. Dans le premier, le récit passe des comédiens aux marionnettes, puis à un montage de croquis de greffier représentant le procès pour vol de Saïd. Dans le deuxième, Saïd apparaît en clown-charlot jouant un tour de magie dans lequel il avale une copie toute petite de lui-même. Comme Saïd et sa famille refusent la bienséance et le carriérisme évangélisés par la culture coloniale, les révolutionnaires les prennent pour des héros. Saïd refuse, s’exclamant : « À la vieille, aux soldats, à tous, je vous dis merde ! ». Genet explique la trahison de Saïd dans ses commentaires du treizième tableau, que les vociférateurs lisent à haute voix durant le film : « Saïd trahissant – mais en commettant une erreur si grave que la trahison ne peut être réalisée : la trahison trahissant Saïd. » La scission en deux de Saïd dans le film illustre l’incapacité ou le refus, cher à Genet, de mener un projet à bout, évitant ainsi tout dogmatisme. Dans le dernier film, les marionnettes, qui mesurent soixante-dix centimètres, apparaissent en format gigantesque sur l’écran, au moment où leur personnage entre dans le monde des morts. Quand la Mère converse avec elles, elle est placée derrière l’écran pour apparaître en ombre chinoise. Les interactions illusionnistes dans ces films possèdent une qualité alchimique où marionnette, acteur, humain grandeur nature, humain rapetissé, image projetée et ombre, jouent ensemble.
L’illusion d’une totalité occasionnée par le personnage psychologique est immédiatement empêchée dans le théâtre ningyo joruri pour plusieurs raisons. Premiè- rement, le personnage est joué par un assemblage de fils, de bouts de bois, et de tissu. Deuxièmement, la marionnette est dépendante de son manipulateur. Les six marionnettistes dans la création de Fisbach sont habillés de noir, le visage caché par un voile. Le décor parfois clair les met en relief. De plus, puisque la manipulation des poupées nécessite une forte animation de leur corps, les manipulateurs donnent l’impression de danser derrière leur marionnette. Et leur voile ressemble à la cagoule de Leïla, ceci atténuant la distinction manipulateur/acteur. Pour les représentations au Théâtre de la Colline en 2002, la patine noire du plateau reflétait marionnette et manipulateur, redoublant et décentrant davantage chaque personnage. Troisièmement, la voix de la marionnette est disloquée de son corps, puisque articulée par les gidayus.


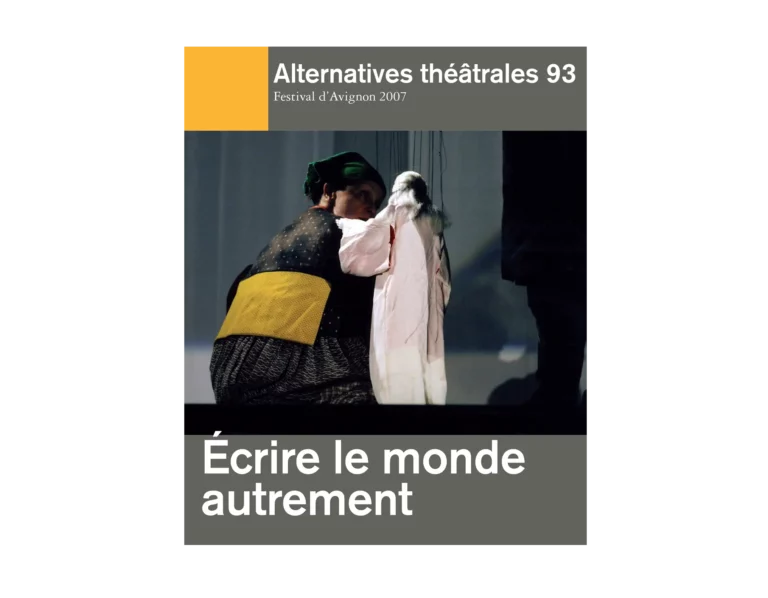
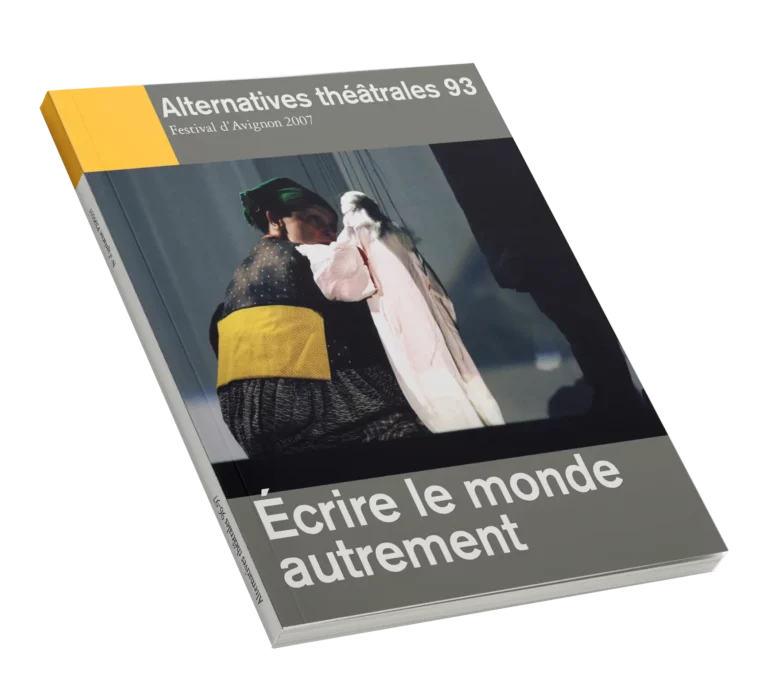


![Enfant de Médée : [maquette de costume] / [Louis-René Boquet]](https://alternativestheatrales.be/wp-content/uploads/2025/12/Enfant_de_Medee___maquette_.Boquet_Louis-Rene_btv1b8454742f-3-428x569.webp)
