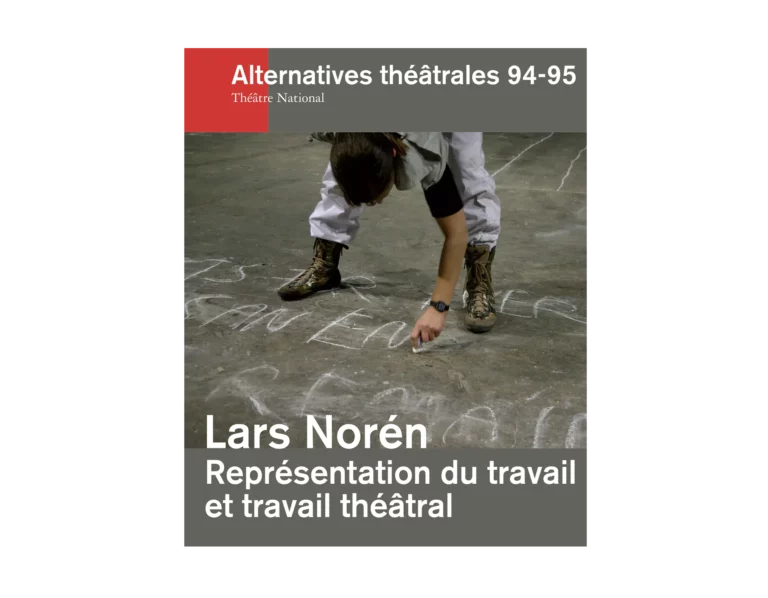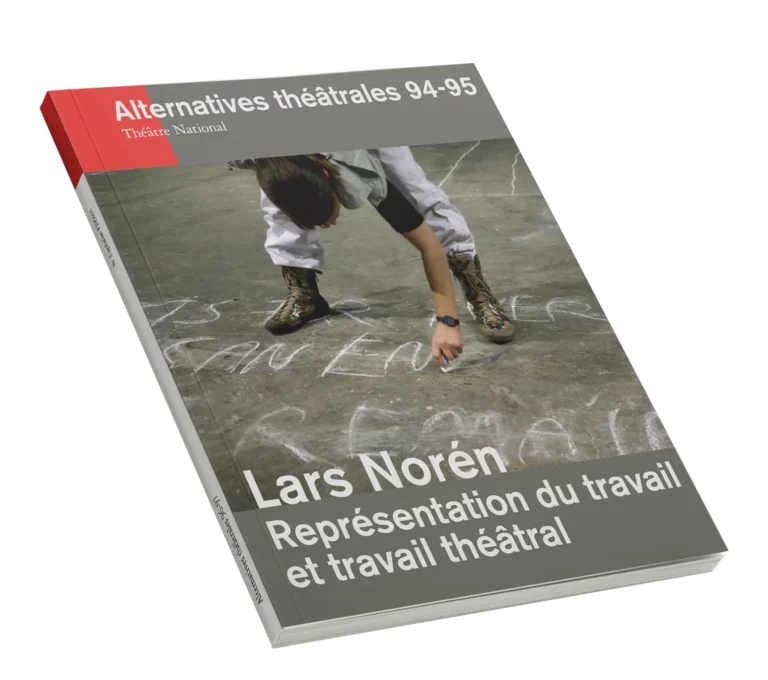Grand prix du syndicat de la critique (meilleur spectacle théâtral de l’année 2007).
« HEUREUX les simples d’esprit car le Royaume des cieux leur appartient », dit la Bible. Il ne s’agit pas des benêts mais des esprits simples, des cœurs purs, des plus démunis… À ceux-là, le Royaume des cieux est ouvert, pour peu que l’on croie en Dieu. Qu’en est-il chez Lars Norén ? Ses douze fous — enfin treize, en comptant celui qui fait office d’infirmier — ne semblent pas nager dans le bonheur. Ici-bas, ils séjournent douloureusement dans un hôpital psychiatrique, certes ouvert, mais sans perspectives d’ici-haut. Chez Norén, pas plus de promesses de Béatitudes pour nous — enfin pour les gens dits normaux. Dedans, dehors… c’est un peu pareil. Après avoir monté CATÉGORIE 3.1 en 2000, Jean-Louis Martinelli a choisi de s’emparer une nouvelle fois de la langue de l’auteur suédois, et de la parole des exclus.
Microcosme déviant ou reflet du monde ?
Dans KLINIKEN, une des quatorze pièces dites « pièces mortes » de Lars Norén, on entend des récits du monde et de la famille, de l’enfermement et de la folie, de la mort et de la vie, des récits qui émergent dans une économie de moyens, des mots et du plateau.
On rencontre Martin qui travaillait dans la publicité et a découvert sa séropositivité, Sofia l’anorexique, Mohammed dont la famille a été massacrée par les Serbes, Roger l’obsédé sexuel… Au total, douze personnages du côté des fous — des déclarés fous par l’État, la société — ‚et un du côté du personnel soignant. Ces douze-là font figures d’apôtres d’un monde désenchanté. Drogue,guerre, sida, etc. Microcosme déviant ou simple reflet de notre monde malade du capitalisme ? Jean-Louis Martinelli continue d’ausculter notre société, placée sous le gril d’un poète que nombre de professionnels du théâtre et de la critique considèrent aujourd’hui comme le successeur de Bergman et de Strindberg : « C’est la maladie du corps social qui est sur scène. Les acteurs sont comme douze pathologies, douze manifestations et on va étudier ces signes-là, qui révèlent l’état du reste du monde. »1
À part Markus qui souffre d’une pathologie grave, schizophrénie aiguë, les autres ne semblent pas exagérément timbrés : disons vous et moi, juste après avoir basculé de l’autre côté. La difficulté à placer la frontière de la normalité est particulièrement bien montrée ici, sans compassion excessive, avec respect. On garde à l’esprit la mise en scène — tout aussi réussie en son temps — de Peter Brook, d’après L’HOMME QUI PRENAIT SA FEMME POUR UN CHAPEAU. Mais alors les patients souffraient de maux plus graves, leurs maladies portaient des noms savants, et le théâtre qui nous les présentait s’inspirait d’un ouvrage à caractère médical relatant des cas cliniques. La neuro-biologie s’en mêlait. Ce qui n’avait pas empêché Peter Brook de nous offrir une pièce hautement « senti-mentale », c’est-à-dire qui fait « sentir le mental » humainement. Brook nous disait déjà qu’on pouvait successivement tenir un rôle de soignant et de soigné, et les acteurs sur scène, changeaient de rôle à vue sans grande surprise pour nous.
Dans la mise en scène de Jean-Louis Martinelli, pas de confusion des genres. L’hôpital ressemble à un hôpital. On en voit principalement le hall commun, lieu de passage et de retrouvailles : une télé, un canapé… et au fond une rangée de portes qui conduisent aux chambres et aux toilettes. Côté jardin, la cabine téléphonique. Côté cour, un grand écran qui ouvre vers le dehors, la nature, la liberté. L’espace est ouvert. Mais personne ne songe à s’en aller, sauf pour un dernier voyage. Les malades restent entre eux. Et parlent, plus ou moins volontiers, de leurs souffrances, de leurs secrets. Leurs échanges semblent avoir des vertus thérapeutiques : ils se parlent sans se juger. L’univers hospitalier n’est pas pour autant idéalisé, ni caricaturé. Lars Norén y a fait un séjour quand il avait dix-huit ans, soigné notamment à coups d’électrochocs, paraît-il. Un ami l’en avait délivré.