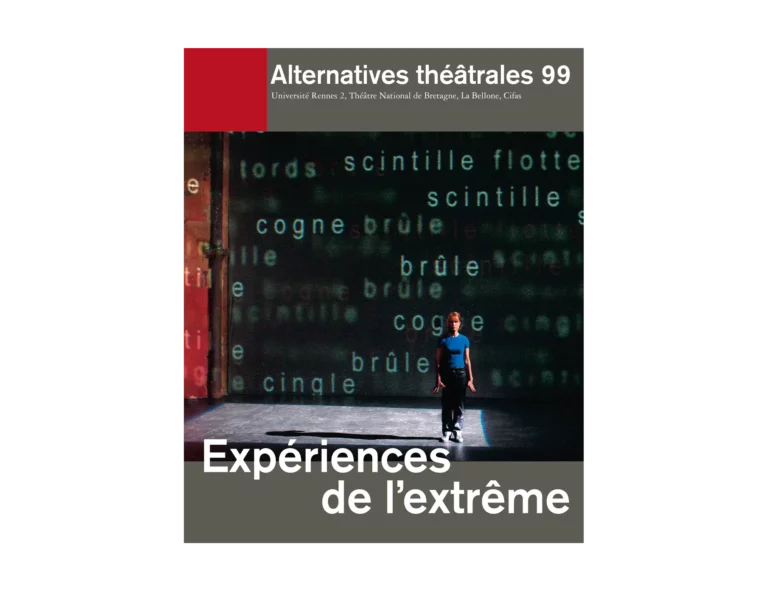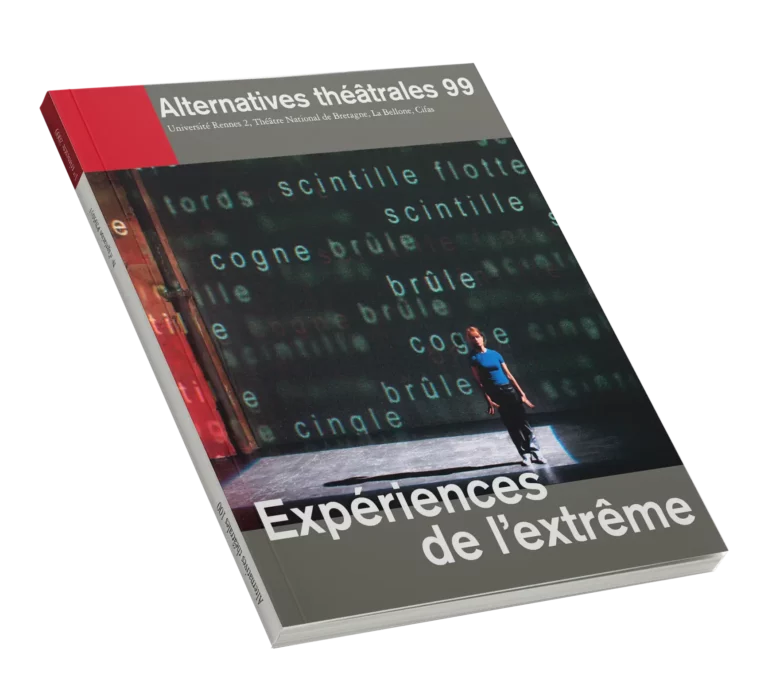Dans la tradition occidentale, l’apocalypse structure une conception de la fin qui implique une révélation, comme l’indique l’étymologie du mot : « apocalypse » qui signifie littéralement « révélation » en grec. Ici et maintenant, cette conception de la fin, qui suppose l’affirmation d’un sens, semble connaître un affaiblissement qui repose sur une mise en question du modèle apocalyptique. L’imaginaire porté par l’Apocalypse de Jean est en effet indissociable d’une perspective eschatologique désormais corrodée par le soupçon. Un réel soupçon se fait depuis longtemps entendre sur la scène de théâtre. Ainsi est-il à l’œuvre dès Le Roi Lear de Shakespeare, pièce fondatrice d’une transition de l’apocalypse à la crise qui n’a cessé de se rejouer dans le théâtre du XXᵉ siècle, et qui résonne encore sur la scène contemporaine.
Le Roi Lear : un modèle ambigu
Dans la tragédie de Shakespeare, la première occurrence de la didascalie « Toujours l’orage »1, omniprésente dans le troisième acte, annonce l’émergence d’un imaginaire apocalyptique ambivalent, qui mêle croyances païennes et références chrétiennes, désespoir et promesse de rédemption. L’orage shakespearien, qui survient dans la lande où Lear a été rejeté par l’ingratitude de ses filles, semble d’abord refléter l’intériorité d’un personnage menacé par la folie. La réapparition du roi dans le nouvel espace que constitue la lande est préparée par le discours d’un personnage anonyme, qui associe la fureur des éléments et celle de Lear. Le roi, « aux prises avec les éléments courroucés », seul avec le fou « qui par ses facéties tente d’exorciser les blessures de son cœur meurtri », en appelle à la fin du monde : « il donne l’ordre aux vents d’engloutir la terre dans la mer »2. Ce discours indirect, qui annonce la tonalité apocalyptique dominant le troisième acte du Roi Lear, est immédiatement confirmé par les imprécations délirantes du roi. Dès son entrée en scène, Lear associe une description hyperbolique de l’orage à un désir de fin du monde :
Soufflez, vents, à crever vos joues ! Faites rage ! Soufflez !
Vous, trombes d’eau et déluges, jaillissez
Jusqu’à inonder nos clochers et noyer leurs girouettes !
Vous, sulfureux éclairs prompts comme la pensée,
Avant-courriers de la foudre qui fend le chêne,
Brûlez ma tête blanche ! Et toi, tonnerre, qui tout ébranle,
Aplatis l’épaisse rotondité du monde !
Fracasse les moules de la nature, disperse d’un seul coup tous les germes
Qui font l’homme ingrat3 !
C’est une apocalypse païenne, structurée par des représentations du cosmos héritées de l’Antiquité, que Lear appelle de ses vœux. À travers le modèle platonicien d’un monde sphérique, et la conception lucrécienne d’une « nature » dont la matrice contient les « germes » du monde, se dessine un désastre privé de toute justification transcendante4. Au cours de la deuxième scène du troisième acte, cette apocalypse païenne laisse pourtant place à l’espoir d’un jugement dernier. Les références antiques qui marquent la première tirade de Lear s’effacent derrière une pensée chrétienne que ne saurait masquer l’apostrophe à une divinité plurielle :
Que les Dieux souverains,
Qui gardent ce terrible tumulte au-dessus de nos têtes,
Distinguent maintenant leurs ennemis. { … }
Forfait étroitement reclos,
Cassez les murs qui vous dissimulent, et demandez
La grâce de ces terribles justiciers. Pour moi, je suis
Plus victime du péché que pêcheur5.
Le lexique de la justice, associé à une référence au « péché », transforme la tempête en signe annonciateur du Jugement dernier. Ainsi l’orage du Roi Lear marque-t-il, sinon l’avènement d’un univers intemporel, du moins la possible rédemption d’un personnage qui se déclare « plus victime du péché que pêcheur »6. Aussi ne saurait-on dissocier les images apocalyptiques que suscite l’orage du Roi Lear du questionnement d’un modèle de conclusion qui appelle une révélation finale. Si la tragédie de Shakespeare prend, selon la formule de Frank Kermode, « la succession de l’Apocalypse », c’est parce qu’elle met en scène « un monde sans fin »7, où le Jugement dernier que Lear appelle de ses vœux ne survient jamais.
Dans Le Roi Lear, tout tend vers une conclusion qui n’advient jamais ; même la mort du personnage de Lear est cruellement différée. Au-delà de ce qui apparaît comme le pire, il y a une souffrance qui est pire encore, et la fin, lorsqu’elle survient, n’est pas seulement plus effroyable que tout ce que l’on pouvait attendre : elle n’est que l’horreur de la Crise, non la Crise elle-même. La fin relève désormais de l’immanence ; la tragédie prend en charge les figures de l’apocalypse, de la mort et du jugement, du paradis et de l’enfer ; mais le monde perdure entre les mains de survivants épuisés8.
Cette lecture du Roi Lear met l’accent sur un dénouement rejetant hors du temps de la représentation tragique le jugement dernier qui reconnaîtrait en Lear une « victime du péché ». La mort de Cordélia et la survie de son père viennent démentir l’espoir d’un dénouement providentiel dont témoignait le délire apocalyptique de Lear : « est-ce là la fin promise ? »9, s’interroge ironiquement Kent. Au désir d’une fin imminente que suscitait l’orage du troisième acte se substitue l’image d’un monde en crise, où la fin elle-même est devenue impossible : Roi Lear, poursuit Frank Kermode, est « la tragédie du sempiternel » dans l’ordre du malheur10. Son analyse rend bien compte de la réplique finale de la tragédie, prononcée par Edgar « au son d’une marche funèbre » qui rappelle la mort de Cordélia :
Au fardeau de ce triste temps nous devons obéir,
Exprimer ce que nous sentons, non ce qu’il faudrait dire.
Les plus vieux ont souffert le plus : nous les cadets
N’en verrons jamais tant, ni ne vivrons tant d’années11.
Edgar, « survivant épuisé » d’un dénouement annoncé par l’orage du troisième acte, témoigne finalement de l’impossible affirmation d’un sens. L’orage du Roi Lear ne suscite ainsi l’imaginaire apocalyptique du spectateur que pour mieux décevoir son attente d’une fin sensée. La tragédie de Shakespeare préfigure en ce sens l’« apocalypse sans révélation » que lit Philippe Ivernel dans Bataille navale de Reinhard Gœring12, et qui, au-delà du seul théâtre expressionniste, sous-tend nombre de pièces du XXᵉ siècle.
Le théâtre, reflet d’un monde en crise ?

Dans L’Illusion de la fin ou La Grève des événements, Jean Baudrillard décrit un « fantasme global de catastrophe [planant] sur le monde contemporain »13. Derrière la multiplication d’images évoquant l’anéantissement de la planète, ou l’invasion de discours sur les catastrophes naturelles et techniques menaçant le monde contemporain, se fait entendre un désir d’accomplissement immédiat de l’apocalypse dont Jean Baudrillard dénonce la naïveté. De tels fantasmes apocalyptiques, écrit-il, seraient devenus illusoires parce que la catastrophe s’est déjà produite, du moins virtuellement, annulant la possibilité d’une fin du monde à venir : « il faut bien se faire définitivement à l’idée qu’il n’y a plus de fin, qu’il n’y aura plus de fin, que l’histoire elle-même est devenue interminable »14.
À l’argumentation que développe Jean Baudrillard s’oppose la vision de la fin du monde dont se réclame Jean-Luc Nancy dans Le Sens du monde. Le philosophe récuse les images d’anéantissement de la planète qui ont envahi le discours contemporain pour leur substituer une réflexion sur la « fin d’un régime de sens » où le monde pouvait être pensé comme cosmos, comme totalité ordonnée :
Il n’y a plus de monde : plus de mundus, plus de cosmos, plus d’ordonnance composée et complète à l’intérieur ou de l’intérieur de laquelle trouver place, séjour, et les repères d’une orientation. { … } Il n’y a plus d’Esprit du monde, ni d’histoire pour conduire devant son tribunal. Autrement dit, il n’y a plus de sens du monde. { … } Nous le savons, nous savons que c’est la fin du monde et ce savoir n’a rien d’illusoire (ni de « fin de siècle » ou de « millénariste »). Ceux qui s’évertuent à dénoncer l’illusion que serait la pensée d’une « fin » ont raison contre ceux qui présentent la « fin » comme le cataclysme ou comme l’apocalypse d’un anéantissement. Une telle pensée est encore prise toute entière dans le régime d’un sens signifiant, qu’il se propose pour finir comme « non-sens » ou comme « révélation »15.