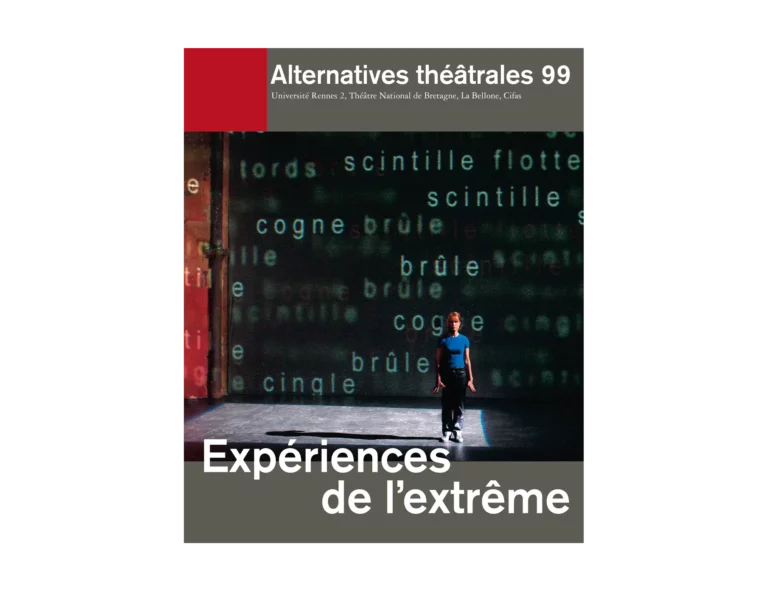Après Rwanda 94 et Anathème, le Groupov s’est engagé depuis plusieurs mois dans une nouvelle aventure, en gestation de beaucoup plus longue date : Fare Thee Well Tovaritch Homo Sapiens (Adieu Camarade Homo Sapiens). Le propos de cette création encore en plein chantier s’inscrit dans la lignée d’un « théâtre testamentaire », voire d’une œuvre ultime : la destruction ou la mutation radicale prochaine de notre espèce, en même temps que la longue érosion interne de ses capacités spécifiques dans le champ du vivant.
Ce vaste projet s’expose sous la forme d’une tétralogie, dont le premier volet, porté par Jacques Delcuvellerie et Raven Ruëll, jeune metteur en scène flamand, sera présenté au public au Théâtre National, à Bruxelles, en avril 2009.
Jacques Delcuvellerie a rassemblé et associé dans cette entreprise aux limites de la représentation des artistes belges (francophones et flamands), étrangers et de diverses disciplines. Ces artistes, chacun porteur d’univers singuliers, n’appartiennent pas aux mêmes générations. Travailler dans la perspective d’une fin inéluctable crée, entretient, provoque des contradictions, des dissonances et des accords inattendus entre jeunes et anciens qui marqueront profondément F. T. W. T. H. S.
Quatre chantiers sont donc ouverts, qui devraient produire quatre spectacles distincts, autonomes et complémentaires. Le deuxième volet sera porté par Marie-France Collard et Claude Schmitz, le troisième par Jeanne Dandoy et Jean-François Ravagnan, et le dernier par Armel Roussel et Vincent Minne.
La disparition de l’homo sapiens
Jacques Delcuvellerie
L’homme occidental actuel, vous, moi, refuse obstinément de regarder en face deux réalités. L’une, certaine et inéluctable : sa propre mort. L’autre, que chaque jour rend potentiellement plus vraisemblable : celle de la fin de son espèce, l’homo sapiens.
La mort individuelle est devenue, comme l’a écrit un anthropologue, « la dernière obscénité » de nos sociétés. Les agonisants disparaissent de notre vue, s’éteignent loin de tous, puis incinérés, dispersés, ne laissent rien à fleurir ou honorer. On ne porte plus le deuil. Jadis, on multipliait les signes visibles d’une perte irréparable ; à présent, on mesure la valeur d’une personne à sa capacité de maîtriser la douleur et de se réintégrer au plus vite dans la course au futur immédiat. L’enfant occidental en sait beaucoup plus et beaucoup plus vite sur la vie sexuelle que sur sa condition fondamentale : mortelle. C’est là une rupture majeure avec plusieurs millénaires et, peut-être, avec la fondation même de l’espèce (l’homo sapiens naît avec l’invention de sépultures et de rites funéraires).
Cette fin, inéluctable, en fonction de laquelle on interrogeait et structurait sa vie, a été remplacée par l’injonction impérative de jouir du présent, autrement dit : travailler éperdument pour tenter de consommer le plus possible.
Cet hédonisme narcissique sur le plan idéologique, cette aliénation dans la marchandise sur le plan pratique, ne nous portent guère à envisager de manière concrète la question actuelle la plus essentielle : la possible disparition de l’homo sapiens.
Depuis que la vie s’est développée sur la Terre, 99 % des espèces inventées par la nature ont été anéanties. Du 1 % restant qui constitue notre biosphère actuelle, beaucoup s’éteignent désormais à vitesse accélérée. Si rien de radical n’est entrepris, les savants prédisent, par exemple, la disparition totale des poissons avant cinquante ans. Si l’on ajoute à la catastrophe climatique en cours (et au retard incommensurable entre les faibles mesures envisagées et le temps de réaction des forces naturelles) d’autres facteurs vitaux — la croissance exponentielle de la population mondiale, la fin du pétrole et des énergies non renouvelables, la crise alimentaire, la compétition entre l’empire des États-Unis déclinant et les nouvelles grandes puissances émergentes — on retrouve une configuration qui nous a jadis donné deux guerres mondiales. Cette fois, avec un arsenal nucléaire très dispersé, à disposition dès le départ, et maintenant capable d’anéantir toute vie humaine plusieurs dizaines de milliers de fois. La peur salutaire de l’humanité et la mobilisation massive à l’encontre des armes atomiques (années 1950 – 1960) ont fait place à une totale apathie. Par un aveuglement proprement insensé, nous avons chassé de notre pensée la réalité de ces milliards de tonnes d’explosifs et de leur utilisation potentielle. L’homme est pour la première fois devant cette responsabilité terrifiante : il dispose des moyens de s’anéantir.
Nous n’opposons plus que le pari lénifiant « qu’ils ne le feront pas », dont on voit fort mal pourtant sur quoi il se fonde, connaissant nos précédents et notre actualité.
Enfin, tout ceci se dispose dans un temps où l’homme a aussi commencé à investir le « laboratoire » même de la vie, et notamment celle de son espèce : le génome humain. Avec toutes les manipulations qui peuvent s’ensuivre. Le cauchemar de Frankenstein se matérialise : croisement de gènes d’araignée et de chèvre, clonage, marketing de matrices porteuses, agences de donneurs, femmes fécondées par le sperme de défunts — un vaste commerce se développe à toute vitesse, qui touche à notre identité même. L’homo sapiens se dote rapidement des outils d’une intervention directe sur sa propre évolution. Et ceci n’advient pas dans un contexte scientifique ou industriel abstrait, mais dans le monde que nous vivons : une planète déchirée de conflits, engagée dans une course folle à la compétition concurrentielle, et — comme les chiffres l’attestent année après année — où l’écart entre riches et pauvres se creuse vertigineusement. L’exploitation de la science s’inscrit là.
Ainsi, entre désastre écologique accéléré, possibilité militaire de s’anéantir, et possibilité scientifique de se modifier fondamentalement, l’homo « sapiens » affronte d’ores et déjà des défis vitaux pour sa survie, sans être pour autant plus sage qu’en 1914 ou 1936, comme en témoigne avec un éclat sinistre chaque moment de crise.
Les artistes ne sont ni les juges ni les leaders de l’action humaine, mais nos prochaines créations se tiendront sur le terrain de ces défis. Ce cycle de spectacles prend — de surcroît — pour hypothèse que l’homme s’est aussi diminué, érodé, effrité intérieurement ces deux derniers siècles. Ce dont, à notre avis, témoigne notamment tout le mouvement romantique et contre quoi, en même temps, sans le savoir peut-être, il s’insurge. C’est pourquoi Fare Thee Well Tovaritch Homo Sapiens sera constitué d’une suite d’expériences et de créations à la fois biographiques, réalistes, documentaires et passionnément romantiques.
Premier volet : UN UOMO DI MENO
Jacques Delcuvellerie et Raven Ruëll
Outre la référence centrale à Pier Paolo Pasolini, UN UOMO DI MENO est un hommage indirect à Carmelo Bene pour avoir inventé un des plus beaux titres de théâtre pour son Hamlet, homme déchiré entre deux époques par excellence : UN AMLETO DI MENO.
L’œuvre empruntera la forme, plus ou moins perturbée, d’une biographie. Celle d’un homme né à la fin de la deuxième guerre mondiale et agonisant dans le début du XXIe siècle. Le titre UN UOMO DI MENO est à entendre à deux niveaux : un homme, un être singulier va mourir ; une espèce d’homme, l’Homo Sapiens pourrait muter ou s’anéantir.
Pour la dernière fois, « quelqu’un » qui a connu les ruptures sociétales du xxe siècle, les a non seulement vécues plus ou moins passivement mais a participé activement à certaines d’entre elles, parle et s’expose devant d’autres ayant plus ou moins son âge, contemporains de ce même moment, et d’autres encore, descendants, sinon peut-être ou jamais : héritiers. Pour en réveiller le goût, l’odeur, les sensations, les peurs et les espérances, l’enthousiasme et la désillusion, le dégoût et le regret, la nostalgie et l’exécration.
Cette « biographie », réaliste et rêvée, extrêmement personnalisée, et en même temps projection collective, ne veut pas seulement être l’occasion de rendre vie aux bouleversements de ces décennies au prisme d’une vie particulière, mais évoquer concrètement, dans l’ordre de la sensibilité sensorielle, les changements qu’ils ont entraînés.
Un homme âgé, Pasolini jeune, une femme très âgée, une pin-up des années cinquante, des gens plus jeunes, des fantômes, la radio (on disait TSF), des parfums (la cire, la chicorée, l’encens), un contre-ténor baroque, un banjo cinq cordes, du pain chaud, du riz, des photos de famille entre trois guerres, des voix (de St John Perse à Bob Dylan), des voix humaines …