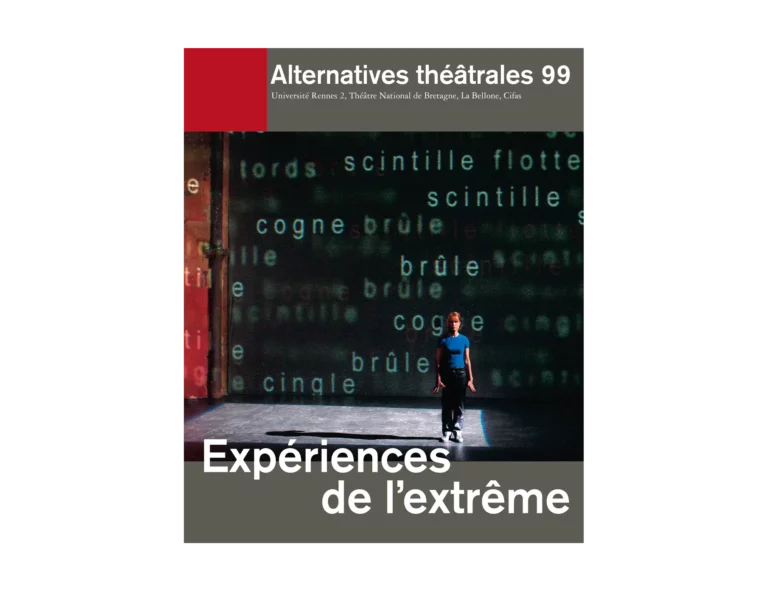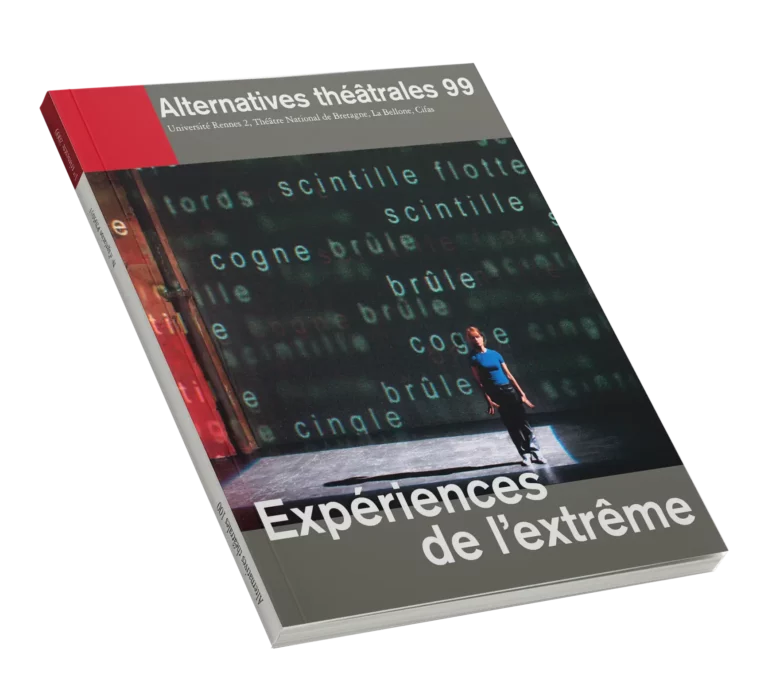« Historiques, ces Tragédies romaines ! » disais-je en sortant à Avignon du Gymnase Gérard Philipe. « Sublimissimes », relayait un amateur fervent. « Ça rend intelligent », poursuivait un autre… Sur ce fond de confiance, la réputation des Tragédies se diffusait, comme une traînée de poudre.
Ivo van Hove réunit dans un « cycle », reprenant le principe des « séries » télévisuelles, les trois grands textes shakespeariens inspirés des guerres et passions romaines : Coriolan, Jules César, Antoine et Cléopâtre. Il cherche, six heures durant, non pas tant à proposer une lecture des Tragédies — il s’inscrit explicitement dans la lignée de la « contemporanéisation » de Shakespeare initiée par Jan Kott — mais à s’attaquer à une question plus insidieuse, essentielle et inédite : celle du regard actuel porté sur le politique devenu notre quotidien. Et pour y parvenir, il rompt, il décadenasse le pacte de clôture, le pacte de séparation acteurs-spectateurs qui règne dans toute salle de théâtre.
La frontière persiste, mais devenue poreuse, trace inopérante d’un ancien interdit, elle ne garde plus qu’une simple valeur résiduelle. Les spectateurs d’emblée sont conviés sur le plateau pour consommer, café, bière ou gâteaux, mais surpris par la brièveté de l’intervalle qui leur est accordée, ils y restent parfois, tandis que d’autres, toujours dans la salle, n’ont pas quitté leur place. Une incertitude s’instaure et, malgré elle, le récit des Tragédies s’engage et ensuite se poursuit. Des spectateurs sont assignés sur le plateau, et, assis sur des canapés face à de petits écrans de télévisions, ils suivent les événements de la pièce alors que les autres, les spectateurs restés dans la salle, voient en direct le récit joué par des comédiens qui adoptent la réserve d’un subtil jeu cinématographique. En divisant ainsi le public, Ivo van Hove écarte la crispation et le regard focalisé pour instaurer une écoute flottante.
Non pas l’écoute du psychanalyste des confessions du patient sur le divan mais l’écoute actuelle, exercée dans tant de foyers, où, sur les écrans jamais éteints, se déroulent et se succèdent, sans discontinuité, les sagas de nos temps modernes. Elles n’appellent pas la concentration de jadis et les jeunes ne craignent plus ni l’interruption, ni la discontinuité : une nouvelle écoute se fait jour. C’est ce que les Tragédies parviennent à mettre en place : le regard actuel sur l’information. Ce n’est pas le discours sur Shakespeare qui préoccupe ici en premier, mais la mutation concernant la manière de recevoir l’Histoire. L’effet contemporain provient de là et il est révélateur. L’Histoire n’a plus rien d’intimidant, nous sommes ses proches témoins, passionnés et/ou indifférents.
Les Tragédies apportent une réponse nouvelle, modulée et actualisée à l’ancien projet de la distanciation, réduit à l’origine, chez Brecht, à une simple alternance mécanique des mots et des chants. Cette fois-ci, elle fonctionne de manière fluide, constante, en permettant tantôt l’éloignement tantôt l’émotion la plus vive sans procéder néanmoins à des ruptures agressives et explicites. Distanciation en mouvement, alternance dynamique d’implication et d’écart, construction élaborée par chacun au sein du dispositif global mis en place. Personne n’est prisonnier, à nous d’assumer la liberté qui nous est collectivement accordée. À nous, individuellement, de prendre les décisions.
Ivo van Hove accorde au spectateur le droit à la détente et aux plaisirs culinaires que Brecht avait tant vantés dans le théâtre oriental ou au… cabaret. L’exemple de Shakespeare peut être également invoqué car au Théâtre du Globe aussi on mangeait et on buvait. Ainsi ce qui semble être simple reprise de la conduite du téléspectateur rejoint les modèles anciens sacrifiés à la fin du XIXᵉ siècle par Wagner. Ce spectacle ne nie pas le corps des spectateurs, mais ne fait pas non plus l’économie de leur intelligence. Nulle loi, nulle autorité ne s’impose impérativement au public. Rien n’est préétabli ici. « De mon regard, de ma place, je suis, moi, le spectateur, responsable », vœu brechtien enfin exaucé. « J’appartiens à la communauté du public tout en étant invité à inventer mon parcours, à me procurer des plaisirs, à me déplacer et à choisir ma place jamais attribuée à l’avance. Je ne suis plus spectateur soumis. »
Truffé de télés, de canapés et bordé d’un bar, le plateau permet l’accès des spectateurs qui y sont invités tout autant que la proximité maximale avec les interprètes. Cette relation intime procure toujours une indéniable fièvre : le voisinage avec le comédien qui incarne le protagoniste de l’histoire ne laisse pas indifférent. « Comme j’ai été heureux de me trouver à côté de Brutus, ce Che Guevara de Rome ! » Mais ensuite, en changeant de place, en regardant de la salle, quelle satisfaction d’épier le plateau sans pouvoir distinguer aisément les acteurs et les spectateurs. Ils se confondent presque. Leçon d’humilité pour les héros placés parmi ces figurants de l’Histoire que nous sommes. Du dehors, rien ne nous départage. Quelle subtile ambiguïté !
Les Tragédies romaines invitent aussi à prendre la mesure de l’écart entre l’acte et son écho médiatique. Depuis Sellars et Castorf, la présence des cameramen sur le plateau, symptôme inventorié de la modernité, ne surprend plus. Ici aussi, une jeune femme capte le spectacle et place constamment les héros sous l’œil de la caméra. Leurs gestes et leur corps apparaissent agrandis sur l’écran aux proportions démesurées dressé en direction de la salle aussi bien que sur les petits écrans que peuvent consulter les spectateurs disséminés sur le plateau. La retransmission rend épique, dilate et agrandit la présence des protagonistes qui, de la salle, sont parfois difficilement repérables sur le plateau mais restent tellement visibles sur l’écran. Les héros en chair et en os disparaissent parmi les spectateurs. Nous ne savons plus toujours où ils se logent, tapis comme des terroristes dans les abris, mais la caméra est là pour les localiser et identifier leur présence. Nul moyen de lui échapper. Ses pouvoirs sont démesurés. Ainsi les Tragédies révèlent le rapport entre la dimension parfois secrète, à peine décelable, d’un acte, d’un être et sa résonance énorme dans le monde, grâce aux médias.
Ainsi nous, spectateurs, nous sommes également les témoins du « local » minoritaire propre au théâtre et du « planétaire » propre à la télévision. Mais en même temps, insistons là-dessus, celle-ci dépend des actes accomplis par des personnages qui agissent, car lorsque le spectacle s’interrompt ponctuellement, les écrans restent vides. Sans les humains, pas d’émission ! Signe discret d’optimisme : nous sommes encore nécessaires. Ensuite, après de telles syncopes, le théâtre peut miraculeusement reprendre et, de nouveau, il alimente les médias. Quand même il leur faut toujours du vivant, même microscopique, dispersé, caché.