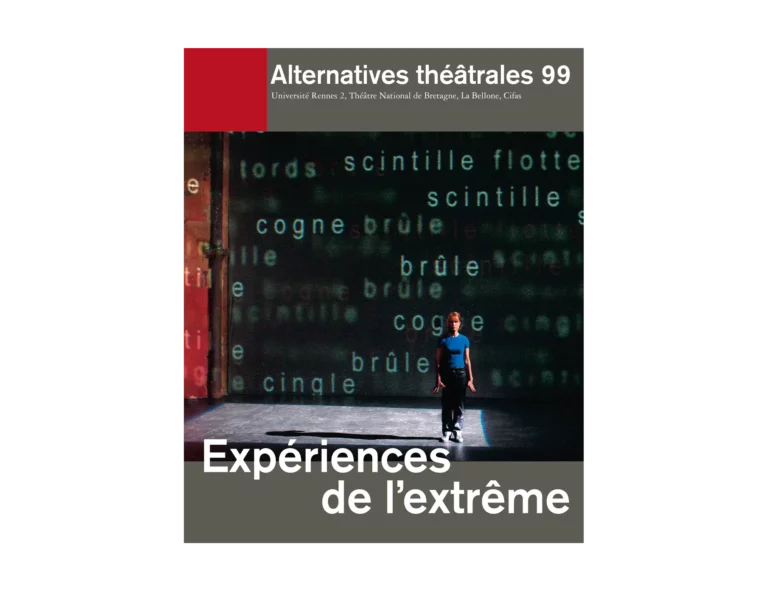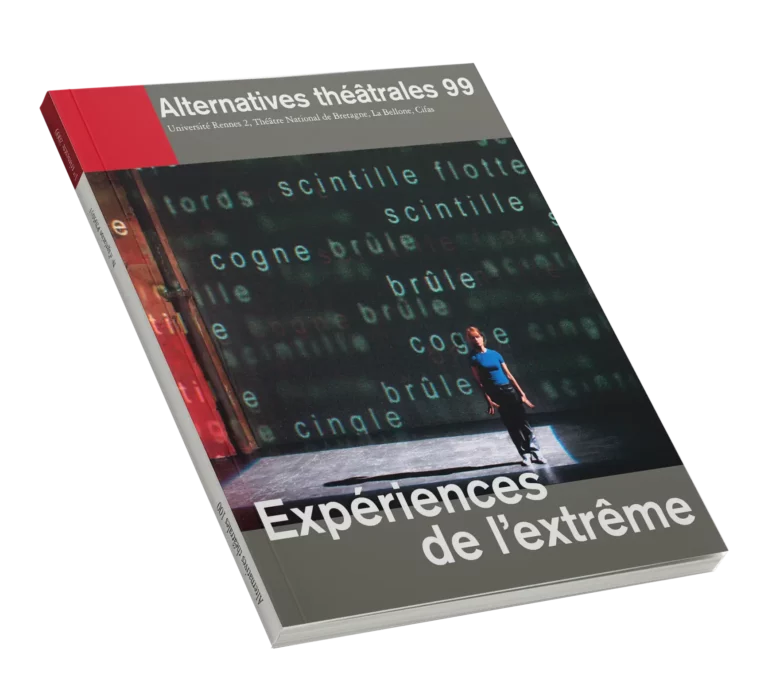« Ce soir je veux parler de la mort », proclame le Holopherne de Howard Barker à l’ouverture de Judith. Faire du théâtre, c’est parler de la mort. Réactivé par le contexte de l’après-1945, l’enjeu métaphysique — qui est l’essence même du théâtre — prend un tour obsessionnel.
Dès 1958, Beckett écrit dans Fin de partie : « Tout pue le cadavre. » Cette affirmation ne cesse de ricocher : Edward Bond fait dire au Premier Homme de La Furie des nantis : « Je sais que vous êtes des hommes parce que vous avez forme de cadavre. »1
Le cadavre est là, qui nous renvoie à notre culpabilité : pourquoi n’avoir rien fait ? Si on est en vie, est-on coupable ? Les millions de cadavres sont là, impossibles à enterrer, comme Amédée dans la pièce éponyme d’Ionesco. « Comment s’en débarrasser ? », c’est la question que pose Vladimir Jankélévitch dans L’Imprescriptible.2
Plusieurs raisons d’ordre littéraire peuvent expliquer que, peut-être plus que d’autres, le théâtre anglais contemporain rebrasse compulsivement les problématiques macabres et fondatrices de ce qu’on appellera, après Adorno, « l’après-Auschwitz ». Avant tout, les dramaturges anglais sont les héritiers directs de ce théâtre néo-sénéquien qu’est la tragédie élisabéthaine puis jacobéenne : ses excès de violence, certes, mais aussi sa conscience paradoxale des limites du langage. Lorsque Lear entre en scène avec le corps inerte de Cordélia dans les bras, hurlant comme un loup, il pleure déjà l’impossible du langage, la mort du langage.
En outre, plus directement qu’aucun autre, le théâtre anglais contemporain s’inscrit dans la trace nihiliste de T. S. Eliot, poète de The Waste Land ; enfin, et surtout, il a subi l’influence de l’Irlandais Samuel Beckett, dramaturge de toutes les catastrophes — celui chez qui les paradigmes de la Grande Famine et de la Shoah se rejoignent, le pionnier d’une dramaturgie de « l’après-Auschwitz ».
Le parcours que l’on propose ici s’arrête sur des pièces qui s’inscrivent toutes dans un espace dévasté par la destruction de masse. Leurs auteurs donnent à voir des espaces scéniques post-apocalyptiques, surgis des spectres d’Auschwitz et d’Hiroshima.3 Adorno fait d’Auschwitz — paradigme de la mort à haut débit et à rendement maximum — le symbole de la coupure historique entre « une » barbarie et « la » barbarie. Avec Auschwitz, la mort est traitée comme un produit industriel. L’humanité se découvre une inhumanité insoupçonnée. La philosophie achoppe sur cet impensable, cet « inconsolable de la pensée », pour le dire avec Myriam Revault d’Allonnes.4 L’art entre en aporie.
C’est cette aporie, éthique et esthétique, que le théâtre contemporain entreprend de ruminer — et peut-être de dépasser — en montrant que, si sur la scène anglaise le mort inscrit un espace de deuil, c’est précisément parce qu’un deuil, c’est toujours, quand il est fait, un redémarrage, une refondation. Qu’il soit fantomisé, abstrait, métaphorique ou présent sur la scène, le mort fonde la catastrophe, et la catastrophe est le lieu de l’épiphanie. C’est par elle, et grâce à elle, que le vivant advient.
Le mort-témoin
C’est d’abord cet impossible témoignage de l’expérience de la mort qui est recherché : ce qui guide les personnages et structure Naître d’Edward Bond, c’est la quête d’une parole orphique :
« Luke : Je veux savoir : comment c’est à la fin ? Le corps, je sais ce qui lui arrive. Je sais tout ça. Je l’ai vu. Je veux savoir comment c’est dedans. Ce qui se passe dans la tête à la fin. Où c’est qu’on est. Tu vas me le dire. »5
Naître est sans doute l’une des pièces où l’on voit le plus de morts sur le plateau : depuis l’empilement de Hamlet, on avait rarement vu autant de cadavres. La scène cinq, véritable point d’orgue de la pièce, montre en un tableau inoubliable le personnage de la mère — Donna, la bien nommée — distribuer une étrange soupe de détritus aux morts qui jonchent le sol et qu’elle materne comme s’il s’agissait d’enfants dans un orphelinat.
« La pièce. Les murs sont noircis et constellés de trous de balle. Contre le mur, le matelas s’est affaissé. Il est rayé de noir et déchiré par les balles. Des caillots de rembourrage pendent comme des entrailles. […] Les morts sont dispersés sur le sol. Ils sont couverts de vêtements sales, de chiffons et de quelques couvertures. Leurs blessures mortelles sont vieilles et séchées. Une lumière froide vient de la porte ouverte. »
Donna, off : Bien bouilli. Pause. Prêt maintenant.
C’est prêt.
Pause. Donna entre par la porte intérieure. […]
Elle tient une louche et une soupière de détritus.
Donna, cognant la louche contre la soupière. C’est prêt, c’est prêt. Voilà. Elle pose la soupière sur la table.
Elle mélange avec la louche. Pauvres petits. Je vous ai fait attendre. Quelques minutes seulement mais vous croyez que c’est pour l’éternité.
Donna se déplace parmi les morts, sortant des louches de déchets. Une partie tombe sur les morts et leurs vêtements, mais chaque fois qu’elle met la louche dans la soupière elle est presque aussi pleine qu’avant.
Donna. Là. Attention, attention. Bien. Mangez tant que c’est chaud. » (p. 68 – 69).
Le mort, pléthorique, est donc in-enterrable « implantable » (« the corpse you planted last year, has it begun to sprout ?», demande T. S. Eliot dans THE WASTE LAND): on n’est plus dans cette Angleterre — cimetière que découvre Hamlet dans la scène du Fossoyeur, mais dans un pays où l’on ne peut même plus enterre les cadavres.

Cette scène de folie est aussi éminemment lucide : les mères élèvent et nourrissent en effet des cadavres dans le monde autodestructeur dénoncé par Bond. À ce didactisme insistant s’oppose la rencontre avec les fantômes qui prolifèrent dans ses pièces : Bond leur donne un corps que rien ne différencie de celui des vivants, comme celui du Fils du fossoyeur dans Lear, ou le corps curieusement martyrisé du Monstre dans les Pièces de guerre — le fantôme adulte de ce que serait devenu, s’il avait grandi, le fœtus livré à la fournaise du monde en guerre —, un corps fantômisé comme cette pietà sortie des camps de concentration dans Auprès de la mer intérieure. Ces fantômes-martyrs occupent la scène de toute leur corporéité en décomposition pour témoigner. On rappellera, avec Giorgio Agamben, l’étymologie du terme « martyr », du grec martus, qui signifie un « témoin », substantif venant du verbe signifiant « se rappeler » ; le martyr « rescapé » (ou paradoxalement ressuscité à une vie fictive, comme c’est le cas ici) « a vocation de mémoire. Il ne peut pas ne pas se rappeler », dit Agamben6. Ces martyrs permettent de faire entendre les voix sépulcrales ; ils donnent chair à la parole ensevelie à jamais de ceux qui n’ont pas survécu : le miracle du théâtre est celui-ci : il invente ou donne à entendre une parole d’outre-tombe ; la tragédie, dira Barker, « ôte à la mort les mots de la bouche »7.
Le Monstre des Pièces de guerre est ce témoin-martyr : il incarne le monde martyrisé. Le Monstre s’acquitte de cette fonction de mémoire en provoquant un choc frontal double : visuel d’abord, verbal dans un second temps. Son entrée sur scène heurte le spectateur de plein fouet, selon la manière prônée par Artaud. Son corps calciné inscrit la douleur dans sa chair :
« La peau du Monstre, ses cheveux, ses vêtements sont grillés, carbonisés, entièrement noirs. Qu’il apparaisse comme taillé dans un morceau de charbon. Ses cheveux, hérissés, des pointes raides, se dressent comme des clous. (Le Monstre peut également être entièrement en rouge.) »
Le choc est, dans un deuxième temps, verbal, puisque l’espace linguistique qu’occupe le Monstre est à plusieurs titres transgressif : ontologiquement transgressif, car le Monstre — fœtus mort-né, in/ans doublement privé de parole — est pourtant doté d’une parole qui nous atteint puisqu’il parle la même langue que nous et s’adresse, sur le mode de l’agit-prop, directement au spectateur. Éthiquement transgressif, puisqu’il en sait plus que nous, raisonne et incarne toutes les valeurs humanistes auxquelles nous avons du mal à renoncer : « Nul ne peut délibérément renoncer au nom d’humain » est le titre du huitième tableau de Rouge, noir et ignorant. Le Monstre illustre parfaitement la double étymologie latine du terme et n’intervient auprès de nous, le public, pour rien moins que commenter, raconter, expliquer, avertir : « Maintenant nous allons montrer des scènes de la vie que je n’ai pas vécue », annonce-t-il8. Le Monstre — celui qui est montré — entreprend donc de « montrer » et, par là, d’avertir (monere) le monde. Il s’apparente presque au principe tragique du monstrum aristotélicien, qui doit avoir lieu puisque c’est un avertissement des dieux, et qui s’oppose à l’obscène qu’il convient de cacher. Déchiffreur dans « la forêt de symboles », décrypteur des correspondances, traducteur de la langue des morts, le Monstre se constitue bel et bien en poète, au sens plein et fort que Baudelaire donne à ce mot. On se rappelle John Clare qui déjà déclarait : « Je suis un poète et j’apprends aux hommes à manger. »9
Le mort chez Bond est toujours celui grâce auquel se jauge le degré d’humanité de l’homme. Autrement dit, le mort est le lieu de l’éthique et donc de l’humain. Le corps du mort sur la scène bondienne est un exhausteur de vivant, au sens où l’on parlerait d’un exhausteur de goût. Il rend visible la prise de conscience éthique. Le corps du mort est l’avoir-lieu du vivant.
Barker et l’érotisme
Exhausteur de vivant d’un autre ordre chez Barker, le mort exacerbe les principes de vie : la problématique éthique et philosophique s’incarne dans des enjeux plus pulsionnels. Le mort, son corps, sa présence, l’expérience de sa mort, sont centraux dans le volume d’aphorismes La Mort, l’unique et l’art du théâtre, qui théorise les enjeux scéniques du théâtre de la Catastrophe.
« Toute tragédie incite voluptueusement la mort à se montrer. Elle la pousse à faire ce qu’elle fait de pire. Ce faisant, ce pire se révèle moins terrible que ce qu’on avait imaginé. La tragédie la plus grande va plus loin. Elle fait de la mort une nécessité, une perfection même, et pas seulement pour les vieux, les malades ou les faibles, mais pour les agiles, les vigoureux et les bien-portants. Est-il possible d’aller plus loin ? De se demander si la mort n’appartient pas de prime abord aux plus forts ?
[…]
Le corps mort est un objet de fascination à la fois dans la vie et dans l’art. De plus, sa décomposition hypnotise. Au théâtre, le corps vivant doit représenter le cadavre, il ne peut pas l’imiter. Pour ce faire, il reste étendu sans bouger. C’est le peu que l’on sait de la mort, et peut-être ne savons-nous que cela, que les morts restent étendus sans bouger… »
Cette fascination pour le corps mort — que l’on observe, que l’on dissèque (Faux Pas), que l’on mange aussi (Trouvé dans le sol), surtout quand il s’agit du corps de nazis notoires — est omniprésente dans le théâtre de la Catastrophe. Le corps mort y est un fort déclencheur de vie : science, regard, nourriture et surtout libido. Il provoque une pulsion érotique incontrôlable, véritable topos dans le théâtre de Barker (Gertrude, Mains mortes, etc.), dont le parangon est la scène de nécrophilie dans Judith, pulsion qui est également tout entière tendue vers la vie. Le corps du mort occupe en principe le centre de la pièce dont il est la paradoxale matrice. Dans le verger d’Elseneur, c’est au-dessus du cadavre tout juste empoisonné du vieil Hamlet que s’accouplent Gertrude et Claudius :
«(Gertrude inclinée, provocante, se place au-dessus de la tête de l’homme endormi)
Gertrude : Empoisonne-le
(Claudius va embrasser Gertrude. Elle ferme les yeux, détourne le visage)
Empoisonne-le
(Claudius prend une fiole dans son habit. Il s’agenouille à côté de l’homme endormi. Il verse le liquide dans l’oreille de l’homme.
Gertrude, dans son extase, paraît vomir. Son cri se mêle au cri de l’homme endormi qui tressaille)
Baise-moi
Oh, baise-moi
(Claudius et Gertrude s’accouplent au-dessus de l’homme qui agonise. Tous les trois font entendre une musique des extrêmes. Un serviteur entre en tenant un vêtement et se poste en attente)»
Grand lecteur de Bataille, Barker en teste sur la scène-laboratoire les implications pratiques. L’extase et la mort sont indissociables. On rappellera les propos de Bataille : « l’érotisme ouvre à la mort […] il est l’approbation de la vie jusque dans la mort »10. Le cri de Gertrude dans la pièce éponyme — cri de douleur et de jouissance orgasmique (petite mort) à la fois — opère la fusion de ces deux contraires et résume l’essence tragique de l’existence :
Claudius : Le cri, Gertrude.
« Je dois faire surgir ce cri de toi à nouveau même s’il pèse cinquante cloches ou mille carcasses il me le faut IL TUE DIEU »11
Le corps n’est pas seulement le lieu de la douleur et donc de la révélation, il devient paradoxalement celui de la transcendance.
Par ailleurs, chez Barker, le corps du mort, c’est aussi le texte mort : sa pratique littéraire, qui sollicite sans cesse les modèles — la Bible, la mythologie, le conte de fées, Shakespeare, Middleton —, est une pratique, post-postmoderne s’il en est, fondée sur la réappropriation des modèles. Le corps mort du texte est une invitation à la recréation : la réécriture palimpsestueuse de l’hypotexte est source de vie dans un élan qui a fort à voir avec la « mort-renouveau » dont parle Bakhtine dans La Poétique de Dostoïevski. Ce qui, chez Barker, est thématisé au plan de l’érotique des personnages, doit se lire comme une clé poétique qui donne accès à son œuvre : la nécrophilie thématisée, représentée, est ce qui donne sa forme à l’écriture. La pulsion érotique se lit donc au double plan du thématique et de la poétique qui l’informe.
Aussi différents que soient Bond et Barker, tous deux inscrivent un théâtre du voir, un théâtre qui s’articule autour de l’explicite du cadavre où le mort montre et refonde l’humain. Cependant, comme l’explique Barker dans La Mort, l’unique et l’art du théâtre, « le cadavre n’est pas la mort, seulement le détritus de la mort… ». À l’inverse, la scène anglaise excelle à travailler plus en finesse, dans l’interstice, dans la non-représentation. À la suite de Beckett — chez qui le mort n’est jamais présent en scène, contrairement au mourant, comme Winnie enfoncée dans son mamelon, la protagoniste de Rockaby, etc. —, Harold Pinter et Martin Crimp proposent des œuvres où le mort et son corps, absents, contaminent l’espace textuel.
Dibbouk et possession