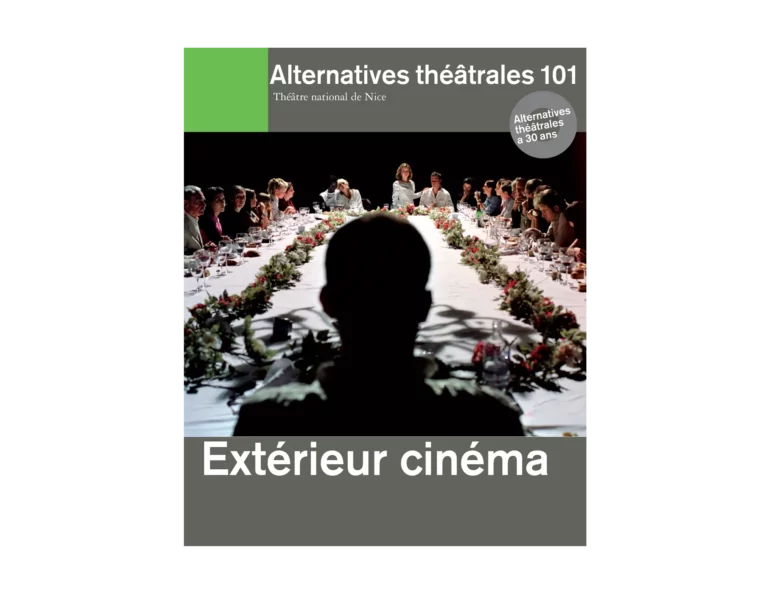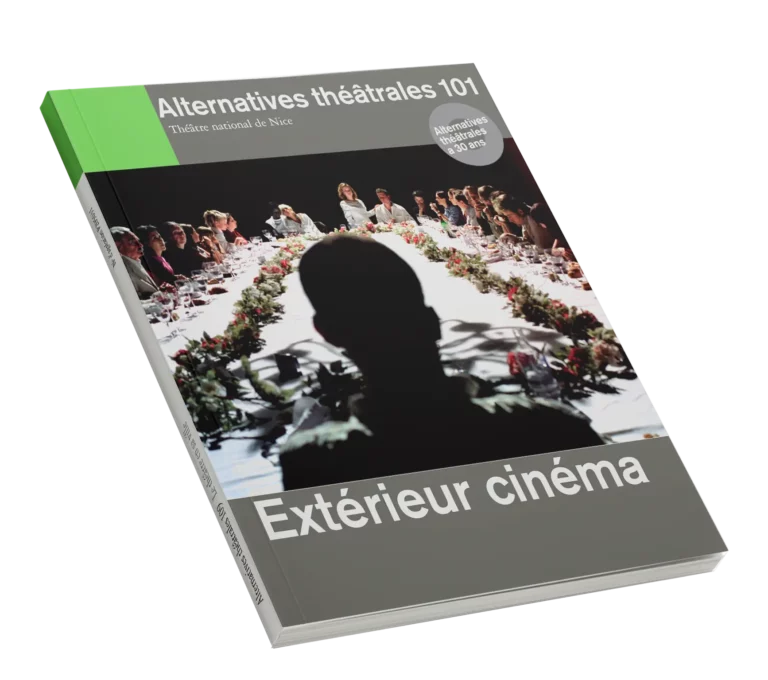L’été dernier, les spectateurs du Festival d’Avignon s’enthousiasmaient pour les « Tragédies romaines » d’Ivo van Hove. Durant six heures puissantes et ludiques, le metteur en scène belge néerlandophone développait une audacieuse dramaturgie, où les rapports salle/scène se réinventaient pour aborder le discours politique d’aujourd’hui à travers les mots de Shakespeare. Georges Banu avait alors souligné que le spectacle offrait au public une place inédite et restituait « en acte, le regard contemporain sur l’Histoire »1. Ce coup d’éclat magistral du metteur en scène, par ailleurs directeur du Toneelgroep d’Amsterdam2, met aujourd’hui en lumière un travail riche de plusieurs dizaines de spectacles depuis 1981, moins connu du public francophone que celui de ses contemporains Jan Fabre ou Guy Cassiers3, et au cœur duquel le cinéma occupe une place toute particulière.
En parallèle à des choix aussi hétéroclites que La Dame au camélias de Dumas, Lulu de Wedekind, Dans la solitude des champs de coton de Koltès, Le Misanthrope de Molière ou plusieurs opéras dont le cycle complet Der Ring des Nibelungen de Wagner, on retrouve dans la liste de ses créations théâtrales Faces et Opening night de John Cassavetes, Teorema de Pasolini, Scènes de la vie conjugale de Bergman, ainsi que des projets au carrefour du théâtre et du cinéma puisque leur adaptation à l’écran a tellement marqué les esprits que nous ne lisons plus les textes de la même manière depuis (Un tramway nommé désir de Tennessee Williams ou India Song de Marguerite Duras).
Parmi les créations de cette saison 2008 – 2009 mises en scène par Ivo van Hove au Toneelgroep d’Amsterdam, figurent un Antonioni Project (d’après L’Avventura, La Notte et L’Eclisse) ainsi que Rocco et ses frères de Visconti et Cris et chuchotements de Bergman.

Expliquant le projet de ses Tragédies romaines lors de la conférence de presse du Festival d’Avignon du 11 juillet dernier, Van Hove s’était référé au Vérité et politique4 d’Hannah Arendt et avait fait l’éloge du compromis : « Je crois que le compromis est une très belle chose. C’est très différent de la concession. Il s’agit d’apprendre à être d’accord, d’essayer de vivre ensemble ». Dans un quartier d’Anvers où il vivait dans les années 1970, Ivo Van Hove nous explique, sans concession aucune, l’art du compromis de ses adaptations cinématographiques à la scène.
Antoine Laubin : Dans les Tragédies romaines, le spectateur était invité à déambuler librement sur le plateau parmi les acteurs. À de multiples endroits de la scène, des téléviseurs étaient placés afin de permettre aux spectateurs, où qu’ils se trouvent, de suivre l’action principale, les acteurs étant constamment filmés en direct. La dernière partie du spectacle, en contraignant le spectateur à quitter le plateau et regagner le gradin, pouvait être perçue comme une affirmation de la puissance « supérieure » du théâtre : pour l’issue d’Antoine et Cléopâtre, le téléviseur et ses plans serrés ne suffisaient plus, il fallait voir l’ensemble de la scène. Comment comprendre cela, en vis-à-vis de votre démarche d’adaptation cinématographique et de l’utilisation récurrente de la vidéo dans vos spectacles ?
Ivo van Hove : La vidéo est pour moi un outil théâtral de notre temps, comme le masque par exemple au temps de la tragédie grecque. Le théâtre a toujours utilisé les techniques disponibles dans la société de son temps. La vidéo n’est rien d’autre qu’un de ces moyens. Je crois qu’on devrait toujours l’utiliser en tant que moyen, comme la lumière par exemple, dans une optique très réfléchie. Pour ma part, j’utilise toujours la vidéo uniquement pour filmer les acteurs sur scène. La scène jouée en direct reste toujours en coprésence des écrans qui la diffusent. Le fait de jouer au théâtre est pour moi la forme artistique la plus puissante de ce siècle parce qu’elle a lieu en direct : les acteurs sont présents et nous en sommes les témoins. Que quelque chose ait lieu en direct est très important aujourd’hui. Les gens sont assis derrière un ordinateur toute la journée, ce qui est une sorte d’aliénation. Je crois vraiment que le théâtre sera la plus puissante des formes artistiques dans les décennies à venir. Je crois que le théâtre n’est pas du tout démodé. Les gens ne peuvent pas trouver ailleurs ce que le théâtre offre. Un film ne sera jamais vivant. Il est le même ici, à Hong-Kong et partout sur la planète. Quand on joue au théâtre, la représentation ici cet après-midi ne sera pas la même que celle de demain soir ; l’actrice sera peut-être nerveuse demain, elle ne sera jamais la même et son public sera toujours témoin de ces éléments en provenance de la « vraie vie ». La vidéo est pour moi un moyen de rendre le direct encore plus puissant. J’utilise la vidéo pour tenter de tout montrer dans les détails, que le public soit véritablement témoin de tout ce qui se passe sur scène. Mon prochain travail sur Cris et chuchotements de Bergman utilise aussi de la vidéo. Au centre de la pièce, une femme est en train de mourir. Le scénario mentionne qu’il s’agit d’une artiste qui écrit un journal, une sorte d’auteur. On a donc choisi de faire de son journal un journal vidéo, tourné en direct.
A. L. : Votre point de départ dans l’adaptation des films que vous choisissez est-il le film en tant qu’objet artistique « fini », c’est-à-dire incluant le découpage, les mouvements de caméra, etc. ou le scénario original de ce film ?
I. v. H. : Je pars toujours du texte original ou de la transcription textuelle du film. Le film en lui-même n’est pas important pour moi puisqu’il a déjà été fait. Je ne revois donc jamais les films sur lesquels je travaille. Par exemple, je n’ai jamais vu Opening night. Le travail de Cassavetes m’était familier par ailleurs, mais je n’avais jamais vu ce film ; on m’a conseillé d’en lire le texte quand je travaillais sur Faces.
A. L. : Est-ce le cas également pour les films d’Antonioni ?
I. v. H. : J’ai vu tous les films d’Antonioni quand j’avais vingt ans. J’étais vraiment jeune et je ne les ai pas revus depuis.