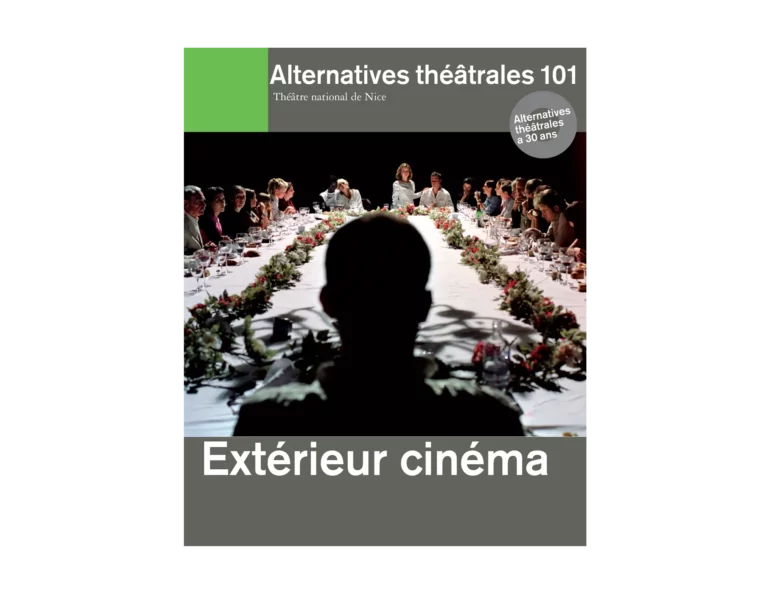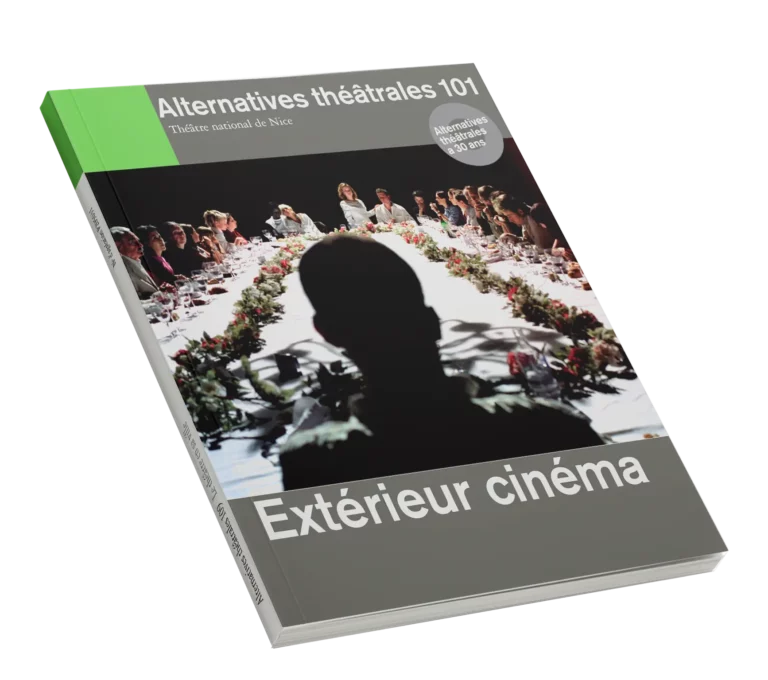DÈS SES DÉBUTS, les scénarios d’Ingmar Bergman ont, par leur écriture, incité les metteurs en scène de théâtre à transposer son travail à la scène. Ainsi, en 1948, Peter Ustinov a adapté le scénario du film de Bergman FRENZY (1944, HETS, Tourments) au St. Martin’s Theatre à Londres. La même année, ce film a également été adapté pour la scène au Studio Theatre alors récemment fondé à Oslo. Précisons toutefois que l’adaptation à l’écran de textes littéraires, théâtre compris, était assez fréquente à l’époque ; Bergman lui-même accepta en 1948 une commande du producteur David O. Selznick lui demandant d’écrire un scénario pour réaliser une version américaine filmée de MAISON DE POUPÉE d’Ibsen. Mais il était rare de voir le processus d’adaptation s’inverser et de transposer un scénario, c’est-à-dire un texte conçu pour le cinéma, à la scène. On pourra donc se demander pourquoi le premier scénario d’un réalisateur suédois prometteur avait attiré l’attention au point de le faire resurgir à l’étranger sous la forme d’une pièce de théâtre.
HETS a été réalisé par Alf Sjöberg mais pour l’accueil du film, c’est le scénario sous-jacent de Bergman, imprégné de la voix d’un jeune homme en colère, qui a dicté la réponse du public. Lors de la promotion du film, la Svensk Filmindustri (SF) a insisté presque davantage sur le texte de Bergman que sur la réalisation de Sjöberg ; car avec Ingmar Bergman, elle répondait
à la forte envie de voir apparaître un scénariste qui puisse faire revivre l’âge d’or du cinéma suédois, l’époque où les œuvres littéraires de Selma Lagerlöf constituaient la base des grands films réalisés par Victor Sjöström et Mauritz Stiller. Ce n’est d’ailleurs pas une coïncidence si Bergman a déclaré plus tard que Sjöström était son mentor et il n’est guère étonnant que l’adaptation scénique du scénario de Bergman à Londres et à Oslo, coïncidant exactement avec la distribution étrangère de HETS, ait été saluée par la SF, la grande compagnie de production cinématographique suédoise, comme un évènement promotionnel bienvenu signalant l’arrivée d’un héritier au cinéma. Dès le début, Ingmar Bergman a été en effet l’enfant chéri du bon moment.
Ingmar Bergman n’a pour sa part pas mis en scène HETS au théâtre. Dans les années qui suivirent, il n’adaptera que rarement ses scénarios pour la scène, et ne se montrera pas très enclin à en donner l’autorisation à d’autres. Cela peut sembler étrange si l’on considère la facilité avec laquelle il a évolué entre différentes formes de représentation. Il transforma par exemple LA FLÛTE ENCHANTÉE en pièce musicale à la fois destinée à la télévision et au cinéma et utilisant la scène 17 du Théâtre de Drottningholm pour lieu de sa réalisation. Sa transposition des BACCHANTES d’Euripide a été encore plus complexe. Après avoir annulé deux productions scéniques programmées de cette pièce – l’une en 1954, l’autre en 1987 – il la présenta sous la forme d’une pièce musicale à l’opéra de Stockholm en 1991, puis sous celle d’un opéra télévisé en 1993 et d’une pièce au Théâtre dramatique royal ( Dramaten ) en 1996. Mais il s’était antérieurement inspiré de la pièce d’Euripide pour son propre film de télévision LE RITE ( 1969 ).
À l’occasion, Bergman indiquait que le film et le théâtre n’étaient pas des formes artistiques compatibles, mais il n’établit jamais de théorie à ce sujet. Interrogé un jour sur la raison pour laquelle il n’avait pas filmé LE SONGE de Strindberg, une œuvre dont la fluidité avait souvent était qualifiée de « pré-cinématographique », il répondit : « Je ne pense pas que ce soit possible
de filmer LE SONGE… Tout simplement parce que Strindberg écrit son dialogue de telle façon que son théâtre est si magistral qu’il ne se laissera pas entraîner vers un autre media ». Bergman agissait-il en conformité avec ces mots en rejetant systématiquement les demandes de représentation de ses scénarios sur une scène de théâtre ? Peut-être ; mais il disait aussi de ses textes qu’ils étaient « écrits sans aucune idée prédéfinie de leur moyen de représentation ». Dans MONOLOGUE, un court essai publié en préface du volume LE CINQUIÈME ACTE ( 1994, 2001 ), qui contient également les textes APRÈS LA RÉPÉTITION, S’AGITE ET SE PAVANE1 et UN DERNIER CRI, il déclare à propos du format changeant de son œuvre écrite :
« J’ai écrit comme j’ai coutume d’écrire depuis plus de cinquante ans – cela semble du théâtre, mais pourrait aussi bien être du cinéma, du théâtre ou une simple lecture. APRÈS LA RÉPÉTITION est devenu un film de télévision par hasard, tout comme fut représenté, par hasard, sur scène UN DERNIER CRI ( sous-titré « une moralité légèrement arrangée » ). Mon intention, c’est aussi que S’AGITE ET SE PAVANE soit joué au théâtre. »2
Voilà qui semble certainement détruire toute délimitation stricte de genre entre le cinéma et la scène. Il n’est pas surprenant que les adaptations scéniques des scénarios de Bergman aient commencé à apparaître. Mais Bergman lui-même y était opposé et avant les années quatre-vingt, elles eurent lieu dans des pays qui ne reconnaissaient pas les lois internationales relatives aux droits d’auteur ou dans lesquels un éditeur détenait les droits d’une traduction d’un scénario original de Bergman ; en d’autres termes, dans les cas où Bergman ne pouvait utiliser son droit de veto. L’exemple le plus curieux est la comédie musicale de Stephen Sondheim, A LITTLE NIGHT MUSIC ( Une petite musique de nuit ), basée sur une édition américaine du scénario de Bergman SOURIRES D’UNE NUIT D’ÉTÉ ( 1955 ), toujours non publiée en suédois, et dont la première mondiale eut lieu à Broadway en 1973. Une autre transmutation, une version filmée de la comédie musicale, avec l’actrice Elizabeth Taylor dans le rôle principal sous les traits de Désirée Armfeldt, sortit en 1978, au moment même où l’ancien acteur et ami de Bergman, Stig Olin, mettait en scène A LITTLE NIGHT MUSIC à Stockholm.
La résistance de Bergman aux adaptations scéniques de ses scénarios a légèrement évolué durant ses sept années d’exil volontaire à Munich (1976 – 1983). En 1981, il utilisa une version scénique abrégée de SCÈNES DE LA VIE CONJUGALE dans une production en triptyque au Residenztheater de Munich, qui incluait également NORA (MAISON DE POUPÉE d’Ibsen) et JULIE (MADEMOISELLE JULIE de Strindberg).
Pourquoi Bergman a‑t-il choisi de représenter son scénario (et film de télévision) SCÈNES DE LA VIE CONJUGALE sur scène ? Dans des entretiens de l’époque, il apparaît clairement que sa décision a été dictée par le concept thématique qui régissait l’ensemble de sa production en triptyque : en juxtaposant SCÈNES DE LA VIE CONJUGALE aux portraits de femmes réalisés par Ibsen et Strindberg, Bergman cherchait à exposer la situation maritale et sexuelle des femmes dans un contexte culturel qui avait peu évolué au fil des cent dernières années. Son triptyque n’était pas une entreprise polémique de libération des femmes mais plutôt un exposé psychologique d’un phénomène de statu quo. On lui avait probablement rappelé le débat médiatique qui avait fait rage dans son pays lors de la diffusion télévisée originale de SCÈNES DE LA VIE CONJUGALE en 1973. On peut affirmer que cette pièce de théâtre télévisée, divisée en six épisodes distincts diffusés six mercredis soirs consécutifs, peut être considérée comme la percée populaire de Bergman en Suède à une époque où les téléspectateurs suédois ne disposaient que d’une chaîne de télévision. Pendant les six semaines qu’a duré sa diffusion, le « soap opera » de Bergman a été regardé par un auditoire toujours croissant. Selon des sondages de la presse, sa popularité reposait sur la reconnaissance par le public du conflit marital dépeint (on prétend que l’assistance conjugale et les taux de divorce ont augmenté à la suite du film de Bergman), mais les séries télévisées soulèvent inévitablement des questions sur le rôle des sexes et la situation maritale et professionnelle des femmes. Dans une réponse aux débats médiatiques, Bergman a déclaré que la femme contemporaine se trouvait encore prisonnière d’un esclavage séculaire qu’elle pourrait cependant briser si elle prenait ses responsabilités.