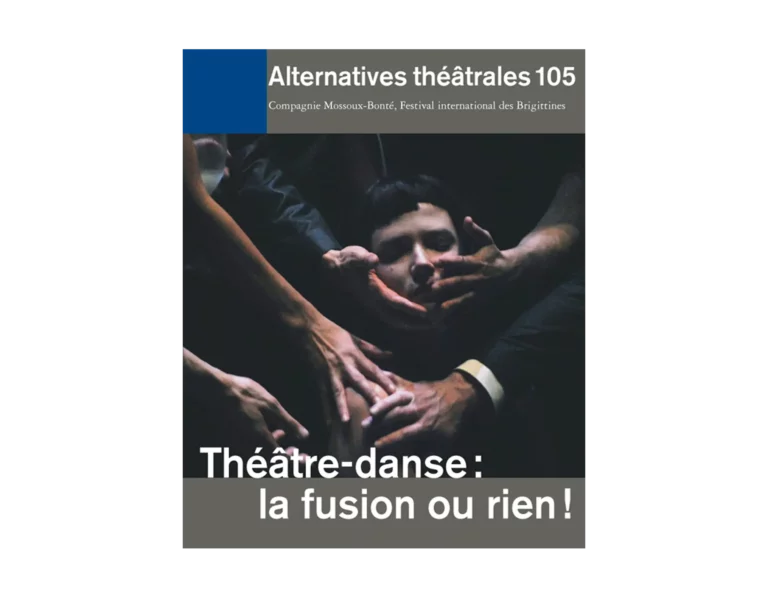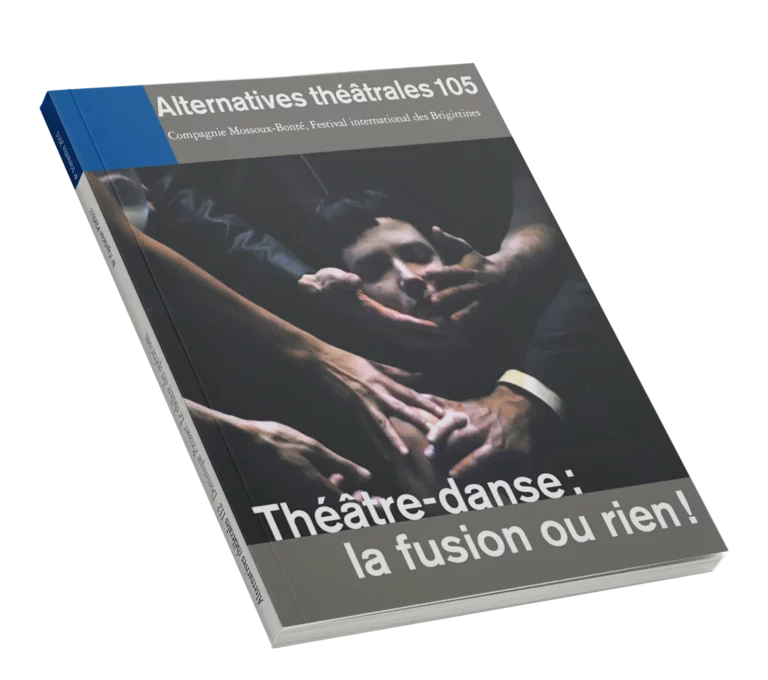ANNE LONGUET MARX : Qu’en est-il de la relation que vous avez posée entre la danse et la peinture et également avec la littérature ?
Odile Duboc : Le rapport à la peinture est une découverte récente pour moi. Bien qu’ayant dansé dès mes plus jeunes années et fait ma première création à l’âge de treize ans, ce n’est qu’en 2003, lors d’une création, TRIO 03, commande de l’Ircam, que je pense avoir découvert l’intérêt d’une relation à un autre art. L’idée de départ était un trio de garçons toujours en mouvement à l’image d’un banc de poissons, mais toujours en contact et dans une malléabilité de l’ensemble. Je voyais quelque chose de vif, avec des portées constantes, verticales, horizontales, sans jamais se dessouder. C’est en revoyant par hasard une toile de Nathalie Gontcharova, LES LUTTEURS que j’ai compris ce que je cherchais. La force que me renvoyaient ces corps en train de lutter, mélangée à la douceur apparente de leur étreinte, le tout baignant dans des coloris graves de rouge, vert et gris sombre, me touchaient profondément. J’ai désiré alors travailler sur ce paradoxe du temps suspendu mais oh combien vivant. À partir de ce moment, j’ai compris que je pouvais me nourrir d’autre chose et ne plus seulement partir de la page blanche comme je le faisais auparavant. Pour ce qui est de la littérature, je me réfère souvent au philosophe Gaston Bachelard parce qu’il a su dire de façon magistrale des choses que je ressens et que je pense. La référence à Maurice Blanchot avec THOMAS L’OBSCUR qui est à l’origine de PROJET DE LA MATIÈRE que nous avons créé en 1993 est d’une autre nature. Ce roman a été à l’origine de ce désir de travailler sur l’abandon, le vertige, l’envol, le poids du corps, la liquidité du corps, ce que j’ai appelé plus tard « le corps matière ». Dans cette pièce, le temps est infini, En 2005, j’ai voulu renouveler ce rapport au corps matière avec RIEN NE LAISSE PRÉSAGER DE LÉTAT
DE L’EAU. On a travaillé à la transformation/ déformation qu’on trouve chez Francis Bacon, à ces figures en devenir. On les perçoit par instants de façon très brève durant le spectacle. Mais j’ai toujours besoin en réalité de partir du vide, de cette page blanche. Je me nourris alors beaucoup de ma relation avec les danseurs.
A. L. M. : Le danseur donne cette sensation d’occu-pation du corps, d’un corps juste, dans sa posture, qui n’est pas dans la déperdition. L’acteur va aujourd’hui chercher du côté de la danse. Quelle est votre expérience de spectatrice ?
O. D. : Je pense effectivement que le « corps » théâtral se déplace actuellement du côté du corps dansant. J’aime les spectacles comme ceux de Ludovic Lagarde dans lesquels le corps de l’acteur est au service du texte. Une écriture complexe comme celle d’Olivier Cadiot devient non seulement compréhensible mais elle se voit magnifiée. Je n’entends pas pour autant défendre le mélange théâtre/ danse que je n’apprécie que rarement en tant que spectatrice. Je n’apporte dans mes collaborations avec des metteurs en scène aucune chorégraphie, seulement un travail sensible sur le corps.

chorégraphie Odile Duboc, Théâtre de la Bastille, Paris, 1984.
Photo Christiane Robin.

Emmanuelle Huynh, Stéphane Imbert, Éric Lutz, Blandine Minot, Julie Nioche, Rachid Ouramdane, Geneviève Pernin, Agache Pfauwadel, Luigia Riva, Odile Seicz, Philippe Riera, Françoise Rognerud, Sylvie Tonnu et Christophe Wavelec
dans TROIS BOLÉROS, chorégraphie Odile Duboc,
conceptionOdile Duboc et Françoise Michel, La Filarure,
Scène Nationale de Mulhouse, 1996.
Photo Florian Tiedje
L’organicité du geste
A. L. M. : Vous parlez de l’organique aussi.