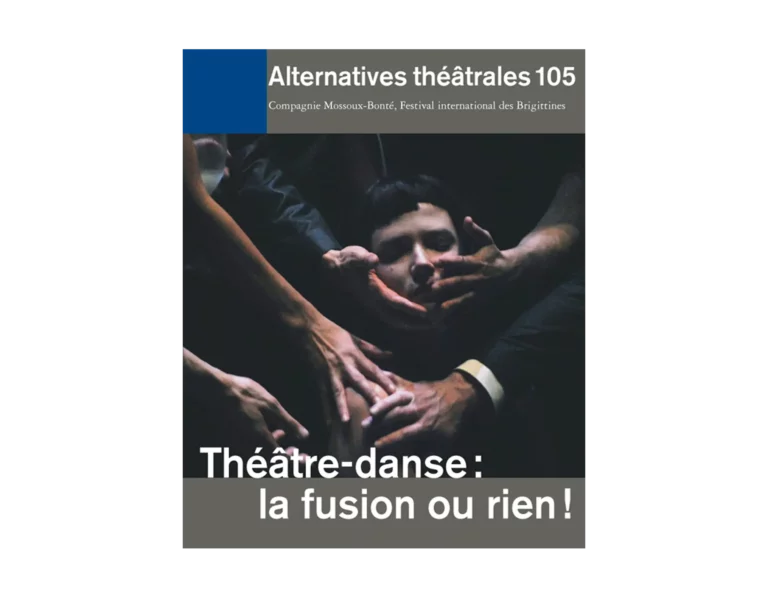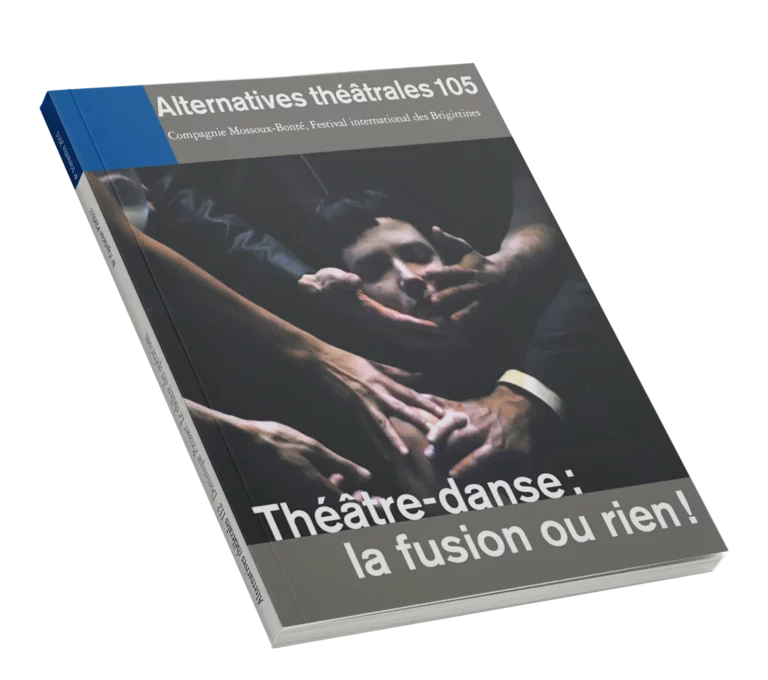C’EST ENCORE L’ÉTÉ, et déjà presque la rentrée. Ce moment un peu incertain tapi entre un début de nostalgie et le seuil d’envies nouvelles.
Après peut-être une cure salutaire de non-spectacle, l’appétit s’est aiguisé, comme neuf.
C’est le moment. l’entre-deux. De la même façon que le Festival international des Brigittines, dont l’origine remonte à 1982, cultive d’année en année tous les visages de l’interdisciplinarité. Sans choisir jamais ou le théâtre ou la danse — pour réduire le champ à une alternative — mais en optant au contraire pour les intersections, les zones parfois floues mais dont l’indé-termination pour autant n’empêche pas la radicalité,
ni même une certaine pureté formelle. C’est d’expression scénique qu’il est question ici, de questions plus que de réponses, de leur formulation plus que de leur résolution, de l’acceptation du trouble jailli dans cet éphémère absolu.
Ainsi, aussi, les propositions du festival interrogent-elles inlassablement non seulement l’art lui-même, mais le spectateur, son regard, sa perception : l’individu qu’il est, en éveil ou fourbu, irrité ou bienveillant, paisible ou agité, curieux ou furieux, amoureux ou déçu, à l’instant précissuspendu — où il reçoit une œuvre donnée.
Son état de corps et d’esprit, mais encore la connaissance préalable qu’il a — ou non — du travail auquel il accède, de son auteur, de son contexte artistique, environnemental, économique voir politique. Sans doute faut-il trouver là une des raisons majeures de notre attachement à cet événement : l’implacable, la formidable subjectivité qui le sous-tend. Et qu’il bouscule, et questionne, et renvoie comme une balle sur ses propres parois, virtuelles et mouvantes. Rebondissement permanent, pour nous indissociable de l’humain, aussi scientifique et précis soit-il, et plus encore de ses moments d’ouverture à l’art, sous quelque forme qu’il se présente. Art contemporain, mouvement et voix sont les piliers des Brigittines comme lieu. Leur conjugaison, leur combinaison, leur confrontation habitent le festival, qui n’a de cesse de sonder l’étourdissante polysémie de ce que, pour simplifier, on nomme théâtre. Cette re/présentation, ce questionnement (encore!? toujours, surtout), cette appropriation et cette dépossession simultanées d’une chose, d’une idée, d’un souffle, pas forcément d’un récit.
Que doit être un spectacle ? Qu’y vient-on chercher ?
En posant l’art comme « le lieu du singulier qui s’adresse à tous », le Festival des Brigittines a opté pour la présentation de formes originales du spectacle d’aujourd’hui — dont l’originalité, plutôt que le but, serait la nature, la condition — à même de s’ouvrir à l’imaginaire de chacun. En cela découvreur, défricheur, il explore le champ de la création, attentif toujours aux équilibres instables, aux échos de la bizarrerie, aux « sentinelles de l’improbable » pour reprendre l’un des intitulés qui, souvent à double face (pas toujours cependant : on se souvient de la ligne de 2002, « Le monde te prend tel que tu te donnes », mais aussi des « Jumeaux imaginaires » de 2007, année de l’ouverture du « double » de verre et d’acier de la chapelle baroque, et que suivraient en 2008 d’évocateurs « Abîmes secrets »), ont jalonné l’histoire du Festival, assortis à chaque édition d’une image choisie, évoquant l’humain, convoquant le fantasme.
Irréductible à une esthétique unique, le projet pourrait même, à un œil très extérieur, sembler dispersé ; il présente pourtant, au fil du temps, une assez fascinante cohérence, due selon nous tant aux goûts et affinités de ses programmateurs que, paradoxalement, à leur constant souci d’éclectisme. (Ce dont Michel Jakar, derrière sa caméra, se sera fait le témoin subjectif et précis. Ses LÉGERS DÉRANGEMENTS DU RÉEL, film tiré de son observation de tous les spectacles des éditions 2003 à 2005, donnent une très belle et juste mesure de cette étonnante dualité.) Un fil, ni rouge ni noir, mais de cette couleur indécise que révèlent les crépuscules, traverse cette déjà longue aventure. L’étrange. Celui qui va du frisson à la familiarité confondante.
Celui d’où surgit le malaise peut-être, la fascination souvent, celui qu’accompagne une forme d’ « intranquilli té ». Cette étrangeté-là, fût-elle habitée de fantasmagories parfois, ne doit pas grand-chose au genre fantastique, mais relève de l’intime, de l’enfoui, jusqu’à l’obscur, sur quoi soudain une œuvre peut jeter ses lumières. Du sens ? éventuellement. Du sensible certainement.
« Nous avons besoin d’une parole de chair pour nous orienter dans les labyrinthes de nos pensées » : la formule de Patrick Bonté a gardé toute sa pertinence.
Du côté des artistes, des fidélités se sont nouées au fil du temps, sans empêcher jamais les découvertes. Fugaces pour certaines, tenaces pour d’autres. Et ce tandis que l’événement s’est progressivement inscrit dans des réseaux, européens notamment, ouverts aux arts de la scène novateurs.
Tout cela fait du Festival international des Brigittines, à la fin d’une saison et à l’orée d’une autre, un rendez-vous singulier et précieux, avec la création actuelle sous ses aspects les moins«attendus », les plus audacieux, et avec nous-mêmes. Une invitation chaque année renouvelée à se laisser envahir par l’instant. Une incitation aux vertiges de la curiosité. Aux décloi-sonnements, décalages, perturbations, basculements.
Aux habitudes bousculées, perceptions questionnées, certitudes déboussolées. Un moment pour, peut-être, reconnaître l’autre en soi, pour déceler, sinon résoudre, cette énigme.