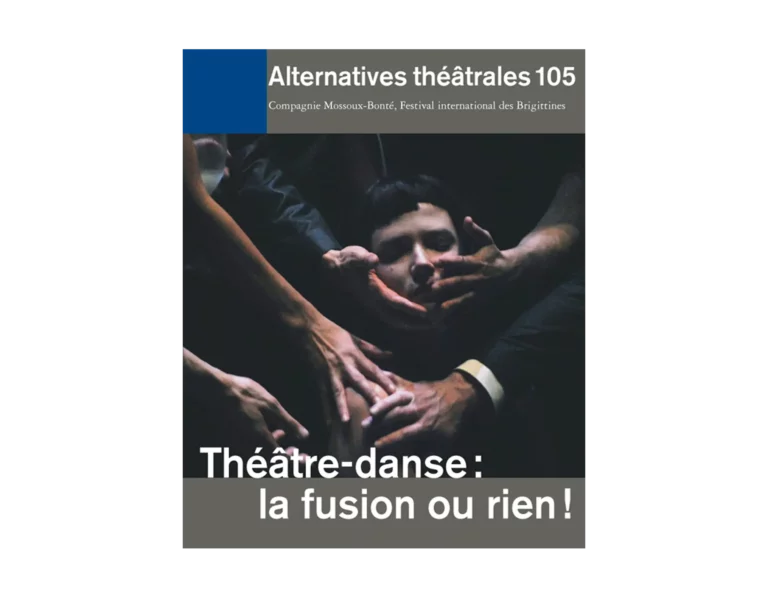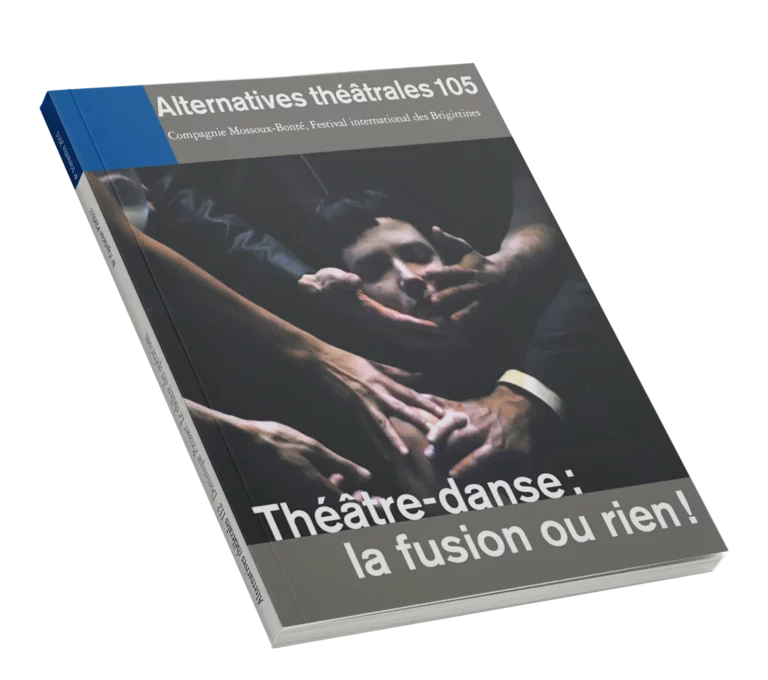BERNARD DEBROUX : Comment êtes-vous venue à la danse ? Avez-vous suivi un parcours classique ?
Leslie Mannès : J’ai commencé à faire de la danse classique très jeune et assez rapidement de manière intensive. Je me suis tournée vers la danse contemporaine à dix-huit ans en intégrant l’école P.A.R.T.S. où j’ai suivi pendant deux ans le premier cycle de formation. J’ai ensuite continué mon apprentissage à l’école SEAD à Salzbourg pendant deux ans.
B.D. : Comment avez-vous rencontré la Compagnie Mossoux-Bonté ?
L. M. : La rencontre avec la Compagnie Mossoux-Bonté coïncide avec la fin de ma formation. Dans le cadre d’un projet personnel, BY-PRODUCT, réalisé en collaboration avec Manon Santkin et Jennifer Defays où nous questionnions la relation entre le corps et le vêtement, j’ai suivi le stage de Nicole Mossoux et Colette Huchard « sur l’incidence du vêtement ».
J’ai découvert une sensibilité et un univers qui m’ont touchée ; j’ai senti que j’avais accès dans ce travail à quelque chose de juste pour moi mais auquel je n’avais pas encore vraiment donné de place. J’ai pu le concrétiser en rejoignant la compagnie en 2006 et le développer à travers les différentes créations auxquelles j’ai eu la chance de participer.
Le travail et l’univers de la compagnie m’étaient déjà familiers par la programmation du festival des Brigittines dont je suis spectatrice assidue depuis longtemps. J’avais été fort marquée par l’univers visuel de TWIN HOUSES : le travail d’un corps dépouillé de ces codes habituels et qui crée d’autres niveaux de résonance pour le spectateur.
Cette qualité de corps très particulière, où il semble que la texture même du corps se transforme est vraiment visible dans les différents solos de Nicole Mossoux.
B.D. : Comment se déroulent les phases de travail d’un spectacle pour un interprète de la compagnie ?
L. M. : La première phase de travail est toujours l’improvisation qui constitue une part importante du travail et nous permet d’accumuler des matières. Avant d’improviser, Patrick Bonté nous propose une situation, nous donne des indications, des thèmes et des images qui vont stimuler un univers mental.
Ces éléments ne vont pas stimuler tous les interprètes de la même manière, mais cela crée une zone de résonance commune qui, sans être jamais définie, se raffine au fur et à mesure du processus.
Au départ, nous sommes dans la profusion de situations, de mouvements, de costumes, et petit à petit l’univers propre au spectacle se cristallise. Un langage se développe pour le spectacle et pour chacun. L’étape suivante va alors être l’articulation de ce langage par le développement de la structure ;