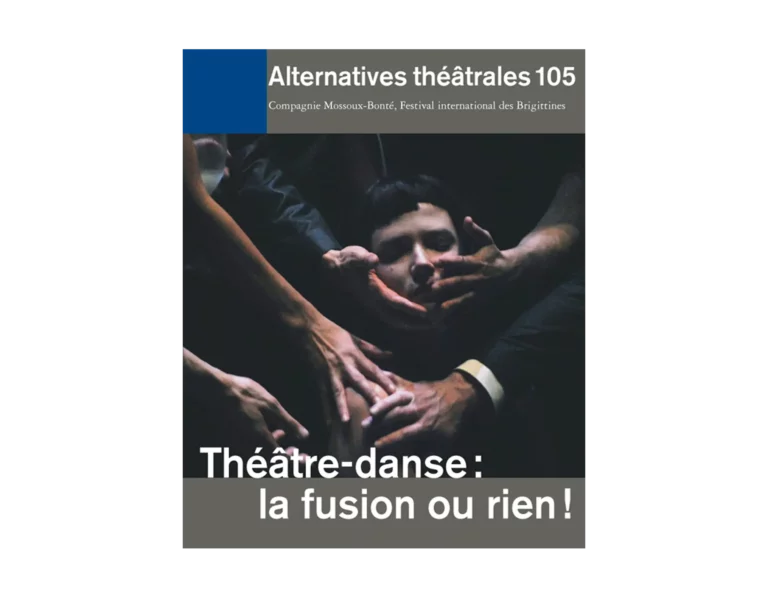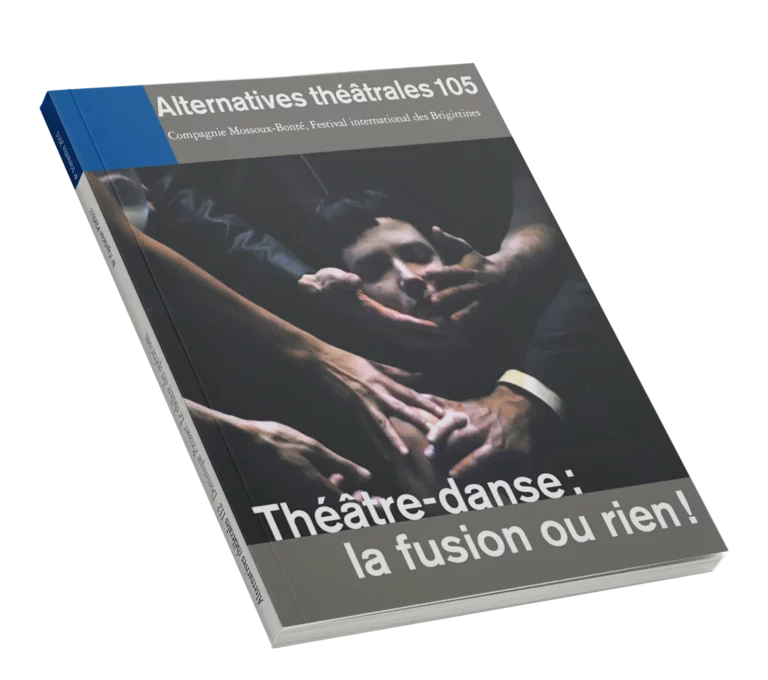PARTONS DU POSTULAT que la danse met en scène un corps-pensée sous le signe évanouissant d’une capacité d’art. Les mondes proposés par Nicolessoux et Patrick Bonté prétendent au théâtre par ces corps-pensées particuliers que sont ceux de leurs acteurs-danseurs. Une forme de pensée en mouvement dans l’effectuation mystérieuse d’un parcours qui ne vise ni la virtuosité abstraite, ni l’expressivité narrative.
Elle cultive bien plutôt une sorte d’intensification de la présence des êtres en mouvement qui,sitôt offerts au regard, s’y dérobent suivant une loi qui d’abord échappe et par là-même intrigue. Quelque chose sourd, qui n’a pas de nom et nous renvoie au surgissement d’un événement qui ne peut venir que de la scène, à l’instant.
L’intensité qui nous saisit naît de la transformation de l’espace par le mouvement qui le traverse, le barre, l’oblitère, le capture telle une puissance obscure et tranchante. Le réel troue l’espace et l’articule autour de ces béances. Les trajectoires sont donc imprévisibles, mais à vrai dire elles ne tracent guère d’histoire ou d’intrigue. Cela, parce qu’elles sont l’Intrigue même, chacune déployée pour elle-même, dans l’indifférence et l’arrogance de son développement propre, chacune vouée dans sa lumière et son espace à sa propre apothéose et à son effondrement, persévérant dans son être jusqu’à la lie, sans mémoire et sans postérité.
Le spectateur que nous sommes sait très vite qu’il est à bord d’une embarcation nouvelle qui le conduit dans un espace-temps sidérant. Ce qui se développe n’est pas une histoire, mais un style qui procède par contamination de rythmes, de sons et de lumières, amplifiant la capacité de l’acteur-danseur à activer le déploiement d’une forme inédite. Ce qui affleure alors est, comme le dit Patrick Bonté, de l’ordre d’une interrogation mentale, une gestuelle produite, non par le seul effet de l’écrin matériel des éléments scéniques, mais par un monde intérieur qui bouillonne. Ce sont des effluves de ce bouillonnement secret qui agite les interprètes.
Le geste est d’abord une interrogation mentale, la manifestation de circulations internes contradictoires et incoercibles. Ce n’est donc jamais une histoire qui se développe, mais des histoires obscures, un écheveau de forces qui se manifestent à nous par le véhicule de ces corps en mouvement. Le plus souvent, c’est un débat qui affiche les contradictions qui nous travaillent, les guerres internes qui nous habitent et dont la résolution toujours provisoire constitue ce que l’on appelle un sujet.
Les corps-pensées qui se présentent à nous ont cette particularité d’être autant sensibles et
réactifs à l’écrin de sensations suscitées par les éléments extérieurs que mus en permanence par une logique interne implacable.
Il semble que ce qui advient sur scène soit constamment mis en doute, que chacun des gestes soit à l’épreuve d’une vérification, l’objet d’une bataille, d’un nouveau défi, toujours inachevé, toujours recommencé, comme un cœur qui bat. Ce sont bien des cœurs vaillants en bataille.
Ce qui compte, nous rappelle Nicole Mossoux, est ce qui meut ces corps et la manière dont ils créent de l’espace autour d’eux. Il faut que l’interprète descende au plus profond de lui-même, que sa présence soit constamment mise en doute, à l’épreuve. L’évidence évide sans effet de vérité, évite la rencontre ; il faut loin de l’évidence laisser le décalage, le glissement affleurer dans le mouvement.
Le geste arrive au corps-pensée, lui arrive, comme une déflagration dont il faut prendre acte et continuer à extra-vaguer, si je puis dire. À propos de cette descente de l’interprète loin en lui-même, Nicole Mossoux évoque encore ces gestes qui s’avancent en éclaireurs et laissent soudainement survenir la réminiscence, volatile et fracassante.
Trouver la logique interne à chaque élément de cette descente dans les profondeurs, l’articuler à d’autres logiques qui vont, par le jeu de leurs intrications, perturbations, contradictions, former peu à peu, dans les heurts successifs des rencontres, la complexité d’un langage.
Light !
Dans LIGHT ! (2005 ), Nicole Mossoux, seule en scène, organise l’espace à partir de son corps sanglé et caparaçonné, dans le jeu perpétuel de la mobilité de son ombre projetée et des fantasmagories qui se développent à partir de celle-ci. D’emblée se pose la question de ce qui se montre et se dérobe ; telle une sculpture mobile, le vide et le plein se combinent dans une construction paradoxale par dérobade.
L’ombre organise le mouvement, prolonge le corps, modifie la présence : la forme qui se dissout crée l’espace qui devient trace à son tour, dans une fluctuation incessante. L’immobilité n’est là que pour le contraste, comme Büchner le disait de l’enfer. La suspension est toujours un entre-deux, couverture d’ombre en promesse des métamorphoses du corps. Retenu, prisonnier de l’ombre, celui-ci se débat, puis se joue, détourne le piège noir. l’ombre prolonge le corps, le couvre, l’enveloppe, puis brusquement l’abandonne dans un effet brutal de lâcher-prise. Il y a de la stupeur dans les surprises du jeu avec l’ombre, jamais de la peur. On entend la respiration amplifiée deschangements imposés. Avancer, ou bien se coucher. Ramper encore vers la lumière, détourner, insister, ruser. Se retourner sur soi et être pris encore dans le noir.
L’ombre couvre le visage (comme souvent la main qui enlève la fenêtre du regard). Faire face à la bête d’ombre, puis l’avaler : l’ombre est aussi un masque. La bête, la fantasmagorie, se déplie et se remet en position, en scène.
Les songes de la Raison sont, comme Goya nous l’a montré, d’une respiration rauque : on les entend dans le mouvement de balancier qu’engagent les bras, les jambes qui bientôt suggèrent un nouvel animal, un animal hénaurme. Il se déplie en araignée. Ce corps joue
avec soi, à se faire peur comme le font les enfants, surpris des sensations toujours renouvelées et infinies qui s’enchaînent.