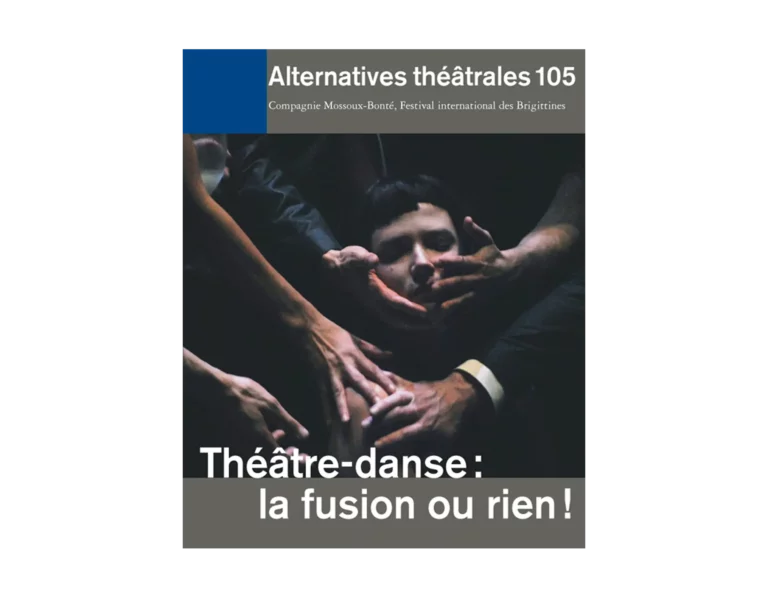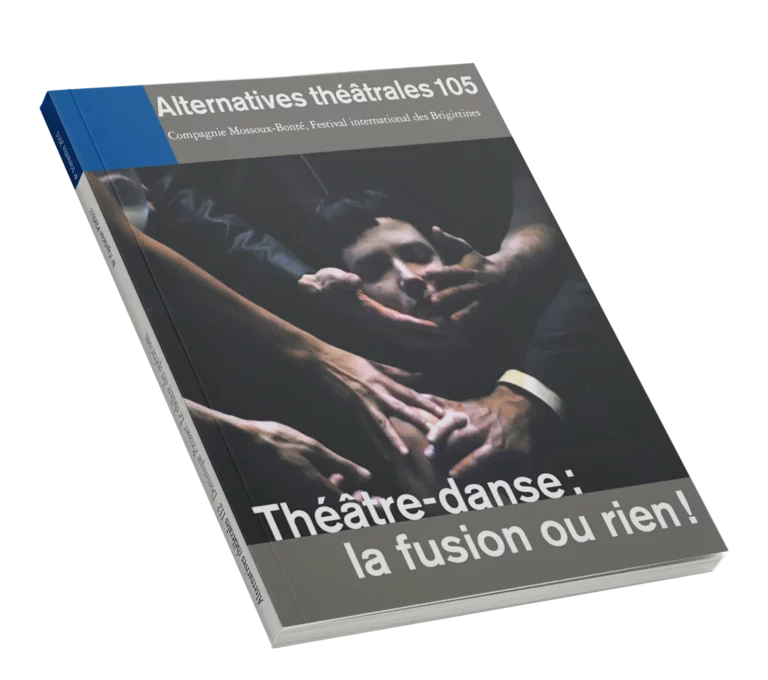UN THÉÂTRE qui a exilé le corps de l’acteur. Un corps qu’il faut voiler, nous disent-ils, dont la présence est donc rendue non immédiatement visible, mais plutôt médiatisée par quelque chose qui s’interposer dans le regard. À l’intérieur d’un·espace qui rend perceptible la disparition du corps. Ou, pour ainsi dire, ils en tronquent les bords, comme pour radicaliser la leçon de peinture de Francis Bacon. Par l’énergie du mouvement de ces formes ils décolorent l’espace qui les enveloppe.
Depuis le diptyque des débuts (LA TIMIDEZZA DELLE OSSA, suivi de LA PIÙ PICCOLA DISTANZA), Pathosformel affronte avec une grande rigueur formelle la question de la présence du corps en scène et du refus de son et de politique des arts immédiateté spectaculaire.
La jeune formation conduite par Daniel Blancia Gubbay et Paola Villani a choisi comme comme appellatior savante le terme forgé par Aby Warburg qui fait allusion à une image qui s’inscrit dans « l’atlas de la mémoire » par l’intensité émotive du geste, capable de conjuguer le pathos de la création originelle avec la possibilité de se répéter dans des contextes différents. En effet, forme et contenu convergent indissociablement dans LA TIMIDEZZA DELLE OSSA (La timidité des os), qui, par son titre déjà, évoque un écart entre la matière corporelle et la manière dont elle se révèle ; ou, dans VOLTA, qui est comme le négatif du premier travail, peut-être l’élément complémentaire nécessaire, notamment pour l’alternance du noir et du blanc en une gamme chromatique qui semble ne connaître que les extrêmes. D’un côté, une constellation mobile de traces qui se rejoignent et glissent sur la surface d’un écran d’une blancheur laiteuse, petits os humains en quête d’une reconnaissance provisoire. De l’autre, des corps invisibles dans l’obscurité de la scène, dont on ne perçoit qu’une sorte de simulacre, le reflet d’une couche de cire claire qui les recouvre et s’effrite, laissant une trace matérielle de l’accomplissement de l’événement scénique. En une dissolution littérale des gestes qu’on a vus se dessiner dans l’espace.
Repartir de la toile blanche qui était le point d’arrivée (désormais infranchissable) des avant-gardes artistiques du xxe siècle, semble donc être le nœud avec lequel Pathosformel se confronte au départ, dans la matérialisation même de la création scénique.
Peut-être pour faire émerger quelque chose qui se trouve sous la toile, ou sous la peau. Ils nous révèlent le rapport fonctionnel entre le travail artistique et l’image créée, cette sorte de désert blanc dans lequel le regard creuse à la recherche de restes fossiles d’une vie animale qui la déclenche au moment de disparaître. Car derrière cette image qui s’efface dans le silence initial du travail et avec l’irruption simultanée de la musique, sous la structure de l’écran qui la soutient, se trouve concrètement l’apport physique des acteurs, leurs corps interposés, mais tout sauf absents.

Festival international des Brigittines, 2008.
Photos Antonio Ottomanelli.
La pièce suivante, LA PIÙ PICCOLA DISTANZA, peut alors sembler un retour à un théâtre abstrait, qui rappelle les expériences historiques des avant-gardes du xxe siècle, avec ce ballet mécanique de silhouettes carrées, qui glissent en s’effleurant sur les rails d’invisibles fils tendus, sur un plan qui réduit la profondeur de l’espace scénique aux deux dimensions d’un écran. Une danse fabriquée d’allers-retours, d’accélérations et de ralentissements, de pleins et de vides, de croisements et d’inversions de mouvements. Derrière les pauses, les hésitations, les tremolos, on peut encore deviner la main humaine qui les guide mais sans ressentir de pathos.
LA PRIMA PERIFIERIA, dernière création de Pathosformel, est à nouveau une danse de fantômes démembrés. Sur scène, trois squelettes d’anatomie, maniés et mis en pose par autant d’invisibles serviteurs de la scène.
Ou plutôt des mannequins métaphysiques, des hommes sans visage à la De Chirico qui s’adaptent à la vie mécanique qui leur est imposée de l’extérieur. Situé dans un espace neutre et blanc, sur une estrade aux bords surélevés qui rappelle le tracé des pistes de skate, le travail de la troupe vénitienne se nourrit de petits déplacements, du frémissement des articulations, de pas qui miment une danse impossible, au rythme hypnotique d’une musique de fond toujours plus percussive. Mais au lieu d’observer les mannequins il faut regarder à la périphérie de ces corps qui les meuvent, afin de retrouver le sens de la complexité qui se trouve derrière chaque geste. C’est une fois encore la partie musicale qui dicte le rythme scénique, jusqu’à en graduer l’intensité émotive sous la pression de l’onde sonore qui fait vibrer physiquement les tripes du spectateur. Heureux de retrouver un peu de cette immédiateté niée à dessein par les auteurs.
Traduit de l’italien par Laurence Van Goethem