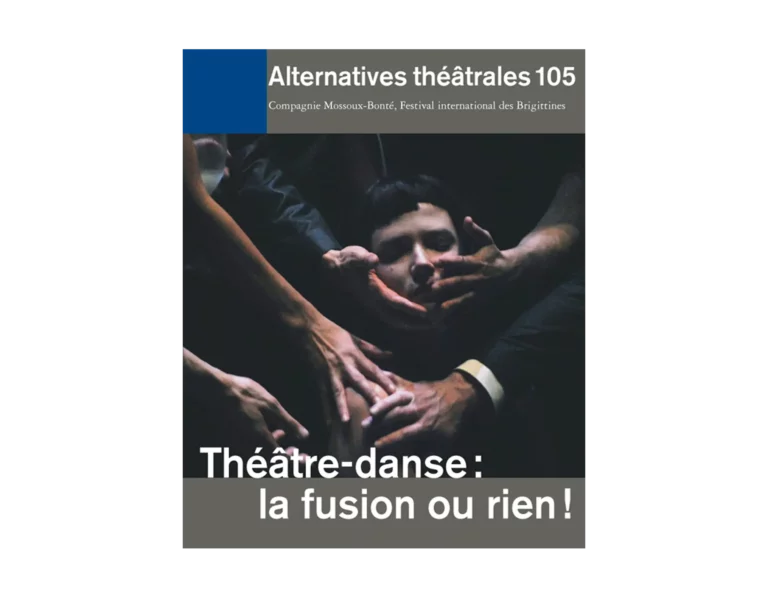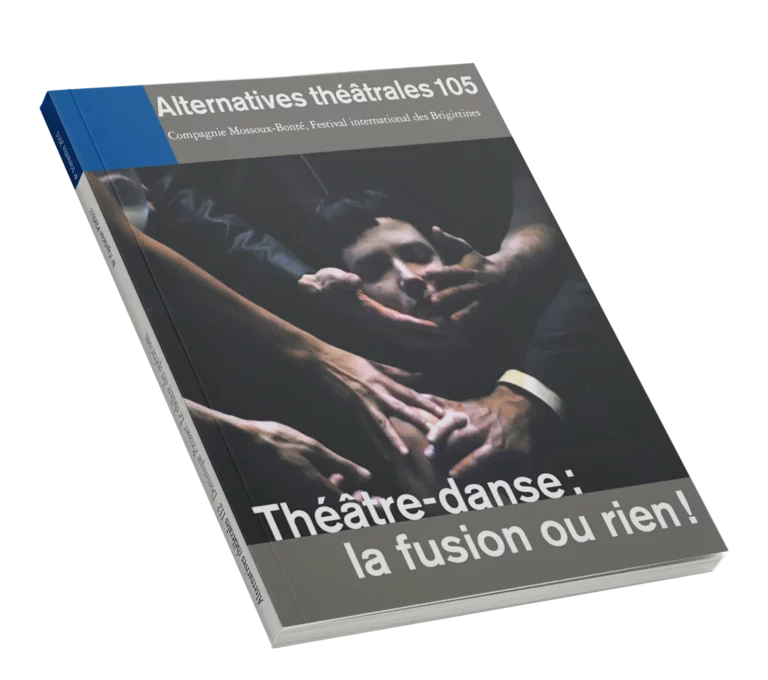DANSER POUR VIVRE. Danser pour dire la vie. Danser pour faire l’histoire. Danser pour imaginer la paix. Les chorégraphies de Pina Bausch recréent l’univers. Elle a su fabriquer une cosmogonie. Ses oeuvres ne se perçoivent pas de façon linéaire, comme une juxtaposition
chronologique mais bien plutôt comme des parcelles d’un tout organique dispersées dans le monde comme les planètes. La conception d’une création annuelle qui s’ajoute à la reprise d’une oeuvre du répertoire, tisse, retisse l’histoire du Tanztheater.
Contrairement à de nombreux spectacles de danse illustratifs ou purement esthétiques, les pièces (Stücke), ces morceaux du puzzle théâtral qui constituent l’oeuvre sont dotés d’un discours sous-jacent. Au commencement, chez Pina Bausch, il y a la danse, le mouvement qui surgit de l’observation du quotidien. La reproduction d’une microgestuelle, celle du déni d’amour. Le bascule de la tendresse à la violence, le moment où le don de plaisir est rattrapé par les complexes de l’égo et que le machisme reprend le dessus.
Cette danse théâtre n’a en fait pas besoin de paroles pour être expressive. La danse des corps est pleinement autosuffisante au discours. Le mode théâtral tel qu’on l’entend a priori : valorisation du texte dramatique est second. Le mode théâtral est présent par l’envers du discours, tout ce qui est dramatique sans être pour autant linguistique. Le théâtre dans les chorégraphies de Pina Bausch est structurel : cadre, support au sens plastique, rappel des contours. Nous sommes sur scène, il s’agit d’une illusion dramatique, le sol est un lino plaqué sur la scène dans BANDONEON (1981), les échelles mènent à des granges imaginaires dans SWEET MAMBO (2008). Nous sommes dans une réalité transposée sur scène. Même la nature est une notion kitsch : des fleurs en papier, huit cents ceillets fabriqués à Bangkok pour NELKEN (1982), une biche empaillée dans 1980, EIN STÜCK VON PINA BAUSCH (1980), un hippopotame dans ARIEN (1979), ou un crocodile de scène la même année dans LA LÉGENDE DE LA CHASTETÉ et de l’eau, de l’eau, encore de l’eau où évoquer glissades, plaisirs balnéaires, chutes torrentielles, pluies, neiges et glaces.
Le théâtre est le mode de représentation, la danse est le langage. Lorsque ici ou là la parole surgit, elle naît du mouvement, de l’instant, elle est propulsée par la variation dansée choisie. La parole est aussi réduite à un mode sonore et non à un véritable contenu narratif doté d’un déroulement aristotélicien.
Dans le théâtre dansé de Pina Bausch la parole appartient en réalité au hors scène. Elle est
confinée dans les marges des spectacles. Elle appartient encore plus aux marges antérieures. PinaBausch pratiquait le rituel des Stichwiirter : des phrases déclencheurs, des incitations à uncondensé de tous les modes dramatiques : retrouver la gamme des possibles autour de ces phrases énigmes : « quelque chose de cassé, rien à faire », l’irréparable ;
« Pénélope », l’attente toujours renouvelée, des concepts, des ouvertures vers le mythe ou bien de simples jeux d’observation « quelque chose de l’amour — ritualiser » ou « quelque chose qui fasse mal — physiquement ». Des phrases qui propulsent la créativité de façon spontanée dans l’improvisation, la plongée mnésique stanislavskienne, l’étude rapportée des observations de la vie quotidienne, la routine des exercices de scène. La parole précède, cherche, ausculte le réel. La parole documente l’événement humain, le lien homme-femme, la prostitution bourgeoise ou urbaine dans LES SEPT PÉCHÉS CAPITAUX (1976), l’érotisme léger ou sadique, la vulnérabilité et la fraicheur de l’enfance dans POUR LES ENFANTS D ‘HIER, D’AUJOURD’HUI ET DE DEMAIN (2002), les tentations de l’autre …
LA PLAINTE DE L’IMPÉRATRICE, film conçu par Pina Bausch en 1990, montre bien les répétitions, les recherches expérimentales, l’univers en vase clos qui s’efforce de vivre à l’air libre comme si le danseur wuppertalien sortait de son studio-aquarium pour tenter l’expérience de la forêt. D’ailleurs cette notion d’aquarium, et de danseur évoluant d’un côté ou de l’autre de cette cage de verre et d’eau se retrouve dans DANZÔN (1995), spectacle dans lequel Pina Bausch danse son dernier solo, une oeuvre où la fluidité de l’être, son côté éthéré, qualifié de somnambulique dans CAFÉ MÜLLER (1978), acquière une pureté essentielle. La danseuse se fond dans la part organique du monde. Elle s’associe, diaphane, aux couleurs de l’univers. Le jeu des projections et des superpositions audiovisuelle gomme les frontières entre l’humain et le naturel, de la même façon que dans ÀGUA (2001) où les danseurs se dissolvent et se superposent dans les projections d’image de la jungle et de ses jaguars. Chez Pina Bausch, le théâtre et la danse ont le même statut que le masculin et le féminin. Indissociables, imbriqués, au corps à corps, en harmonie, en destruction, un jeu de séduction à renouveler en permanence.
Dans l’histoire de la danse, le théâtre dansé émerge comme une sorte de nécessité historique qui se cristallise ici et là dans le monde à la même époque. Pina Bausch n’est pas la première à avoir inventé ce concept. D’autres créateurs mêlent déjà les arts scéniques. Elle a eu des prédécesseurs illustres tels que Gerhard Bohner et Johanr Kresnik. Kresnik stigmatise la violence politique et Pina Bausch celle des relations humaines. Elle a été formée à la Hochschule de Essen sous la direction de Kurt Jooss dont le spectacle LA TABLE VERTE, même s’il s’agit d’une chorégraphie et non de théâtre dansé, insuffle déjà une forte dramatisation aux jeux des danseurs. Pina Bausch étudie également à la Juilliard School of Music de New York de 1959 à 1962, ce qui lui permet de découvrir les travaux d’artistes tels que les danseurs de la Judson Church Theater qui orientent leur chorégraphie vers une action contestataire. Dans les années 1970, les arts scéniques portent un message orienté vers la dénonciatior de la guerre du Vietnam. De part et d’autre de l’Atlantique, qu’il s’agisse d’Anna Halprin ou de Johann Kresnik, le capitalisme et ses tendances impérialistes sont au cœur des thématiques.

chorégraphie Pina Bausch, 1981.
Photo Guy Delahaye.
Le courant du théâtre vivant du Living Theatre avec THE BRIG (1964) ou PARADISEN NOW (1968) va du mode théâtral au mode chorégraphique inspiré des bacchanales, miroir de la période hippie, du crédo Peace and Love et d’un concept dansé orgiastique. Les corps se mêlent, se délient et réclament le paradis ici et maintenant. Le théâtre anarchiste qui fait éclater toute narration à l’ancienne et privilégie le théâtre des corps et un discours sous-entendu de révolte est le pendant du travail de Pina Bausch. Le Living et Pina Bausch retravaillent les mêmes matériaux humains et mythiques d’après une approche différente. Le Living part des tragédies grecques telles que ANTIGONE et les dissout sur scène dans un mode orgiastique. Quant à Pina Bausch, elle part du modèle d’une danse apprise sous la baguette des maîtres de l’école classique et relie les schémas comportementaux de notre quotidien auprès des mythes anciens (ORPHÉE ET EURYDICE (1975 ), IPHIGÉNIE ( 1973) et des mythes modernes qu’on pourrait qualifier de barthésiens : la boxe (BANDONEON); la mafia (WIESENLAND); le hammam (NEFÉS, 2003). Elle nous aide à percevoir ce qui appartient à des schémas éternels, répétitifs et inéluctables. Le rappel du mythe, de la légende ou des comptines de l’enfance sert d’iceberg de signification. Elle crée ainsi des repères atemporels au détour des jeux d’amour et de destruction.
En fait, ce qui fait la force de ce théâtre dansé, c’est que les morceaux du patchwork dramatique épouse à la fois l’anecdotique et le mythique. Chaque spectacle est porté par la réécriture d’un mythe ou l’instantané d’un état de société actuel inspiré par ses séjours en résidence à l’étranger. Elle crée des cartes postales ésotériques. Une saisie de l’essence d’une culture et de ses modèles socioéconomiques. La place de la femme et de l’amour au sein des cultures du monde. Une sorte d’état des lieux de l’instinct d’amour et de paix en Orient et en Occident aujourd’hui.
Au-delà de ces « pièces-morceaux », on perçoit en permanence le tout, le reste de l’ oeuvre, les autres spectacles du puzzle. La cosmogonie bauschienne se recrée à chaque spectacle sous nos yeux en filigrane. Ce sont tous ses spectacles que nous revoyons superposés dans nos mémoires. Il s’y dessine un regard unique sur le monde. Un silence tragique avec une lumière d’espoir dans les yeux. Les schémas de construction et de destruction sont inscrits au coeur même de l’univers. Les rythmes et les respirations de la vie et de l’amour semblent dictés au-delà du moment par des normes plus vastes que celles que nous nous contentons de percevoir.
Le miracle du théâtre dansé de Pina Bausch c’est la générosité de ce don d’une vision de
l’éternité. Au-delà des vernis culturels, des règles de vie, en harmonie ou en dissonance avec l’instant, repris par des forces plus grandes, celles de la nature et des mythes. Ce n’est pas le capitalisme effréné qu’elle combat comme le faisait Brecht ou le communisme déviant comme l’a fait Stoppard, mais bien l’homme ou la femme en décalage avec les forces naturelles de la vie.
On a dit que ses premiers spectacles, l’époque de BARBE-BLEUE (1977) et de WALZER (1982) étaient sombres, provocants, déstabilisants. Certains critiques se sont plaints en revanche de ne plus retrouver cette nébuleuse glauque dans les spectacles plus récents. Un spectacle comme MASURCA FOGO (1998), conçu lors d’une résidence à Lisbonne fait jaillir la source de la théâtralité de la danse : cette force unique de vie à partir de rien dans un bidonville, quelques planches, des tôles, une baraque que l’on monte et que l’on démonte et d’où surgit la fête. On sent un écho à l’un des tous premiers spectacles, écho qui traverse les temps et les frontières, une renaissance de la vie et de la capacité au bonheur et à l’amour toujours renouvelé, qui correspond à la vulgarisation du plus grand mythe gui parcourt l’œuvre de Pina Bausch, développé à l’origine dans LE SACRE DU PRINTEMPS (1975), les forces de renouveau, le côté terrien, l’ancrage dans le terreau de la vie, l’absence de crainte face aux éclaboussures de la matière, et la nécessité de sacrifier un être, l’Élue, pour permettre au printemps de revenir. Les cycles des spectacles explorent cette notion du désir d’amour et de vie, de la violence sacrificielle, de la destruction, de la perte et du retour des sens. D’un spectacle à l’autre, le souffle des rythmes de cet éternel retour des saisons, des drames, des paix et des guerres suit le rythme des musiques du monde.
L’œuvre musicale la plus représentative de l’œuvre de Pina Bausch est LE CHÂTEAU DE BARBE-BLEUE de Béla Bartók, c’est la seule dont le titre soit intégré à l’un des titres du répertoire de Pina Bausch : BARBE BLEUE — BLAUBART BEIM ANHÖREN EINER TÜNBANDAUFNAME VON BELÀ BARTÓKS’ OPER « HERZOGS BLAUBARTS BURG » (1977 ). Elle ressort donc comme emblématique de cette fusion entre la théâtralité du récit opératique de Bartók et son adaptation chorégraphique. Dans ce cas précis, la contribution musicale, très librement adaptée, sert de support à la réflexion dansée. Cependant elle est elle- même matière première, sujette au mode de la variation, extrait exploité en boucle, écoute répétitive à la John Cage du modèle bartokien, tourbillon de la redite. Barbe-Bleue écoute sur un magnétophone à bandes cet air de Bartók, repris à l’infini d’après un procédé dramaturgique évocateur du jeu théâtral beckettien dans LA DERNIÈRE BANDE (1960). Pendant ce temps scénique, les femmes de Barbe-Bleue sont enveloppées dans des draps d’amour camisole et balancées contre les murs d’un monde intérieur. Les étreintes sont renouvelées, les femmes emmaillotées dans des draps mortuaires, entassées les unes sur les autres dans un décor automnal où les feuilles mortes envahissent la scène intérieure et enfin elles sont accrochées comme des trophées sur les murs, papillons de nuit, tentures, objets de collectionneur. Pina Bausch et Béla Bartók explorent l’exhibition du moi déchiré par la violence de ses instincts contradictoires. L’opéra de Bartók mettait en scène l’affrontement entre Barbe-Bleue et sa quatrième femme, Judith, et le drame de la curiosité lorsque l’épouse cherche à découvrir la vérité de l’autre. Pina Bausch reprend cette schématisation à l’extrême d’un des aspects du conflit homme-femme, la criminalité du désir, l’instinct mante-religieuse de l’homme, la norme biologique qui incite à la chasse à l’éphémère. Dans LE SACRE DU PRINTEMPS, la musique de Stravinski porte également l’œuvre, elle ouvre la dramaturgie inhérente à la structure de l’œuvre, elle est construction et support du mythe. Dans ORPHÉE ET EURYDICE, Pina Bausch choisit de dédoubler cette fois les voix et les corps, schize qui souligne d’autant plus paradoxalement comment l’élan musical détermine le destin.
Lorsque l’on parle du théâtre dansé de Pina Bausch, il ne faut pas oublier l’imaginaire musical qui structure l’œuvre de la chorégraphe, parcours d’hommage à la musique de Kurt Weill ; aux comptines de l’enfance, aux classiques et aux modernes qui unifient en un tout le théâtre et la danse de même qu’au cinéma la musique sert à gommer les raccords. Partout, la musique est utilisée comme outil dramatique et non comme simple fond musical. Elle fait partie de la dramaturgie de l’œuvre, elle fait d’ailleurs figure de livret. Les paroles des chansons sont entendues comme texte porteur et non comme flux illustratif. Dans les chorégraphies de Pina Bausch, la musique mixe et remixe les êtres et les cultures. Partout, les airs se mêlent, classiques de jazz (THE MAN I LOVE de Gershwin présenté en langue des signes par Lutz Förster dans NELKEN), tangos à la nostalgie d’un érotisme codifié (BANDONEON), classiques de la samba brésilienne (ÀGUA), fado et musique capverdienne (MASURCA FOGO), airs de l’Europe de l’Est, de Bartók (BARBE-BLEUE) aux airs tsiganes de WIESENLAND (2000), tradition indienne et néo-wave britannique dans BAMBOO BLUES (2007). Dans ce spectacle, la musique traditionnelle indienne côtoie la musique rock anglaise du groupe Talk Talk et des compositions de Talvin Singh, compositeur né à Londres qui opère la fusion entre la musique classique indienne et le Drum ‘n’ Bass, une musique électronique underground au tempo ultra-rapide et à la mélodie en basse.

chorégraphie Pina Bausch, 1990.
Photo Guy Delahaye.