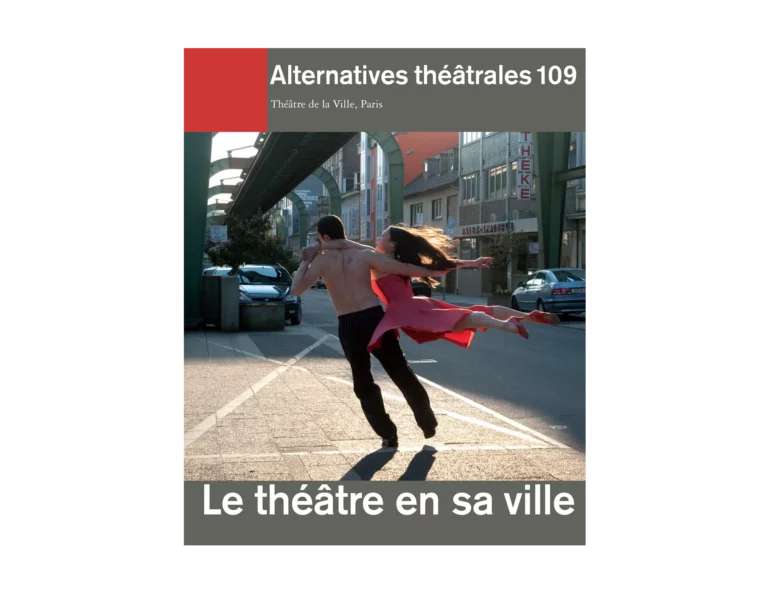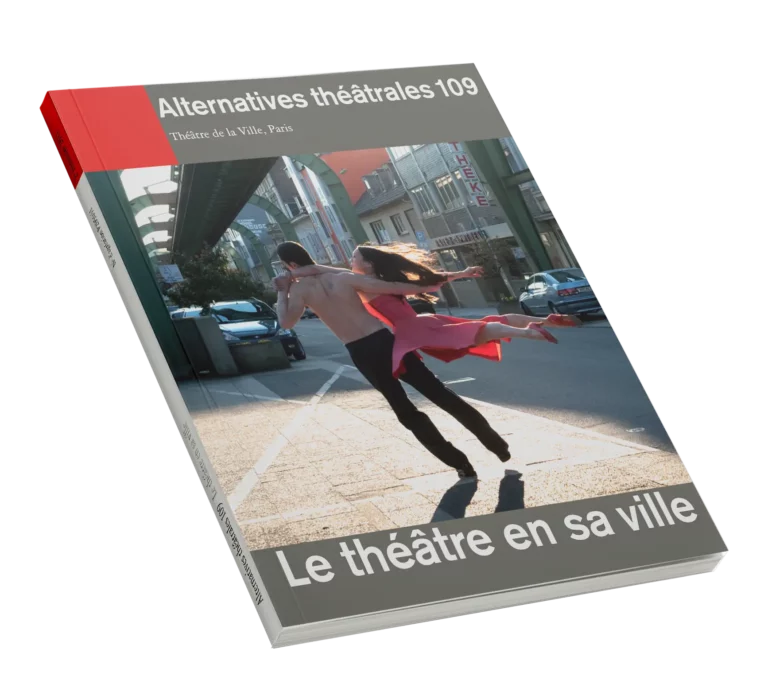Maintes villes ont adopté une institution qui porte leur nom et, parfois, le fait retentir autour du monde en tournée. Mais une cité majuscule comme Paris ne saurait se reconnaître dans un seul théâtre, fût-il sa propriété exclusive, une pièce maîtresse de son patrimoine, un point de mire pour les visiteurs au cœur de son enceinte. Genève a sa Comédie, parmi bien d’autres enseignes : tant pis pour Rousseau. Paris compte plus de deux cents salles1. La faute à Voltaire, certes, mais d’abord à Molière, Corneille et Racine, ensuite à Marivaux, Crébillon, Beaumarchais, et aussi à Scribe, Hugo, Musset, Rostand, Feydeau, Labiche, Becque, Bernard, et encore à Jarry, Claudel, Giraudoux, Anouilh, Montherlant, Sartre, Camus, Ionesco, Beckett, Adamov, enfin aux contemporains qu’on n’omettra sous aucun prétexte. La faute aux entrepreneurs de spectacles en tous genres, ces directeurs artistiques ou administratifs, régisseurs et metteurs en scène qui semèrent des maisons d’illusion pour monter les œuvres de tels auteurs. La faute aux monarques, puis aux ministres de la République qui multiplièrent les lieux de représentation afin d’amplifier l’éclat et l’agrément de leur capitale.
Bâtir sur place
La commune n’en entretient pas moins un Théâtre de la Ville (TV) qu’elle souhaite digne de son prestige : merci Chirac ? Tiberi ? Delanoë ? Non, la décision appartint au préfet Maurice Doublet, car c’est en 1967 qu’une association éponyme fut créée pour prendre en charge la gestion de l’établissement, avec une subvention du Conseil de Paris dont l’exécutif était encore exercé par ce haut fonctionnaire. Un théâtre dit de la Ville doit assumer d’éminentes fonctions symboliques, à l’instar des maisons d’État. À défaut du Tout-Paris qu’un seul spectacle échouerait à fédérer, les élites culturelles s’y congratulent aux premières, attirées par exemple par cette pièce de Jon Fosse pour laquelle Richard Peduzzi a reconstitué une salle du Louvre sur le plateau, le théâtre devenant un musée, figurant lui-même un cimetière : salut Chéreau !2 Il fait jeu égal avec la première institution nationale, pas en matière d’ancienneté, bien sûr, ni de réputation, sans doute, mais de fréquentation, car les deux bâtiments du Châtelet et des Abbesses réunissent plus de 255 000 spectateurs, presque autant que les trois salles de la Comédie-Française, qui totalisa 265 395 entrées au cours de la saison 2008 – 2009. Tout en lui respire l’urbanité : de l’atrium communiquant avec la place au toit de zinc rincé par les averses, des cafés qui le jouxtent aux affiches qui lui servent d’ambassades dans les couloirs du métro.
Pour le comédien Laval, l’un des épistoliers qui prirent le parti de d’Alembert contre Rousseau, fustigeant chez ce dernier, comme deux traits de caractère parallèles, le dénigrement des acteurs et le mépris des femmes, l’établissement permanent d’un spectacle aux frais d’une ville, entre autres avantages « en rendra le séjour plus agréable, et en amusant les citoyens, les empêchera d’abandonner leur pays et d’aller dissiper leurs revenus chez l’étranger ».3 C’est pourquoi il recommandait aux Genevois d’assurer la régie municipale d’un théâtre doté d’une troupe de quinze sujets : « Premièrement il faudrait que ce fut le corps de ville qui se chargeât de la direction. On nommerait quatre commissaires, qui mettraient à la tête du spectacle, comme directeur honoraire, un homme de probité. » Pour veiller à la moralité de l’ensemble, il s’empressait d’ajouter : « Il serait expédient qu’il fût marié ».4 Les édiles parisiens ont retenu une partie de la leçon. S’ils n’obligent pas le directeur à convoler en justes noces, ils n’en président pas moins à sa désignation et à la définition de ses missions.
Indubitablement « de la Ville », donc, par sa position citadine et son statut municipal, « le » Théâtre ne saurait en revanche prétendre à un quelconque monopole de représentation, ne serait-ce que dans la mesure où son pareil se dresse en vis-à-vis. L’édifice du quai de Gesvres se mire au couchant dans les eaux de la fontaine du Palmier, où son jumeau du quai de la Mégisserie, le Théâtre musical de Paris (TMP), trempe son reflet le matin.5 L’origine de ce dédoublement remonte aux chantiers du baron Haussmann. Ils égayèrent comme une nuée de passereaux le public qui se pressait auparavant aux devantures du boulevard du Crime, pour le redistribuer entre divers quartiers de divertissement.6 En 1862, le Cirque Olympique surgit à l’ouest de la place dégagée depuis 1802 par la démolition du fort du Grand Châtelet, face au Théâtre Lyrique, planté de l’autre côté selon les plans d’un même architecte, Gabriel Davioud. Quinze ans plus tard l’art lyrique avait changé de trottoir, car le premier se convertit en Théâtre du Châtelet, alors que le second, ravagé par les incendies de la Commune, se releva de ses cendres en 1875, sous le titre de Théâtre Historique, et fut renommé « des Nations » en 1879, avant d’être baptisé Sarah-Bernhardt par son illustre et immodeste locataire à compter de 1898. Les autorités de Vichy préférèrent le qualifier « de la Cité », histoire d’effacer ce patronyme juif. Puis il devint, sous la direction d’Aman Maistre-Julien, le siège du festival d’art dramatique de Paris, dont l’extraversion justifia de nouveau l’appellation de Théâtre des Nations, de 1947 à 1957.7
Ici l’éruption de mai 1968 ne vira pas au forum permanent que connut l’Odéon, mais elle coïncida avec une petite révolution architecturale. Rendu au public en décembre, après deux ans d’études et de travaux sous la conduite de Jean Perrotet (assisté de Valentin Fabre et Jean Tribel pour la décoration, de René Allio pour la scénographie), le Théâtre de la Ville arborait désormais l’allure d’un « théâtre municipal populaire », à comparer au prototype de Chaillot. Nouveau directeur, Jean Mercure ne prétendait nullement répliquer à Jean Vilar ou Georges Wilson, puisqu’il ne conduisait pas de troupe, mais il ouvrait l’édifice sur la ville, instaurait dans les gradins un semblant de démocratie des regards, élargissait le programme à la danse, à la musique et aux arts des autres continents.8 Dernière mutation en date, l’astre du Châtelet se vit flanqué d’un satellite à Montmartre grâce à la construction en style pseudo- classique du Théâtre des Abbesses,9 inauguré en 1996 avec un opéra « de poche » de Jean Cocteau dont le titre10 – pour la petite histoire – dissuada le maire d’alors, Jean Tiberi, d’y paraître aux côtés de sa femme Xavière, les deux conjoints ayant maille à partir avec la justice. L’exemple excita des envies. L’Odéon, promu Théâtre de l’Europe en 1983, réussit une opération similaire en 2005, enjambant la Seine et franchissant même la ceinture des Maréchaux, lorsque le ministère permit à sa direction d’implanter une annexe aux ateliers du boulevard Berthier, rive droite, où l’activité avait été transférée durant les travaux du théâtre historique de la rive gauche. En 2008, encouragée par la ministre de la Culture Christine Albanel, Muriel Mayette, administratrice générale du Français, alla jusqu’à rêver à haute voix d’affecter la MC93 de Bobigny à la vénérable société, sans parvenir à ses fins cette fois-ci.11

Théâtre de la Ville. Photo LPLT.

La centralité éclatée
Du déplacement à la dérive, il n’y a qu’un saut. Dans le dernier tiers du XXe siècle, tandis que les élus de la petite et de la grande couronne francilienne édifiaient des salles de spectacle un peu partout, les artistes débordèrent du cadre traditionnel de la scène pour investir la salle ou s’épandre dans les rues. Quant aux spectateurs, ils inventèrent une psychogéographie du théâtre au gré de leurs itinéraires.12 Le spectacle vivant n’est plus le principal motif de sortie du public qui se partage entre cinéma et concerts, expositions et salons, mais sa pratique a gagné en volume, en variété et en surface ce qu’elle a perdu en proportion. Pour les passionnés, Paris s’étend d’Ivry-sur-Seine (Théâtre Antoine Vitez) à Bezons (Théâtre Paul Éluard), et de la Ferme du Buisson (Noisiel) à la Ferme du Bonheur (Nanterre). La ville, matrice de mouvements et chaudron d’émotions, ne se résume pas à une projection en deux dimensions. La carte des arts d’interprétation recouvre celle du RER. Outre la liste des salles commerciales et subventionnées, elle inclut un catalogue des conservatoires publics et des cours privés d’art dramatique, des locaux prêtés aux amateurs, des maisons de production et des abris de compagnies, des ateliers, friches, sites de résidence et espaces intermédiaires où s’échafaudent les alternatives.13 Il y a belle lurette que l’art ne tourne plus autour d’un axe. Qui oserait encore reléguer la Cartoucherie de Vincennes à la périphérie du théâtre parisien, comme si le Soleil, la Tempête, l’Aquarium, le Chaudron et l’Épée de bois n’avaient écrit depuis 1970 des pages majeures de sa chronique ?14