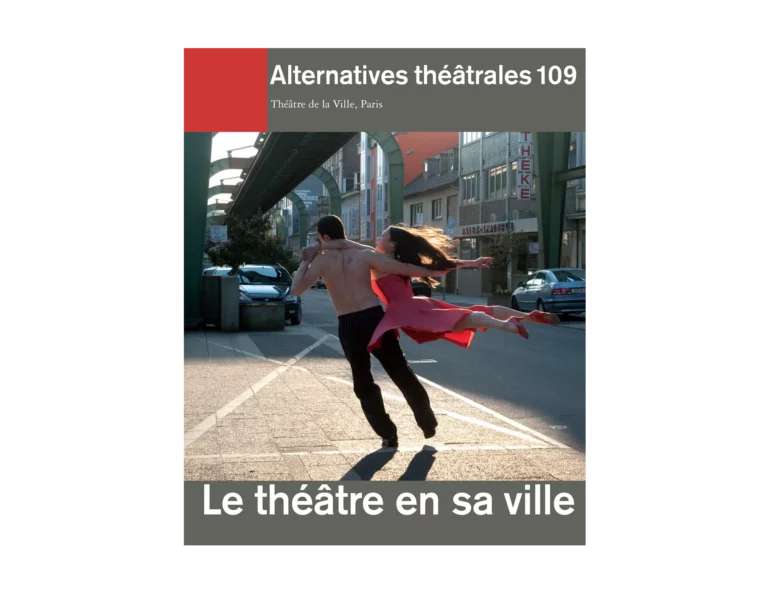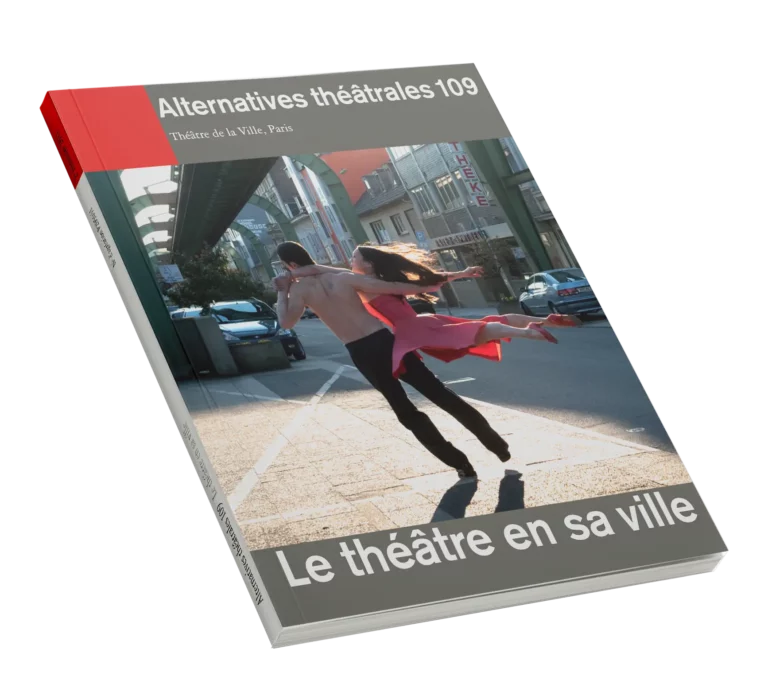NOUS VOUDRIONS être comme lui…» – fragment d’un adage célèbre qui décline les relations que l’intellectuel russe pourrait avoir avec les écrivains de son pays, de Gogol à Tchekhov en passant par Tolstoï et Dostoïevski. « Être comme lui…» rapport d’intimité non intimidante, relation de sympathie avec un double que l’on ne fuit pas. C’est lui seul qui la permet.
Prendre connaissance d’un lieu propre à un écrivain invite à un voyage dans l’œuvre, enrichi grâce à des remarques inspirées par la simple relation, soit avec la topographie d’une maison – comme chez Goethe à Weimar – soit à la relation de cette maison avec la ville – comme chez Dostoïevski à Saint Petersburg – soit aux aveux implicites d’un espace privé – comme chez Ibsen à Oslo, Strindberg à Stockholm ou Creanga, célèbre auteur roumain, à Iassy. Il y a toujours des révélations au coin d’une fenêtre ou d’un lit, d’un bureau ou d’un jardin. On éprouve chaque fois, plus ou moins, leur impact comme à Bonn où, derrière la vitre d’une armoire, je regarde effaré les instruments de torture utilisés par Beethoven pour palier les handicapes de la surdité ? Non, il ne s’agit pas de s’engluer dans le fétichisme monomaniaque ou dans la servitude idolâtre, non, il s’agit d’admettre que l’homme, et surtout l’artiste, structure les éléments d’un autoportrait à travers les choix opérés dans le concret de son espace vécu. Ce que Bachelard généralisait à propos de l’espace intervient ici de manière ponctuelle et renvoie à l’œuvre qui a gagné son autonomie, certes, tout en portant la marque de ce que, lors de la visite, on découvre tout en saisissant sa portée.
À Melikhovo où Tchekhov s’est refugié, à « mi-distance » de Moscou, comment ne pas s’arrêter longtemps devant les photos accrochées au mur de son salon : c’est un concentré de la littérature russe, son Panthéon personnel dominé par la photo centrale, plus importante que les autres, celle de Tolstoï. Tchekhov ne se pensait ni ne se voulait seul, il vivait les yeux rivés sur ses pairs. Il les a aimés et jugés, mais il ne les a ni rejetés ni occultés. Il a écrit en s’inscrivant dans une famille qu’il s’est plu à feuilleter dans l’intimité de sa retraite. Il a fui les invités qui l’envahissaient en ville, mais a amené avec lui, ici, ses convives muets, ses partenaires littéraires.
Des œuvres également : un croquis et une aquarelle de Lévitan, l’ami le plus cher avec lequel il se disputa et se réconcilia, un tableau de son frère qui montre une jeune femme éplorée – elle vient de recevoir une lettre d’un autre membre de la famille – un autre avec une belle adolescente qui sort de l’ombre… lié lui aussi à la destinée d’un ami. Tout ce que l’on voit porte le sceau de l’implication biographique. Non pas des œuvres d’art réunies au hasard, mais des éclats de vie saisis sur la toile ! Tchekhov vit parmi ses proches. Au fond, dans la dernière pièce, se détache son portrait en héros inhabituellement romantique présent dans toutes les biographies, portrait signé par son frère.
Ces objets bien rangés, ne parlent-ils pas au connaisseur seulement ? De même que dans un musée de théâtre, rien n’est éloquent sans un savoir préalable, sans une projection développée à partir de l’œuvre ou de l’artiste. La photo du jeu de loto que je prends répond au souvenir du même jeu de loto et de ses échos funèbres au IVe acte de LA MOUETTE que Tchekhov a justement écrite ici. Translation du concret et de la fiction, du vécu et de l’imaginaire… Et comment ne pas se rappeler que Lioubov Ranevskaia, de retour de Paris, en pleine nuit, réclame dans ce pays où même les rues portent le nom du thé – oui, à Moscou, il y a « la rue du thé » ! – du café, de même que Tchekhov qui, lui aussi, le préférait. En regardant le samovar peu utilisé et la machine à café, presque placée en position centrale, leur déséquilibre renvoie à l’arrivée nocturne de la maîtresse qui regagne la cerisaie ! Sans oublier d’évoquer tous ces objets liés à la mythologie tchekhovienne nourrie par l’extraordinaire legs photographique qui a fixé ce que l’on aperçoit ici sur les tables et bureaux : le pince-nez, utilisé à partir de trente-sept ans seulement, les cannes et les chapeaux. Cet écho produit par les objets exposés s’explique par leur présence dans la mémoire du visiteur que je suis : je vois ce que je savais. Et c’est cela qui émeut ! Comme lorsque je repère derrière une porte la fameuse casquette blanche ou ailleurs, loin, à Yalta, dans son logement loué pour six mois, à la datcha Omer, le manteau et le chapeau noirs qui ont fait la couverture de tant de volumes. Peu importe leur authenticité, car il s’agit chaque fois de « vraies » copies, pour paraphraser la formule d’un artisan grec vendant une icône récente… Ces objets vous guident et renvoient à un monde connu. La visite, en un certain sens, suscite sa résurrection et vous y entraine : nous découvrons ce dont nous sommes des familiers. Voilà le paradoxe de cette séduction vivante et « muséale » !
Dans la bibliothèque, d’un côté sont rangés les livres de médecine, de l’autre les œuvres littéraires. Un même meuble, mais divisé. Pas de mélange. On retrouve Tchekhov qui a exercé les deux pratiques tout en les dissociant avec attention.
À Moscou, sur la porte de la maison une plaque en bronze indique : A. P. Tchekhov, docteur. Ici, il se fait appeler du nom de « vratch », vieux terme russe qui confond le guérisseur et le médecin. « L’ambulatorium », à savoir le cabinet, occupe toute une maisonnette. La salle d’attente d’abord, et ensuite la pièce où il exerce me trouble car les objets me sont familiers, les mêmes que ceux du cabinet de mon père. Filiation médicale… Sur le bureau, les ustensiles de l’écriture voisinent avec une brochure sur « le choléra » qui avait ravagé à l’époque la Russie de même que cet été les incendies. Cet homme soignait ici… et je me demande d’où vient cette affirmation, selon laquelle il ne s’intéressait qu’aux enfants et aux putains, les deux extrêmes de la fragilité humaine !