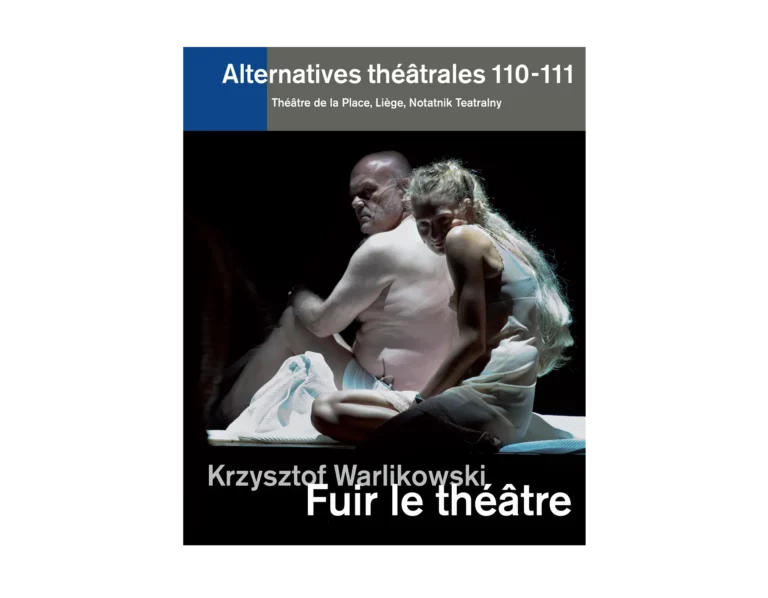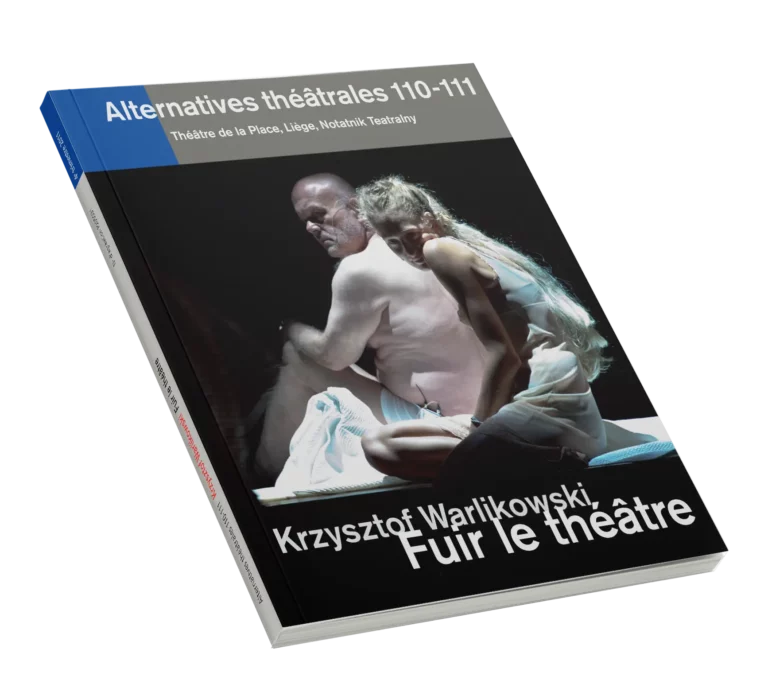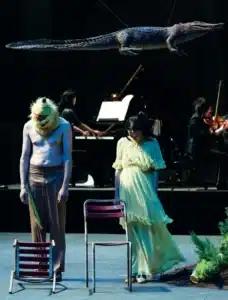Georges Banu manie la polysémie avec malice. La soirée qu’il anime le 4 mai 2011 s’intitule « Retour de l’Est ». Quel Est et quel retour ? L’Est dont on revient ou l’Est qui revient à nous ? L’Est qui retourne à un état initial dans une perspective de cyclicité nietzschéenne ? Plus simplement s’agit-il d’une « vue rétrospective », comme le dit communément un metteur en scène à son équipe après une répétition ininterrompue (« Je vous fais quelques retours »), ensemble impressionniste ou raisonné de remarques et commentaires divers sur ce qui vient d’avoir lieu ?
Bruxelles, La Bellone.
Pour un soir « lieu du retour ». Si on revient de, on revient aussi à. Ce soir du 4 mai 2011, c’est à la Bellone que reviennent donc Georges Banu et ses invités, Krzysztof Warlikowski, Felix Alexa, Anton Kouznetsov et Jean-Pierre Thibaudat. Trois quarts de siècle après le Retour de l’URSS de Gide, ces cinq-ci tentent de prendre le pouls d’une mutation perpétuellement en cours. De mesurer les victoires et les permanences, les basculements et les souffrances, les quêtes et les revirements.
Georges Banu : Après la Chute du Mur il y a eu, de Moscou à Bucarest et Prague, une première vague de spectacles marqués par un trop explicite désir de mise à jour de l’esthétique de l’Est à partir des principes un peu rapidement empruntés à l’Ouest, maladie vite dépassée car, depuis plus d’une dizaine d’années, se sont imposés des artistes particulièrement importants qui ne se désolidarisent plus, bien au contraire, intègrent l’expérience de l’Est et proposent des spectacles qui affichent une posture originale, inédite. Ainsi nous passons de L’Est désorienté, diagnostic à l’époque juste, que nous avons formulé dans un numéro ancien d’Alternatives théâtrales1 à un autre constat que l’on pourrait appelait L’Est assumé. De nombreux artistes, non seulement de théâtre, se réfèrent à l’expérience de l’Est comme à une expérience contradictoire, à la fois traumatisante et riche. Peut-être que ce qui persiste du passé communiste cesse d’être aussi visible qu’auparavant mais demeure encore perceptible. Il est flagrant que beaucoup d’artistes travaillent à partir de ce fond résiduel qui les nourrit, qui renvoie à une blessure, pas tout à fait cicatrisée. Mais, l’Est, au-delà de l’exercice du pouvoir et du politique dans leurs manifestations les plus absurdes, du quotidien avec tout ce qu’il comportait comme désagrément et interdits, reste attaché au souvenir d’une certaine solidarité disparue, d’une socialité de résistance qui servait de terreau à l’art, surtout théâtral ; c’est pourquoi « le retour de l’Est » se présente comme un symptôme complexe. Cela s’explique aussi par le fait que l’écroulement du système en 1989 a libéré la société tout en produisant, sur fond d’essor agressif du capitalisme sauvage, d’autres traumatismes. De là, vient, sans doute, l’émergence d’une relation ambiguë à l’égard de l’Est, ambiguïté plus contrastée que l’Östalgie tant vantée dans l’Allemagne, ambiguïté qui intègre, elle, les éléments d’un procès et la persistance des souvenirs d’un autre monde. Au moins pour les générations d’artistes qui ont fait l’expérience de ce monde engendré à l’Es de l’Europe sous la férule de l’occupation soviétique. Mais les relations entretenues avec le passé des régimes déchus diffèrent parfois d’un art à l’autre et, ça va de soi, d’un artiste à l’autre.
Un cas significatif : le formidable essor du cinéma roumain marqué d’abord par le film de Cristian Mungiu qui a eu la Palme d’Or à Cannes2. Des dizaines de ces films se nourrissent de l’expérience de l’Est. Ces films n’adoptent ni une position nostalgique, ni une autre dramatique, mais, en majorité, se réclament d’une position ironique. Ils racontent un passé révolu sur
fond de dérision et de tristesse pudique : tant de vies gâchées au nom d’un régime et d’un pouvoir dont la manière absurde de procéder est flagrante. Il y a une distance qui confirme presque le fameux adage marxiste : il faut se séparer du passé en riant ! Le théâtre, à l’exception de quelques textes surtout russes, n’a pas adopté cette posture et cultive plutôt le déchirement douloureux, l’approche dramatique… en Roumanie, on rit au cinéma, et on déplore au théâtre. Mais, ni l’un, ni l’autre des deux arts ne font l’économie de la réflexion sur l’Est et se retombées aujourd’hui encore. Vingt ans après…
Jean-Pierre Thibaudat : Lors de mes premiers voyages à l’Est dans les années quatre-vingt, je me suis aperçu que le théâtre n’était pas du côté de la culture mais du côté de la vie. Le théâtre faisait partie de la vie des gens. Pas besoin d’action culturelle : on allait au théâtre comme chez l’épicier, pour se nourrir. Tout le monde y allait et le rituel était très fort — l’importance cruciale des vestiaires dans les théâtres à l’Est m’a toujours fasciné. Si quelque chose s’est perdu, quelque chose de cela perdure aussi. Par ailleurs, on arrivait très souvent dans des lieux où tout était fatigué. Fatigue des années passées dans ce système soviétique, fatigue de l’architecture, fatigue des murs, fatigue des gens. Les créateurs faisaient des spectacles au-delà de la fatigue, travaillaient avec des résidus du monde. Le temps passant les choses changent. Le Palais de la culture de Varsovie est pour moi emblématique de l’Est : caractéristique architecturalement, honni au moment des changements, mais impossible à détruire, et encore très central aujourd’hui. À Kiev, aujourd’hui, le schéma est typique : on trouve un théâtre institutionnel très puissant dans ses architectures, moins dans ses financements, qui développe un théâtre dans des esthétiques anciennes par des metteurs en scène âgés. Parallèlement, dans des lieux souvent minuscules, d’autres cherchent à créer de nouvelles esthétiques.
Des aventures théâtrales passionnantes ont lieu dans des salles de vingt places au troisième étage d’un immeuble à appartements, où tous les membres de la troupe font tout. Notons aussi que tous ces petits lieux sont des théâtres de répertoire, avec troupes permanentes et alternance des spectacles. La norme à l’Est est de faire vivre les spectacles très longtemps, parfois bien après la mort de leur créateur. Certains théâtres de vingt places donnent dix à quinze spectacles différents par mois, joués par la même troupe. La vie biologique des spectacles n’est pas du tout la même. Parfois, sur le très long terme, certains spectacles restent formidables, parfois ils se fossilisent et perdent tout intérêt, parfois ils vieillissent comme un bon vin et prennent de la valeur avec les années. Où, ailleurs qu’à l’Est, voit-on des spectacles répétés six mois, un an ou parfois un an et demi ? Le système des troupes permanentes permet cela.
Georges Banu : Ce travail dans la durée, propre à un système qui s’appuie sur des structures théâtrales qui disposent d’une troupe et pratiquent l’alternance, outre des disfonctionnements regrettables, œuvre à la constitution d’une culture théâtrale spécifique. Les spectateurs peuvent voir, plusieurs années durant, des spectacles emblématiques. À force d’assister à de grands spectacles qui ne disparaissent pas tout de suite, se développe l’attrait du théâtre et sa valorisation. Les troupes constituent un répertoire qui se décline dans le temps et cela permet à un public non seulement de le découvrir mais de l’assimiler à une sorte de bibliothèque que l’on peut consulter. Cela permet tout à la fois la maturation des acteurs et la maturation des publics. Un des mérites de cette vie théâtrale tant décriée fut de permettre la découverte aussi bien que le retour à des spectacles qui ne meurent pas avec la rapidité douloureuse que nous nous connaissons à l’Ouest. Cela explique, sans doute, pourquoi certains parmi eux finissent par être mythiques.
Anton Kouznetsov : Mon parcours est assez malheureux. J’ai dirigé un théâtre national dans une ville d’un million d’habitants, capitale d’une région grande comme la moitié de l’Allemagne. Quand j’ai commencé à diriger ce théâtre, en 1998, la ville était ouverte, son gouverneur était élu et souhaitait l’ouverture du théâtre vers l’Europe et la France. J’étais très jeune, je dirigeais un théâtre avec cent soixante-seize employés dont cinquante-six comédiens de tous âges, tous les corps de métier étaient présents, on pouvait tout faire. Mais nous n’avions pas de subvention de Moscou ; Moscou avait déjà cessé de subventionner les théâtres dans les villes de province.
La troupe était extrêmement dynamique, on y croyait. Les échanges avec la France étaient nombreux et nous étions très heureux. On a vraiment vécu cinq ans de bonheur. Lorsque Poutine est devenu président, les gouverneurs n’ont plus été nommés mais élus. Depuis 1967, personne n’avait touché à l’équipement de ce lieu et nous sommes parvenus à la remettre à neuf. Le théâtre est alors devenu intéressant comme lieu de location pour les mafias locales, souvent liées à l’État. Une vraie guerre, qui a duré trois ans autour de ce lieu très équipé. J’ai fini par abandonner quand j’ai compris que je pouvais y laisser ma peau. Ils ont été jusqu’à annoncer ma mort à la radio locale ; ma mère était encore vivante, c’était désagréable. Des choses assez radicales ont commencé : l’annulation des spectacles par exemple, ordonnée
par le ministère de la culture régional. Ils appellent en demandant « Vous avez quoi comme spectacle ce soir ?

Combien de places sont vendues ? Sept cents ? Ok, on annule. Trois généraux débarquent de Moscou ; on doit faire la fête des écoles militaires. Annulez et remboursez tout le monde ». Et quand on demande un ordre écrit à ce ministère de tutelle, il refuse. Et quand on porte l’affaire sur la place publique, on est confronté à d’autres difficultés : l’autorisation de manifester s’accompagne d’une date et d’une heure imposées, qui tombent systématiquement pendant les heures de travail, travail que l’on n’est pas autorisé à quitter pour manifester. Les manifestants sont filmés, repérés.
Georges Banu : En tant que directeur, comment peut-on gérer la tension entre le désir de créer un nouveau répertoire et la persistance des anciennes structures ? Quelles stratégies adopter?Quelles résistances enfreindre ?
Anton Kouznetsov : Le système est encore très hiérarchique, il y a encore d’anciens comédiens du peuple avec leurs galons accumulés. Un véritable fossé existe à ce niveau entre les différentes générations à l’œuvre. La génération qui a quitté le parti communiste est encore au pouvoir. Sous prétexte de préserver le patrimoine, elle garde le pouvoir. En acceptant de diriger Saratov, je suis devenu une exception : personne de ma génération ne souhaite diriger un lieu. C’est une galère monstrueuse : tu hérites d’une troupe, la gestion est très contraignante. Ma dernière conversation avec le ministre de la culture a été la suivante : « Vous jouez Koltès dans le répertoire ? » / « Oui. » /«Et Genet?»/«Oui. » /«J’ai entendu aussi que vous voudriez monter La garce » / « Peut-être, oui. » / « Mais c’est des pédés tout ça. La Scène National russe n’a pas besoin de tous ces pédés d’auteurs contemporains. ». C’est le Ministre de la culture qui
me parlait très sérieusement ! « Et, donc, à l’opéra, Tchaïkovski on arrête ? » Ilm’a répondu « Anton, mesure tes mots ». Il y a une véritable réforme poutinienne des théâtres. Il y a eu une liste présidentielle des théâtres dont la subvention a été maintenue ou triplée tandis qu’elle était supprimée à tous les autres, qui devenaient des garages vides permettant aux grands théâtres
de voyager de temps en temps. Le métier s’est donc retrouvé séparé en deux de manière très nette.
Felix Alexa : Il faut considérer la réalité de l’Est dans son ensemble et aussi les particularismes propres à chacun des pays. Il y a eu une rupture très violente. On jugeait tout en noir et blanc. La catastrophe appartenait au passé ; l’énergie et l’espoir au présent. Après quelques années, on s’est aperçu que les théâtres s’étaient vidés. Avant, les théâtres étaient pleins, pas uniquement pour des raisons culturelles mais aussi sociales : les théâtres constituaient une sorte de territoire libre ; on y allait pour se sentir libre. Soudainement, ces territoires libres se sont vidés complètement parce qu’un véritable territoire libre existait en dehors des théâtres. Après quelque temps, on a constaté que les nouveaux territoires qu’on pensait libres ne l’étaient pas tant et les gens sont alors revenus au théâtre. Ils sont aussi revenus parce qu’ils voulaient un autre théâtre. Le gris a alors fait son apparition. La rupture était aussi générationnelle. En Roumanie, le théâtre luttait contre le régime. Les spectacles avaient parfois des rapports très violents avec le politique, avec la censure. Le théâtre trouvait des moyens pour dire les choses impossibles à dire ailleurs. Ma génération a connu les deux systèmes. Quand je parle aujourd’hui du temps passé avec mes étudiants, je vois qu’ils ne comprennent pas. Mais ils font parfois des mises en scènes en rapport avec l’ancienne situation et on les sent perdus. Notre génération a vécu cette rupture, qui a été très importante. Mon premier spectacle à l’Institut de Théâtre de Bucarest était un texte de Koltès. Aujourd’hui, monter Koltès en Roumanie est devenu normal mais à l’époque c’était un choc total. J’ai dû me battre, pas seulement pour imposer le texte, mais aussi pour travailler d’une autre façon avec les acteurs. J’ai vécu mes deux premières années études sous le communisme et les deux dernières sous la liberté. C’était schizophrène. Je me rappelle avoir présenté Comme il vous plaira à un examen pendant les événements. Les mineurs étaient venus à Bucarest pour mettre le feu aux institutions et je jouais du Shakespeare. Le théâtre très réaliste qui se jouait dans la rue nous influençait. Finalement, l’Est s’est retrouvé ces dernières années. Nous avons intégré cette expérience dure, violente, déchirante, et nous pouvons l’utiliser et la sublimer. Je n’étais pas fier du tout d’avoir vécu vingt ans dans le communisme, ça a brisé mon adolescence. Mais j’ai compris que cette expérience de vie pouvait être utilisée dans le théâtre. Ma vie de théâtre a commencé àce moment-là. Nous avons eu de la chance. La génération précédente a été complètement cassée
par cette expérience. Lorsque Krzysztof Warlikowski et moi-même étions jeunes assistants de Peter Brook à Paris, nous avions en commun cette expérience unique : être passés par une sorte de purgatoire dans nos pays respectifs. C’est très difficile d’entendre Anton et de s’apercevoir qu’il y a aujourd’hui en Russie un système qui fonctionne comme il y a trente ans. Les textes de nos auteurs ont aussi complètement changé. En Roumanie, toute une génération a essayé de changer le langage des pièces, l’histoire des pièces, pas nécessai- rement dans le bon sens d’ailleurs. L’interdiction antérieure autour du langage parlé conduit parfois certains auteurs à penser qu’il suffit d’utiliser ce langage autrefois interdit pour être intéressant. C’est de la modernité superficielle. Au fond, les Russes ont fixé un modèle qui ne doit pas être intégralement détruit. Ilnous faut trouver les détails à modifier à l’intérieur de ce système. Le système occidental ne trouverait pas sa place dans nos pays.
Krzysztof Warlikowski : La vie en Pologne quand j’avais vingt ans correspond pour moi à une enfance ratée. Je ne pensais qu’à la manière de quitter tout ça pour commencer ma propre vie. Je parle d’enfance ratée car c’est un matériau très riche dans le travail artistique, fertile et fructueux. Quand tu es fier de ton pays, que tu comprends et apprécie son système, c’est très différent. Quand tu ne comprends rien, quand tu n’apprécies pas, quand tu te sens étranger chez toi ou que tu es trop sensible, tu ne peux rien faire. J’ai eu la chance de vivre les changements. Je crois qu’aujourd’hui il est très difficile pour les jeunes d’appartenir à cette société un peu vide. Après le moment d’enthousiasme où tout paraît possible, on recommence de zéro, ça dure quelques années et puis finalement on perd. Je ne crois en aucun système. J’ai quitté la Pologne, puis j’ai mûri et je suis revenu, j’y ai fait du théâtre mais tout me dérangeait, à tous les niveaux. Puis je suis sorti des théâtres. Aujourd’hui je connais tous les systèmes et je n’en vois pas de bon pour moi. C’est très difficile de travailler pour une institution. Tout est commercialisé. On ne devrait pas parler de systèmes de l’Est ou de l’Ouest, mais de la nature du théâtre.
Jean-Pierre Thibaudat : Quelles sont les différences entre le travail à l’Odéon et son équivalent en Pologne ?
Krzysztof Warlikowski : On ne peut pas comparer Pologne et France parce que les institutions sont de plus en plus cyniques. Il n’y a pas de place pour l’expérimentation. Le résultat commercial est obligatoire, autant à l’Est qu’à l’Ouest.