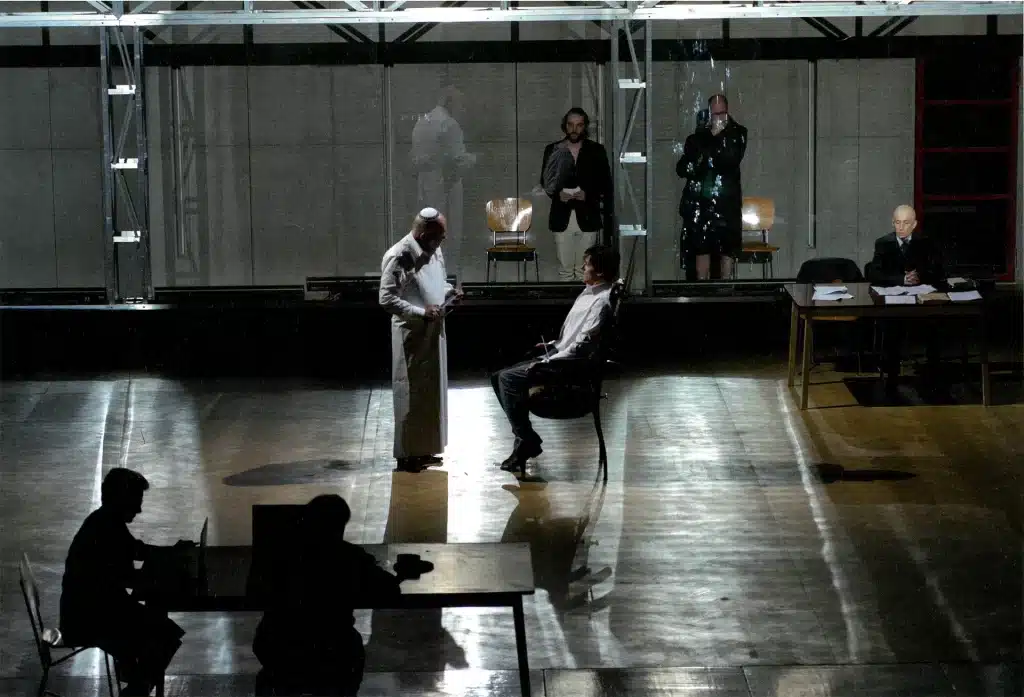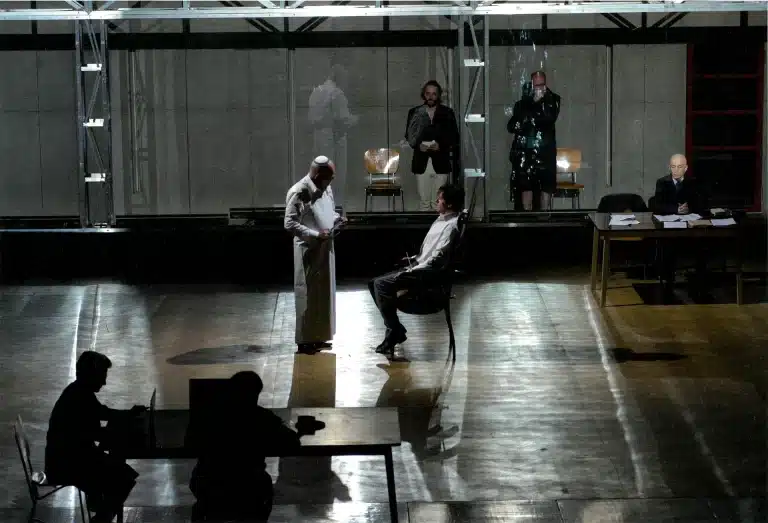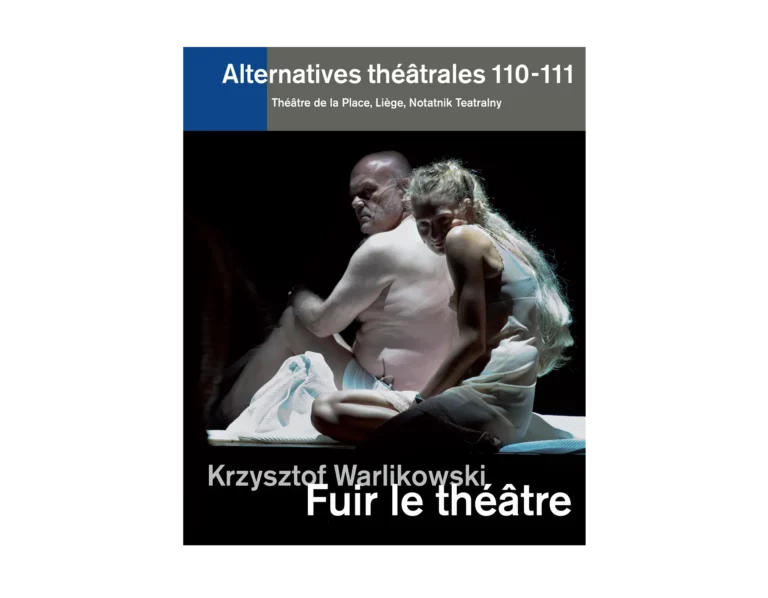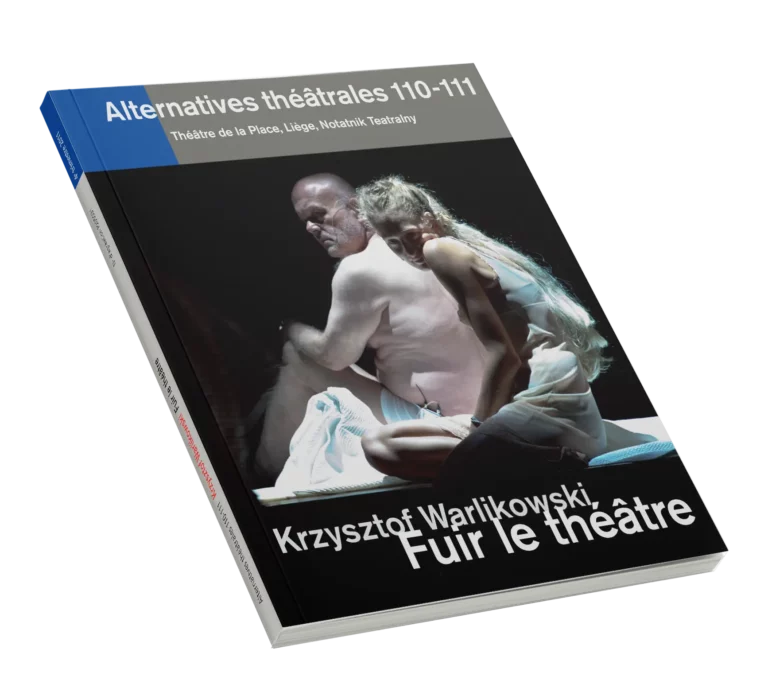Agata Skwarczyńska : Lorsque vous avez rencontré Krzysztof Warlikowski, aviez-vous le pressentiment, ou l’intuition, que ce pouvait être un lien pour toute la vie ?
Matgorzata Szczęśniak : C’est une question assez personnelle. Que souhaiteriez-vous entendre ?
A.S.: Le début m’intéresse. Les premiers souvenirs.
M.S.: Nous souhaitions tout simplement faire quelque chose de semblable dans la vie, c’est peut-être cela qui nous a liés. Ilfaut reconnaître que, dès le début, nous avions des passions communes. Puis, nous les avons réalisées ensemble.
A.S.: Je suis tombée sur une déclaration selon laquelle c’est la rencontre avec Warlikowski qui vous a incitée à envisager la scénographie comme un métier possible.
M.S.: Non, cela n’avait rien de commun avec Krzysztof. Lui non plus n’avait pas étudié la mise en scène lorsque nous nous sommes rencontrés. Il a commencé pas mal d’années après. D’abord j’ai suivi une école artistique, puis j’ai voulu étudier à l’université. J’ai étudié la psychologie, la philosophie, j’ai été jusqu’au doctorat et, à la fin, j’ai réalisé que je voulais tout de même revenir vers l’art, que c’était peut-être ma nature et ma façon de me confronter au monde. C’est au moment où grandissait cette inquiétude et se posait la question de ce qui était plus important pour moi : l’art ou l’étude, que j’ai rencontré Krzysztof. Il était étudiant en histoire et commençait des études de philologie romane et de philosophie. Nous étions encore loin de réaliser nos rêves mais ils ont commencé tout doucement à se cristalliser. Quelques années après, nous sommes entrés à l’Académie, Krzysztof à l’Académie théâtrale et moi à l’Académie des Beaux-Arts.
A.S.: Avec l’idée d’un travail commun dans l’avenir ?
M.S.: De telles hypothèses n’existent pas. Cela ne se calcule pas. Nous n’avons pas décidé que nous serions un couple qui ferait ensemble du théâtre et de la scénographie. Je peux à chaque moment commencer autre chose, Krzysztof également s’il en avait envie, pourrait s’occuper d’autre chose. Il n’y a pas de principe a priori.
A.S.: Il y a parfois dans la vie des rencontres fortuites qui peuvent nous détourner des voies choisies et nous pousser dans une autre direction.
M.S.: Il y a sûrement de cela. Puisque j’ai étudié pendant dix ans la psychologie et ensuite nous avons étudié ensemble la philosophie, cela signifie que nous étions déjà des gens qui recherchaient quelque chose de similaire. Si tu rencontres un autre individu qui cherche des choses semblables àtoi, cela te réjouit, te donne des ailes. Seul, c’est certainement plus dur. En somme, nous étions des universitaires. Nous étions passionnés par la connaissance et le savoir. Nous étudiions très sérieusement, nous lisions d’énormes quantités de livres, nous écrivions des rapports, nous analysions les textes, nous passions des journées dans les bibliothèques — c’était un travail, quelque chose qui nous comblait. Mais la décision, surtout pour moi, de s’occuper d’art était certainement difficile.
A.S.: Paris a été une étape importante dans votre vie et dans vos recherches.
M.S.: Nous en avons parlé récemment, et si quelque chose nous a formés extérieurement, on peut dire que c’est justement Paris. L’institut le plus dynamique de l’époque communiste et post communiste en Pologne, et surtout à Cracovie, était l’Institut français. À l’époque Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir y sont venus, nous avons vu les premiers films de Roland Topor, d’André Breton. Krzysztof a réalisé ses premiers pas sur la scène de l’Institut français. Cette culture, appelons-la humaniste, nous parvenait justement par ce lieu. Nous avons tous les deux étudié le français et donc la France était quelque part en nous. Paris était ce lieu où l’on pouvait ressentir un autre monde. J’y suis allée pour la première fois dans les années soixante-dix. La première chose que j’ai vue, ce fut l’université Jussieu où on m’a montré le lieu des plus grandes manifestations de 1968. Un étudiant y avait été assassiné lorsque la police a voulu pénétrer à l’intérieur des locaux… Cette information est toujours visible aujourd’hui sur la façade du bâtiment. Au début il n’était donc pas question de snobisme bourgeois, mais de cet aspect de liberté révolutionnaire de Paris.
Je suis revenue en Pologne en novembre, juste avant l’état de guerre. Mon ami français considérait comme une folie de revenir volontairement en Pologne. Il ne supportait pas la Pologne : ce qui s’y passait ne lui plaisait pas et il ne pouvait comprendre qu’un homme libre puisse volontairement revenir dans ce lieu oùil ne pouvait être libre. Quand la première possibilité de partir à l’étranger est apparue, après l’état de guerre, mes amis de France nous ont envoyé les papiers nécessaires et, avec Krzysztof, nous sommes venus à Paris. Nous y avons passé presque deux ans. Krzysztof étudiait à la Sorbonne le théâtre antique, il était alors encore passionné par l’histoire. Nous avons rencontré des gens formidables. Surtout des jeunes, de nos âges qui, comme nous, n’avaient pas d’argent. Des gens de divers coins du monde, très étranges. Nous étudiions, nous absorbions tout ce qu’il était possible d’absorber et qui n’existait pas en Pologne. Paris me donnait l’énergie et ne nous limitait pas, nous, les étrangers, les jeunes qui n’avions pas d’argent. La ville était abordable, elle nous permettait de profiter de ce qu’elle offrait. Nous avions un atelier commun à Oberkampf, à l’époque un quartier très pauvre d’artisans, de petits ateliers, de petites fabriques qui est maintenant l’un des coins les plus snobs.
Notre vieil ami de Paris est Denis Guéguin qui nous fait souvent des vidéos. Nous l’avons connu, il y a plus de vingt ans, dans ce groupe à Oberkampf. Il faisait des films expérimentaux et voulait être cinéaste. Il amême étudié un certain temps l’animation àHédz. Ils’occupe toujours de films expérimentaux et réalise de magnifiques photos. Beaucoup de gens de cette époque sont toujours en contact avec nous. Ils nous soutiennent toujours. Je dis, en plaisantant, qu’une partie est morte et l’autre fait avec nous du théâtre. C’était l’époque où, pour la première fois à Paris, est apparu le SIDA. Nous étions assis dans le métro, nous lisions les journaux et nous nous demandions ce qu’était ce SIDA. Cela nous semblait très étrange. L’annonce de cette maladie mortelle était pour nous un choc. Tout le monde était absorbé par ça. Tout-Paris en parlait. En Pologne, les réactions étaient différentes, les gens cachaient la maladie. Ce sentiment de communauté, cette préoccupation, c’est une chose que j’ai ressentie dans ma prime jeunesse lorsque je suivais des cours d’anglais chez la comtesse Potocka, une dame charmante au demeurant. Durant le cours, elle avait branché doucement un tout petit téléviseur. J’ai entendu tout à coup un cri : « Magdalena » — elle m’appelait toujours Magdalena — « À genoux ! » Elle avait un très joli prie-dieu. Elle m’a expliqué : « Les cosmonautes ont débarqué sur la lune ! Il faut prier pour eux !». Ainsi, en toute innocence, à côté de Mre Potocka, les yeux rivés vers l’écran, je priais pour qu’il n’arrive rien aux astronautes. La conquête de la lune était un événement si important qu’il a uni des hommes d’orientation et de religions très différentes. Cette femme, à l’époque déjà assez âgée, était pourtant d’un autre monde. Les cosmonautes américains sur la lune ont uni tous les gens dans une pensée commune. Je ne sais pas si, aujourd’hui, de tels moments, traduisant une réaction commune face à certains faits qui se déroulent dans le monde et non manipulés par les médias, peuvent encore arriver. Maintenant, à la base, tout est manipulé. On peut manipuler les matchs, les théâtres, les manifestations, les carrières, les deuils nationaux, tout, tout simplement. Et toutes ces manipulations n’unissent pas les gens mais les divisent. Paris était ainsi. Évidemment, nous nous rendions compte que rester là-bas trop longtemps, contrairement à l’opinion admise, ne nous donnait rien de concret. C’est pourquoi nous avons décidé de revenir en Pologne. C’était absolument pragmatique. Après quelques années d’études à l’Université nous avons pris la décision de revenir et de préparer des études artistiques en Pologne. Nous sommes revenus, nous avons réussi nos examens et nous avons étudié. Que faire d’autre ? Nous avons terminé nos études et nous avons obtenu nos diplômes.
A.S.: C’est aussi le moment où a commencé à se former le groupe composé de différents artistes qui, avec le temps, ont formé le noyau du théâtre de Warlikowski. Étaient-ce des rencontres liées au hasard ou consécutives à de longues recherches d’individus aux potentialités artistiques intéressantes ?
M.S.: Nous avions déjà commencé à travailler ensemble durant les études. J’aidais Krzysztof et je me suis mêlée à la vie de l’École de Théâtre. Durant les études, on fait beaucoup d’exercices pratiques et l’on choisit les acteurs parmi les camarades de la Section des acteurs. C’est ainsi qu’ont commencé nos premières connaissances et amitiés avec les acteurs. J’ai travaillé aussi auprès d’autres disciplines, notamment dans les sections d’acteurs avec Jean-Pierre Garnier, Marta Stebnicka, Jan Peszek ou Grzegorz Jarzyna. Sur d’excellents textes de Thomas Mann, Elias Canetti, Fiedor Dostoïevski, Witold Gombrowicz. Tout était alors très intensif et les acteurs, jeunes. Nous avons commencé à travailler avec Jacek Poniedziatek, Ania Radwan, Staszek Mucha, Marysia Peszk, Marek Kalita. Quoique, je crois qu’avec Marek nous n’avons pas travaillé à l’école. Nous avons noué des amitiés qui nous ont ensuite facilité le travail avec les acteurs car nous nous connaissions bien et quand ils ont commencé systématiquement à passer de Cracovie à Varsovie, nous sommes restés ensemble. Que nous nous soyons tous retrouvés tout à coup à Varsovie nous a donné de la force. Nous avions une passion : le théâtre. Nous étions tous jeunes, plein d’énergie et d’enthousiasme pour l’art. Les unions et les amitiés de cette époque étaient très passionnées et ardentes. Je ne sais pas comment c’est maintenant : les jeunes gens veulent sans doute faire des films, travailler à la télévision ou rêvent de se retrouver à Hollywood.
A.S.: Ce modèle de travail basé sur l’intimité, sur la confiance, sur l’amitié, est-il le seul modèle de travail sensé dans le théâtre ?
M.S.: En principe, je n’imagine pas un autre modèle de coopération mais cela ne veut pas dire qu’on ne puisse pas faire du théâtre autrement. Chaque modèle subit des changements, il se développe, c’est un processus et non une forme constante. Chaque travail de création est un travail intime, qui dénude l’autre individu, lui permet d’accéder très près de la sphère intime. Il faut avoir confiance en l’autre pour s’ouvrir à lui. Il ne faut pas craindre de montrer ses pensées absurdes, de parler des choses difficiles. À part ça, chaque créateur a son caractère spécifique, ce ne sont pas des individualités faciles. Être artiste n’est pas facile. Évidemment cela dépend aussi du type d’art auquel on a affaire. Si c’est un art commercial, il n’y a pas de problème de nature existentielle, il n’y a que des problèmes d’organisation. Si par contre on pratique un théâtre ou un jeu d’acteur qui parle de soi et touche certaines sphères intimes, qui transgresse des tabous, il faut travailler avec quelqu’un qui te comprenne. Ilfaut que ce soit quelqu’un qui te connaisse et qui sache se comporter avec toi. Il n’y a pas d’autres possibilités. C’est très difficile. Lorsque l’on commence à travailler ensemble, on démarre au même niveau. Ce n’est qu’après qu’apparaît son propre ego et la question très délicate : pourquoi est-il plus important?Pourquoi est-il plus montré ? Puis commence la rivalité. Lorsque les gens sont encore jeunes, tout va bien, mais à partir d’un certain moment l’ego commence de plus en plus à se faire entendre, et souvent les groupes de création collective éclatent. Le modèle de coopération basée uniquement sur l’amitié et la compréhension n’est pas toujours le plus durable. Tout a son prix et être artiste, avant tout. Pour l’instant nous nous sentons bien ensemble. De temps en temps nous nous rencontrons, nous organisons des réceptions, quoique de plus en plus rarement, car les gens sont très occupés par leur travail. Les acteurs, même s’ils ne s’en rendent pas toujours compte, sont absolument libres. Cela doit être ainsi, comme dans l’amour.
L’homme ne peut être lié à un autre homme que si celui-ci est libre. Je considère que chacun devrait avoir la liberté du choix artistique.
A.S.: Et l’intimité ? Il peut arriver que cette intimité devienne une nourriture pour la création. L’art doit-il se mêler à la vie et la création puiser dans l’intimité, dans l’expérience personnelle ?
M.S.: Cela dépend si l’autre personne le permet. Il y a des exhibitionnistes et des gens renfermés sur eux-mêmes. Ce sont des frontières ténues. Les gens portent divers masques. L’art puise toujours dans l’existence individuelle, dans les obsessions cachées, dans les passions, il touche à la nature profonde de l’homme.
A.S.: Vos relations à l’intérieur de la troupe sont très proches, quasiment familiales. Dans une telle atmosphère est-il plus facile d’affronter les traumatismes, les exclusions, la cruauté, présents dans vos spectacles ?

M.S.: Oui. Il est très important d’avoir entre nous une sensation de sécurité absolue. Les acteurs se conduisent parfois comme des enfants nécessitant une attention particulière, ils se perdent, boivent, font des histoires. Ces maris, ces pères et mères ne se conduiraient jamais ainsi s’ils n’avaient pas un sentiment de sécurité.