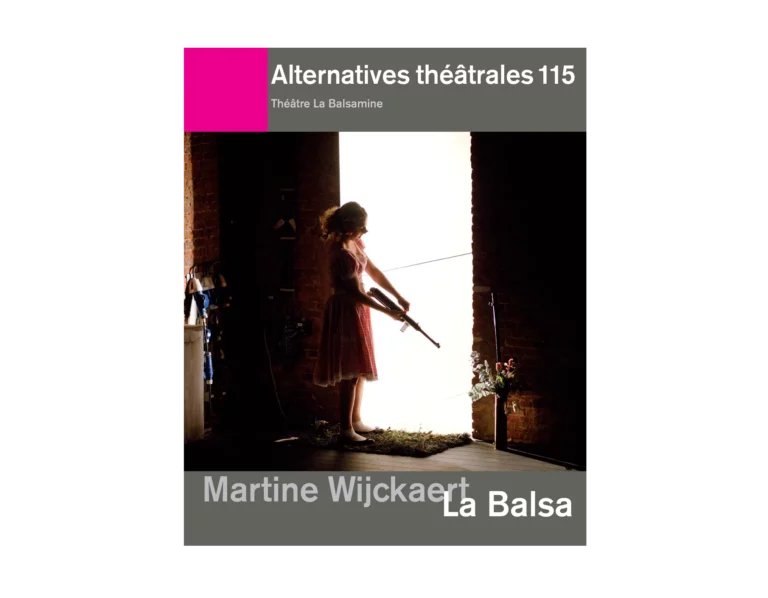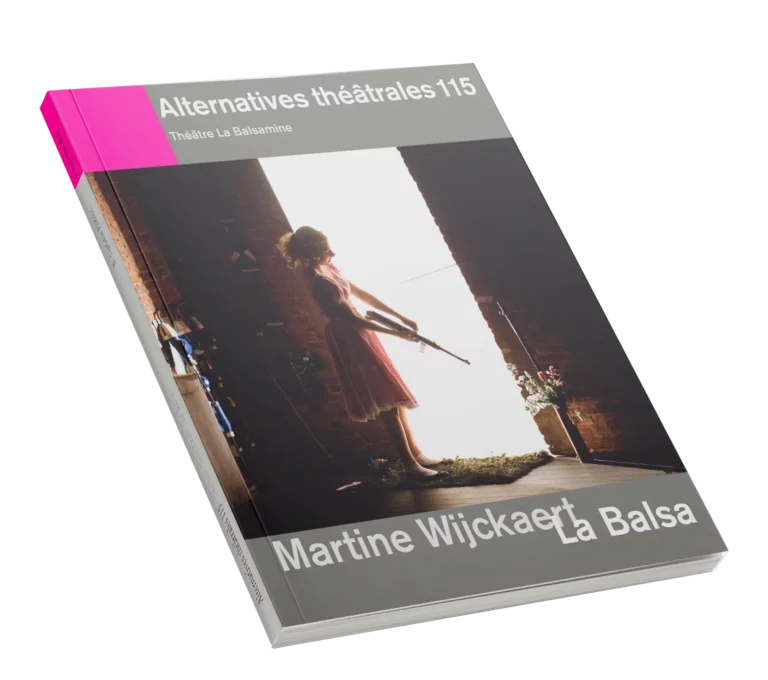BERNARD DEBROUX : Tu arrives à la Balsamine pour la saison 1993 – 1994…
CHRISTIAN MACHIELS : J’arrive au début de cette saison, une saison qui est faite, elle est programmée.
BERNARD DEBROUX : Martine Wijckaert occupe les lieux (les casernes Dailly) depuis la création de LA PILULE VERTE, en 1981. Qu’est-ce qui t’amène là-bas ? Comment le projet s’est-il construit ?
CHRISTIAN MACHIELS : Martine monte LA PILULE VERTE en 1981 dans les casernes et c’est, comme tu le sais, un succès planétaire. Le Théâtre de la Balsamine décide de rester dans les casernes, de les squatter… Martine continue à faire ses spectacles à la caserne, mais elle a en même temps une politique d’ouverture à toute une série d’artistes, et plutôt des jeunes artistes, comme Françoise Bloch, Charlie Degotte, Virginie Jortay, Isabelle Pousseur et beaucoup d’autres.
B. D.: J’y ai vu aussi ROSAS d’Anne Teresa de Keersmaecker.
C. M.: Là c’était le Kaaitheater qui avait demandé à Martine s’il pouvait occuper l’amphithéâtre. À cette époque je travaille chez Indigo et on organise en 1991 le premier « Danse à la Balsa » en collaboration avec le Théâtre de la Balsamine avec des artistes qui sont soit soutenus par la Balsamine, soit par Indigo. C’était le cas de Thierry Smits, de Nadine Ganase. On organise ce festival-là en 1991 et en 1992. Cela m’a permis de connaître un peu l’équipe de la Balsa et à la Balsa de me connaître. C’est à ce moment que Martine fait part de son envie de se consacrer à son travail de metteure en scène, à son travail de créatrice. Elle m’a donc proposé de reprendre la direction de la Balsamine, elle demeurant artiste en résidence, artiste associée. Les choses se sont passées assez simplement, comme elles ne pourraient sans doute plus se faire maintenant. J’ai commencé à travailler sur la saison 1993 – 1994 qui est une saison que Martine avait programmée avec Michel Cheval, collaborateur de la Balsa à cette époque.
B. D.: Est-ce que les choses changent sur le plan institutionnel ? Notamment vis-à-vis de la Communauté française et des aides qui sont octroyées pour ces différentes missions… Y a‑t-il une convention, un contrat-programme ? Martine avait sa subvention d’artiste, elle n’avait pas d’aide particulière pour la Balsamine…
C. M.: La Balsamine avait une très petite subvention, six millions de francs belges à l’époque. Mon arrivée visait aussi à conforter la nouvelle Balsamine avec deux enjeux qui étaient vraiment très présents. Le premier, c’était l’occupation du bâtiment parce qu’il n’y avait aucun accord écrit et des bruits très alarmants de démolition et de la disparition des casernes se répandaient…
B. D.: Vous avez réagi très vite…
C. M. : Il y a eu, pour le bâtiment une bagarre très rapide, c’est un des premiers dossiers dont j’ai dû m’occuper : faire en sorte qu’on ait une légitimité et que, dans le projet de l’affectation, on tienne compte de nous, ce qui n’était absolument pas les intentions de la Région bruxelloise, propriétaire du bâtiment. Le deuxième pari était d’obtenir un contrat-programme qui permette à la fois de poursuivre le travail de Martine, mais aussi d’être un lieu d’accueil, de coproductions, de créations de jeunes compagnies. Je suis arrivé dans un lieu où il y avait déjà un esprit d’ouverture. C’est très important car, quand on arrive dans un lieu, le plus difficile c’est d’y mettre un esprit. Ce lieu était dévolu prioritairement aux jeunes compagnies ; je me suis inscrit dans une voie qui avait déjà été ouverte.
B. D.: Dès les premières saisons, on va trouver une série d’initiatives qui vont durer. « Danse à la Balsa », tu l’organises même avant d’y être, et « Danse à la Balsa » va exister pendant vingt ans. Dès les premières saisons, on voit aussi fleurir ce qu’on pourrait appeler des petites formes, des tentatives, des cartes blanches données à des essais, à des premières, à des créations. On va voir apparaître d’autres initiatives qui vont durer : « Les moissons », « Les giboulées ». S’il y avait un certain esprit, il est conforté se traduit dans une plus grande visibilité, et elles se répètent d’année en année. Cet esprit dont tu parles et que tu as qualifié dans un des programmes de saison, tu l’as résumé dans une formule : un lieu utopique et imprévisible.
C. M.: Il ne faut pas oublier qu’on se retrouve dans un lieu qui est un petit amphithéâtre au milieu de cinq mille mètres carré de casernes à l’abandon, en friche, un lieu un peu brol, un lieu où tu peux planter un clou dans n’importe quel mur sans que personne ne vienne te dire : « attention faut pas abimer ! ». Tout était possible. Il y avait l’amphithéâtre, il y avait la salle des nains, les espaces extérieurs. C’était un lieu utopique parce qu’il y avait un espace gigantesque à la disposition des artistes et je trouve qu’ils l’ont vraiment bien utilisé. Je pense que le premier spectacle de la compagnie Furiosas, LA DANSE DES PAS PERDUS, dans l’énorme couloir du bâtiment de façade qui fait trois mètres de large et trente mètres de longs, c’est un exemple de ces aventures formidables et qui sont suscitées par la géographie du lieu. Il me semble que ces démarches ont disparu de la ville en même temps que les grands espaces à squatter ont disparu.
B. D.: Parler de l’esprit des programmations, c’est aussi « Danse à la Balsa ». Affirmer ce lieu comme un l’endroit où on peut voir de la très jeune danse. Il y a aussi des fidélités, on voit des artistes qui se retrouvent pendant un certain nombre d’années ou qui reviennent épisodiquement. Il y en a qui sont plus ou moins connus et d’autres qui ne le sont pas du tout. Il y a une sorte de balance, d’équilibre. Au début, on y voit Michèle Noiret, Pierre Droulers ou encore Thierry Smits.
C. M.: C’est vrai que j’ai essayé de maintenir un équilibre entre fidélité et découverte. Mais je pense vraiment que la Balsa est un lieu, que ça soit en danse ou en théâtre, où on a permis à beaucoup de premiers projets de démarrer. Comme tu l’as dit, que ce soit avec les esquisses ou avec les premiers projets de metteurs en scène ou de chorégraphes. Et au moment où ces metteurs en scène, ces chorégraphes grandissaient, j’ai toujours un peu essayé de les pousser à ce qu’ils aillent ailleurs, à ce qu’ils trouvent des partenariats avec d’autres lieux. Ce qui n’empêchait pas qu’ils pouvaient revenir, mais ils revenaient avec une autre expérience qui bénéficiait aux uns et aux autres. Je voulais que les portes restent toujours ouvertes et en même temps j’ai toujours été très vigilant à ce que la Balsa soit un lieu ouvert aux premier pas.
B. D.: Un autre élément aussi qui est revenu à plusieurs reprises, de manière plus significative que dans d’autres théâtres, même si certains comme l’Océan Nord le font encore davantage, c’est un travail sur le quartier, en tout cas des tentatives qui ont été faites de travailler, d’avoir cette perspective qui peut paraître parfois un peu antinomique parce que quand on a comme objectif la jeune création avec le côté « avant-gardiste » ou radical que ça peut avoir, ce n’est pas évident de mettre en rapport ce travail avec un travail sur le quartier.
C. M.: D’autant que quand il y a eu tous les problèmes du bâtiment et l’incertitude qui a pesé sur la possibilité de pouvoir rester sur le site, je me suis dit que j’aimerais bien que, dans le quartier, la Balsamine soit aussi importante que le boulanger du coin. Il y a une pâtisserie assez célèbre place Dailly, la Pâtisserie Van Dender, qui est très connue pour son gâteau au chocolat et ses pralines notamment. J’avais envie que la Balsa soit aussi importante que ça, que les gens soient fiers d’avoir ce théâtre à côté de chez eux. J’ai essayé plein de démarches, tout ça a été repris dans le numéro d’Alternatives théâtrales, LE THÉÂTRE DANS L’ESPACE SOCIAL.
Inviter les gens, qu’ils viennent voir des spectacles, ouvrir les générales aux gens du quartier, faire des rencontres avec les metteurs en scène, mais ça n’a jamais bien fonctionné. Il y a toujours eu un mur ; j’ai toujours l’impression que pour une partie de la population, mettre les pieds dans un théâtre, la Balsamine ou un autre, c’est quelque chose d’extrêmement compliqué. Les gens disent toujours : « Comment fait-on pour y aller ? Comment fait-on pour réserver ? » alors qu’il n’y a rien de plus simple, c’est une porte à pousser finalement… La chose qui a marché, qui a réussi, qui a fait que les gens du quartier son venus à la Balsa, c’est quand je leur ai proposé d’être sur le plateau, quand je leur ai dit : « on va faire un spectacle avec vous ». Là, il y a eu du monde, on a eu plus de quarante personnes du quartier, les gens qui habitaient dans les rues avoisinantes et qui ont participé à ce projet écrit par Alain Cofino Gomez et mis en scène par Valérie Cordy. C’était juste avant la fermeture de l’ancienne Balsa, ce fut le dernier projet réalisé dans l’amphithéâtre. Ça a été vraiment une belle réussite. Faire venir les voisins, c’est les rendre actifs…
B. D.: Y a‑t-il eu une suite ?
C. M.: Dans les deux ou trois saisons qui ont suivi, ces gens-là sont venus voir les spectacles. Ils connaissaient le chemin, ils étaient chez eux, c’était réussi. Après on a encore essayé d’autres initiatives du même type. Cela dit, le quartier de la place Dailly n’est pas le quartier de l’Océan Nord. C’est un quartier plus bourgeois, les gens bossent la journée et retournent le soir chez eux, donc c’est relativement mort durant la journée. Ce n’est pas le cas à Océan Nord où on a toujours l’impression qu’il y a plein de monde dehors tout le temps, c’est une autre vie. On a pourtant réussi à faire des choses avec le quartier : un comité de spectateurs qui a été très actif ; Alain Cofino Gomez a animé un atelier d’écriture avec les gens du quartier qui a été très suivi. Pour que le rapport au quartier fonctionne, il faut que les gens soient actifs et non des spectateurs passifs.