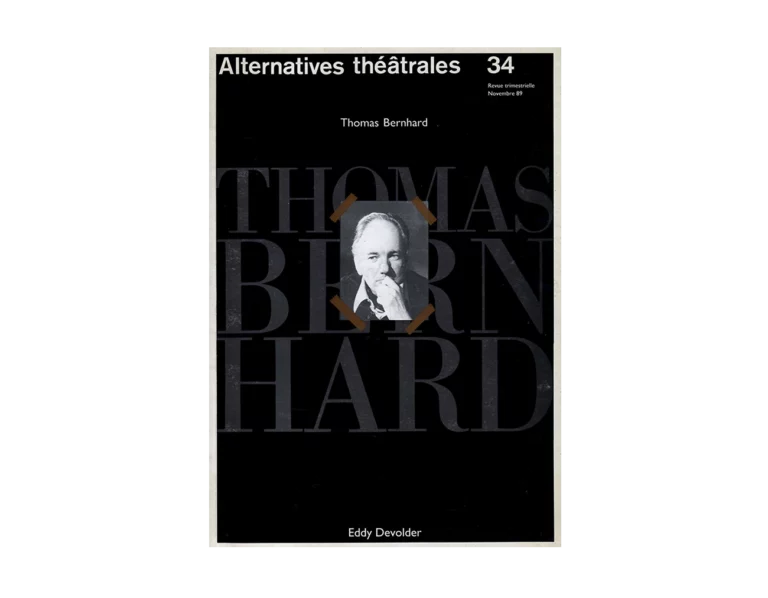PARES sont les écrivains contemporains qui se sont engagés aussi loin dans l’œuvre au point de se confondre avec elle et de bousculer ainsi l’idée que l’écrivain est l’auteur de cette œuvre pour aboutir plutôt au constat contraire qu’il est l’œuvre de cette œuvre, modelé par elle au fur et à mesure qu’il l’alimente, devenant ainsi le serviteur dévoué d’une écriture monstrueuse qui exige de la part de l’écrivain qui la nourrit, toujours plus de lui-même afin qu’elle puisse exister, cette œuvre qui laisse d’autant moins de répit qu’elle est sans merci.
Personne sans doute n’est parvenu à tresser, à entrelacer avec une telle maîtrise les différents matériaux qui alimentent le travail de l’écrivain : sa biographie, son époque, son entourage, sa langue, pour lui imprimer un style qui mélange à ce point la phrase et la révolte, la langue et la rage, le mot et la dénonciation.
Au fil des milliers de pages de son imposante entreprise : 17 pièces de théâtre, 2 scénarios, 4 récits autobiographiques, 13 récits soit approximativement une quarantaine de livres, s’affirme une rare cohérence dans sa radicalité.

Cependant Thomas Bernhard n’est pas le philosophe qui dit une vision rationnelle du monde. C’est un écrivain. Son but n’est pas de développer une idée ou de l’illustrer mais de susciter l’émoi, l’émotion, de lui imprimer un mouvement à travers une langue qui chez lui tient du ressassement obstiné, entêté et répétitif. Ainsi, loin de se contenter de son seul rôle de témoin, il réagira avec la passion et les emportements des grands élans de conscience, n’hésitant pas à provoquer, à interpeller où dénoncer l’hypocrisie, les faux semblants, les louvoiements, les mensonges, …
De la hargne à la haine, de l’arrogance acrimonieuse à la véhémence de ses interprétations, l’écriture de Bernhard est broyeuse et tellement destructrice qu’elle attaque l’histoire même qu’elle raconte, la harcèle, la ronge comme si l’ambition de Bernhard était d’en finir avec ce récit par quoi tout commence. Les diatribes, les emportements, les débordements éreintent, brisent et pour finir laminent tout sur leur passage avec la rare virulence du nihilisme.
Cependant, à travers cette constante polémique dans laquelle Bernhard est lancé, c’est un réquisitoire qui retentit ; un réquisitoire contre la soumission, l’abandon, la défaite imposée.
Ce qu’il dénonce, c’est la médiocrité ambiante, la rouerie, l’hypocrisie du pouvoir, la conjuration de l’infamie quel que soit son nom : Vienne, Salzbourg, l’Autriche, le monde, la politique, le théâtre, la littérature, les hommes n’étant finalement et par-delà leur destin que les piètres pantins corrompus d’une existence sordide, lamentable étriquée, mais pour laquelle, comble de l’ironie, ils sont prêts à tous les compromis alors qu’elle appellerait la révolte, l’opposition marquée, la mutinerie, l’insurrection.
Les textes de Thomas Bernhard n’ont rien de commun avec la jérémiade, la lamentation ni même avec ce gémissement de la plainte par laquelle la pensée se soumet à la douleur.
Dans les hôpitaux, les sanatoriums et jusque dans les mouroirs que Thomas Bernhard fréquente adolescent, abandonné par son entourage, il apprend ce qu’il nomme vite la mathématique supérieure de la souffrance et de la mort. Il y apprend aussi combien le ressassement, la répétition est le redoublement d’une pétition, d’une quête, d’une prière. Mais au lieu de s’abandonner à son entourage, de s’en remettre à la médecine qui le condamne, Bernhard se révolte, se dresse contre cet état de chose qui le condamne à mort. Dans le mouroir où il agonise, il décide non seulement de vivre, mais aussi d’écrire. Dans cette épreuve ultime qui en principe exclut le choix, il se lance dans une entreprise folle, démesurée ; il ne cherchera pas à exprimer la plainte, ou à la dompter, à l’apprivoiser. Il va bien plutôt essayer de l’enfourcher, de la chevaucher et ainsi de transmuer la faiblesse en force, de puiser cette force dans sa faiblessemême et cela soudain le dotera, lui, l’être vulnérable à souhait, le pulmonaire auquel le souffle manque, d’une énergie fabuleuse dont la source réside dans sa révolte contre la mort.
Cette révolte première sera à la base de toutes les autres, c’est par elle qui’il entre en écriture, et dès cet instant, l’écriture sera pour Bernhard l’instrument de cette rébellion, de cette lutte qui tiendra de l’épopée incisive, ironique, exaltée, satirique, parfois grotesque.
Il l’a souligné à plusieurs reprises, ses livres sont à prendre comme une pièce de théâtre, comme une monstration — une définition progressive de la monstruosité générale — plutôt que comme une démonstration.
Pas de longs développements discursifs ni de messages cachés mais une envoûtante incantation, synonyme de décantation.
Il n’est pas étonnant dès lors que l’autobiographie — l’introspection sans pitié de soi — tienne une place tellement importante.
Autobiographie dont des fragments, des scènes marquantes émergent dans ses autres textes, rappelant ici et là sa naissance à Heerlen, la figure de son grand-père maternel, l’exil de l’enfance en Allemagne, l’obsession du suicide, le refus de retourner au lycée à la fin de la guerre, son expérience d’apprenti dans un magasin d’alimentation dans le quartier le plus mal famé de Salzbourg, son désir de devenir chanteur d’opéra, sa pleurésie mal soignée qui le voit, atteint de tuberculose, aboutir dans un mouroir jusqu’à l’instant où se sentant infiniment proche de la mort, il prend la décision de vivre, l’Académie à Vienne, le Mozartheum à Salzbourg qu’il termine en rédigeant un mémoire sur Brecht et Artaud, les voyages, les premiers textes publiés, poèmes et articles dans les journaux, les premières petites pièces de théâtre écrites pour des amis jusqu’au moment où, en 1963, paraît son premier roman « Gel ». À partir de cet instant, les livres se succèdent, en moyenne trois par an. Et chaque livre voit arriver un prix, une récompense institutionnelle qui aggrave le malentendu et excite les passions et les prises de position autour de son nom. Jamais, lorsqu’il se met à écrire, Thomas Bernhard ne définit la trame préalable, n’esquisse de plan. Son écriture à ses yeux ne procède pas d’un genre. Pourtant de « Gel » à « Corrections » en passant par « Amras et autres contes » à « Perturbation » et enfin à « La Plâtrière », Bernhard donne dans la fiction : les récits sont distanciés, rapportés sur un mode indirect, jusqu’au jour où il commence son autobiographie pour publier par la suite « Le neveu de Wittgenstein », « Béton », « Des arbres à abattre ».. qui tous oscillent entre ce mode direct/indirect d’identification et de distanciation avec l’histoire.
Dans ce contexte, le théâtre (six-sept pièces écrites) fait office de trait d’union, de ciment qui consolide les éléments de l’édifice.
D’emblée, il convient de souligner que l’importance de sa production théâtrale lui vient de l’amitié qu’il noue avec le metteur en scène et directeur de théâtre Claus Peymann. D’autre part, les œuvres théâtrales sont généralement écrites pour des acteurs précis, c’est dire combien elles sont circonstancielles et obéissent à des données précises.
Ce n’est pas pour rien que « L’ignorant et le fou » est écrite pour le Festival de Salzbourg, la ville où fut commandé et interprété « La Flûte enchantée » de Mozart, cet opéra qui inspire à Bernhard l’héroïne de « La Reine de la Nuit ».
Lors de la première de cette pièce, le directeur du Festival refusa de couper l’éclairage de secours. Et cette anecdote devint l’argument d’un autre texte « Le faiseur de théâtre ».
C’est dire combien les pièces font souvent écho, comme des ricochets, à des dérapages, des anecdotes réelles auxquels s’ajoutent les rappels d’épisodes racontés par ailleurs, des passages autobiographiques, de telle sorte que se mêlant, s’emmélant à l’infini, chaque tirade procède d’une mise en abîme.
Souvent les récits ouvrent des fenêtres sur les autres récits, des fenêtres en tous sens, ébauchant de savantes verrières, des serres semblables à des diamants bruts.
Tout ce qu’il a écrit, Bernhard l’a écrit par ailleurs. Il n’est pas jusqu’à certaines phrases qui ne revienent avec une étonnante régularité comme s’il procédait à la manière d’un promeneur qui dans la neige essaie de marcher dans les traces de ses pas. Des empreintes n’épousant jamais les empreintes précédentes, jouant de légers décalages, de glissements, de gauchissements, de travestissements ; et souvent Bernhard revient sur ses pas, cela sur une distance plus ou moins longue, frappant chacune de ses traces laissées d’une nouvelle empreinte, répétant certains circuits, de sorte que chaque trace peut être lue dans la logique d’une promenade, d’un trajet, mais aussi comme une résonance perçue en écho à d’autres promenades.
De même, son écriture peut-elle être comparée à un polyèdre, diamant, cristal ou dans le cas de Bernhard, obsidienne, dont chaque face serait taillée tout à la fois en relation avec les autres faces mais aussi en relation avec le cœur ou l’eau de la pierre, mais aussi avec son miroitement comme s’il affirmait le souci de donner une consistance, une épaisseur, un volume à ce miroitement.
Cela ne se conçoit peut-être pas à la première lecture, c’est pourtant ce jeu multiple qui définit une œuvre, que le temps avec le temps accomplira.…